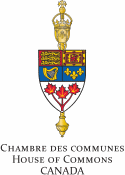[Français]
Bonjour et bienvenue à la neuvième réunion du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir.
Je souhaite la bienvenue aux membres du Comité, aux témoins et aux personnes, parmi la population, qui suivent la réunion sur le Web.
Je m'appelle Marc Garneau et je suis coprésident de ce comité. Je suis accompagné de l'honorable Yonah Martin, sénatrice et coprésidente du Comité.
Nous continuons aujourd'hui l'examen prévu par la loi des dispositions du Code criminel concernant l’aide médicale à mourir et leur application.
[Traduction]
Le Bureau de régie interne exige que le Comité respecte les protocoles sanitaires. Je ne vais pas les énumérer, car vous les connaissez maintenant. Ils sont en vigueur jusqu'à la fin de la session, soit jusqu'à la fin du mois de juin.
Avant de commencer, je vais vous donner quelques renseignements d'ordre administratif. Je rappelle aux membres du Comité et aux témoins qu'ils doivent mettre leur micro en sourdine, à moins que les coprésidents ne leur donnent la parole en les désignant par leur nom. Tous les propos doivent être adressés aux coprésidents. Lorsque vous avez la parole, veuillez vous exprimer lentement et clairement. Les services d'interprétation offerts pour cette vidéoconférence sont les mêmes que ceux offerts pour une réunion en personne. Vous avez le choix, au bas de l'écran, entre le parquet, l'anglais et le français.
Cela dit, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre premier groupe de témoins. Pour discuter de la question de savoir si les personnes atteintes de maladie mentale devraient pouvoir accéder à l'aide médicale à mourir au Canada, nous recevons M. John Maher, de l'Ontario Association for ACT & FACT. Nous recevons également deux personnes qui témoignent à titre personnel: Mme Georgia Vrakas et la Dre Ellen Wiebe.
Je vous remercie de votre présence. Nous allons commencer de la manière habituelle. Vous disposerez de cinq minutes pour faire votre déclaration préliminaire. Je vous demanderais de vous en tenir à ces cinq minutes, afin que nous puissions vous poser le plus grand nombre de questions possible.
Nous entendrons tout d'abord M. Maher. Vous disposez de cinq minutes.
:
Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité.
L'Association canadienne pour la santé mentale, l'ACSM, l'Association canadienne pour la prévention du suicide et ma propre organisation, l'Ontario Association for ACT & FACT, ou l'OAAF, qui est la plus grande association professionnelle de soins tertiaires en santé mentale offerts dans la collectivité au Canada, pour n'en citer que quelques-unes, ont toutes dénoncé le projet de loi . Quiconque affirme qu'un consensus émerge est très mal informé, voire pire.
La commission parlementaire du Québec a tenu compte des faits. J'espère que vous ferez de même, car ce qui se passe est tragique.
Je suis psychiatre, et je suis un éthicien médical. Depuis 20 ans, je ne travaille qu'auprès d'adultes atteints des formes les plus graves et les plus persistantes de maladie mentale, dans des maisons de chambres infestées de cafards et de punaises et dans la rue, où notre société riche les oblige à vivre dans la pauvreté, nos fils et nos filles étant traités comme des exclus.
Les défenseurs de l'aide médicale à mourir affirment que tout le monde doit pouvoir accéder à l'aide médicale à mourir, indépendamment de la pauvreté écrasante, du manque d'accessibilité choquante aux traitements, des temps d'attente prolongés de plusieurs années ou du fait que des gens sont atteints d'une maladie du cerveau et qu'on ne peut pas prédire si leur maladie est irrémédiable. Leur cheval de bataille, c'est l'autonomie à tout prix, mais elle causera inévitablement la mort de personnes dont l'état s'améliorerait. Quel nombre de conjectures erronées est acceptable pour vous?
La mort n'est pas un substitut acceptable à de bons traitements, à la nourriture, au logement et à la compassion. Vous qui avez voté pour cette loi n'avez pas compris que des gens sont vulnérables et ce que cela signifie que votre médecin vous offre la mort plutôt que la vie. Croyez-vous sérieusement que vous pouvez empêcher les 100 000 médecins et infirmières praticiennes du Canada qui ont maintenant un permis de tuer de commettre des abus? S'il vous plaît, lisez les nouvelles.
Vous savez que le projet de loi n'est pas conforme au principe énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Carter de préserver la vie. Cette décision soutient explicitement que les gens ne peuvent obtenir de l'aide pour mettre fin à leur vie que lorsqu'ils ne peuvent plus physiquement le faire eux-mêmes. S'il vous plaît, faites un renvoi à la Cour suprême si vous êtes si sûrs de la façon dont elle va statuer, car la justice et la préservation de la vie l'exigent.
Mes collègues psychiatres sont choqués et incrédules. En 2021, l'Ontario Medical Association a réalisé un sondage dans lequel elle a posé des questions claires aux psychiatres de l'Ontario, après l'adoption du projet de loi . Il s'avère que 91 % d'entre eux s'opposaient à la Loi, 7 % étaient incertains et seulement 2 % appuyaient ce qui a découlé du projet de loi — seulement 2 %.
Les psychiatres ne savent pas, et ne peuvent pas savoir, quel patient verra son état s'améliorer et vivra une bonne vie pendant des décennies. Les maladies du cerveau ne sont pas comme des maladies du foie. Si les conjectures vous conviennent, sachez qu'elles ne conviennent pas aux psychiatres qui comprennent les données scientifiques et s'acquittent de leur devoir de respecter une norme de soins professionnelle. Vous avez été systématiquement induits en erreur par une idéologie discriminatoire au détriment de la réalité clinique. Adopter une loi qui indique aux psychiatres de faire des prédictions impossibles ne rend pas la chose possible par magie.
Certains de mes patients refusent maintenant de recevoir un traitement efficace pour pouvoir être admissibles à l'aide médicale à mourir. Ils ont été influencés par le mensonge selon lequel il ne s'agit pas d'un suicide. Le suicide est toujours défini cliniquement comme le fait de prendre des mesures pour organiser sa propre mort. L'Association canadienne pour la prévention du suicide a déclaré que dans tous les cas, lorsque des personnes atteintes de maladie mentale reçoivent l'aide médicale à mourir, il s'agit d'un suicide. L'affirmation franchement bizarre selon laquelle le suicide est toujours un acte impulsif et non planifié ne se fonde pas sur la réalité. Seulement 7 % des personnes qui font une tentative de suicide au Canada en meurent. Je vous le demande: que deviendra cette proportion? Elle sera probablement la plus forte dans le monde.
Dans les quelques pays européens qui exigent au moins que la personne essaie les traitements standards avant qu'on procède à l'euthanasie, les taux de suicide ont augmenté de façon constante et importante au cours des deux dernières décennies, alors qu'il a diminué dans tous les autres pays autour. Le taux de suicide chez les femmes, en particulier, a beaucoup augmenté. L'affirmation fausse, que la Cour suprême a acceptée sans preuve, que l'aide médicale à mourir n'entraîne pas une augmentation des taux de suicide est absolument contredite par les données. La contagion suicidaire devrait vous effrayer. Soutenez-vous la prévention du suicide, oui ou non?
Dire à mes patients que vous allez faciliter leur mort m'a rendu furieux. Ils feront du magasinage de médecins pour trouver les quelques psychiatres qui se prennent pour des défenseurs de l'autonomie à tout prix, comme c'est déjà le cas dans les pays du Benelux, et ils mourront parce que la mort a été préférée à l'appartenance pleine et entière à la communauté humaine. Ils mourront à cause de la souffrance sociale que cette loi consacre. Ils mourront à cause du manque de services. Ils mourront parce que les psychiatres pourront désormais, légalement, abandonner. Ils mourront parce que, que vous puissiez le voir ou non, vous leur avez dit qu'ils ne comptent pas.
Vous avez tué l'espoir au Canada dans les endroits où il est le plus nécessaire.
:
D'accord. Je vais m'assurer de ne pas dépasser cinq minutes.
[Français]
Bonjour.
Je m'appelle Georgia Vrakas. Je suis psychologue et professeure, et je vis avec une maladie mentale.
Pour commencer, je tiens à vous remercier de m'avoir invitée à témoigner devant le Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir.
Je tiens à me positionner contre l'inclusion de la maladie mentale comme seule condition médicale pour obtenir l'aide médicale à mourir. Cette question m'interpelle beaucoup en tant que professionnelle dans le domaine de la santé mentale et en tant que personne vivant avec une maladie mentale depuis l'âge de 23 ans.
Pendant plus de 20 ans, j'ai cru que j'étais atteinte d'un trouble dépressif majeur. J'ai vécu plusieurs épisodes, qui ont engendré beaucoup de souffrance et des arrêts de travail. J'ai aussi eu des pensées suicidaires.
Au mois de mars 2021, j'ai eu ma plus récente rechute. J'étais découragée et désillusionnée, puisque j'avais suivi tous les traitements qui m'ont été recommandés. Le problème, c'est que je n'avais pas reçu le bon diagnostic.
J'ai finalement été diagnostiquée le 3 mai 2021, soit il y a un an. Je suis atteinte d'un trouble bipolaire de type II, un trouble mental grave et persistant. Les mois précédant mon diagnostic ont été très difficiles et souffrants. J'ai pensé sérieusement au suicide. J'avais un plan, et j'ai commencé à le mettre à exécution. Finalement, je me suis rendue à l'urgence.
J'ai aussi parlé à une intervenante du Centre de prévention du suicide. Elle m'a aidée à me raccrocher à la vie. Je ne voulais pas mourir, mais je voulais arrêter de souffrir. Si nous avons ce type de services, c'est pour nous aider à retrouver l'espoir. Un traitement médicamenteux prometteur me redonne confiance. Même après 20 ans et plusieurs rechutes, je suis encore debout. Non seulement je suis en vie, mais je compte le rester.
C'est mon histoire personnelle, mais c'est aussi celle de plusieurs autres personnes au Canada. Comme vous le savez, environ 20 % de la population, au Canada, va souffrir d'une maladie mentale au cours de sa vie. De plus, 90 % des personnes qui meurent par suicide ont un trouble mental. La maladie mentale et le suicide sont des problèmes de santé publique qui nécessitent une réponse de santé publique.
L'inclusion de la maladie mentale comme seul motif dans la Loi canadienne sur l'aide médicale à mourir est une réponse politique à un problème de santé publique. Cette loi individualise — je suis malade, je veux arrêter de souffrir — un problème sociétal, celui où la maladie mentale est encore taboue, où l'accès aux services en santé mentale est très difficile, où la recherche en psychiatrie est sous-financée et où le financement des programmes de promotion et de prévention continue à diminuer.
Nos gouvernements ont choisi de ne pas investir dans ce qu'il nous faut pour améliorer notre santé mentale en amont ni dans ce qu'il nous faut pour nous rétablir quand nous sommes déjà malades. Aujourd'hui, on veut inclure dans l'aide médicale à mourir des personnes qui, comme moi, sont atteintes de maladies mentales. Cela nous aidera supposément à mieux mourir. Or nous n'avons même pas accès aux services minimaux qui nous aideraient à mieux vivre. Je parle de vivre, et non de survivre.
Dans ce contexte, en donnant aux gens comme moi le feu vert pour obtenir l'aide médicale à mourir, on signifie clairement son désengagement relativement à la maladie mentale. On nous transmet le message qu'il n'y a pas d'espoir et que nous sommes des êtres jetables.
Pourtant, on investit dans la prévention du suicide. On sait que ce n'est pas la mort que les gens recherchent, mais la fin de la souffrance. On le dit et on le répète, le suicide n'est pas une solution. Alors, comment réconcilier l'aide médicale à mourir avec cela en sachant que 90 % des personnes qui meurent par suicide ont une maladie mentale? Comment différencier le désir de mourir au moyen de l'aide médicale à mourir du désir de se donner la mort soi-même?
On nous dit qu'on ne peut pas exclure la maladie mentale comme seul motif de l'AMM, afin de ne pas faire de discrimination envers les personnes vivant avec une maladie mentale. Pourtant, dans la vie, nous faisons face à la discrimination au quotidien, qu'il s'agisse de l'accès au logement, à un travail, à un revenu décent ou à l'assurance-invalidité. Selon moi, l'argument de la discrimination devant la mort ne peut être considéré comme légitime alors qu'il y a une discrimination devant la vie.
L'AMM pour seul motif de maladie mentale, dans le contexte actuel, est une solution facile et moins chère pour régler un problème complexe. La solution passe par l'augmentation des programmes de promotion et de prévention, par l'augmentation des services en santé mentale, par l'investissement dans la recherche en psychiatrie, par l'investissement dans les programmes d'éducation à la santé mentale et par la lutte contre la stigmatisation.
Les 20 dernières années n'ont pas été faciles pour moi sur le plan de la santé mentale. L'an dernier a été très difficile, mais je suis encore en vie.
Je sais que le chemin vers mon rétablissement sera parsemé d'embûches, mais j'apprends tranquillement à me reconstruire.
Le rétablissement ne signifie pas l'élimination de tous les symptômes ni un retour à la vie d'avant le diagnostic. C'est un processus de reconstruction de soi qui inclut la maladie mentale, mais qui n'est pas limité à celle-ci.
Nous sommes plusieurs à passer par ce chemin cahoteux. Plutôt que de nous arrêter à mi-chemin de notre parcours, donnez-nous une chance et aidez-nous à avancer dans notre processus de rétablissement et à vivre dans la dignité.
Le gouvernement du Québec nous a manifestement entendus en excluant la maladie mentale de l'aide médicale à mourir. Est-ce que, vous, vous nous entendrez?
Je vous remercie.
Je voudrais vous parler un peu de mon expérience. J'ai 30 années d'expérience en tant que médecin de famille, au cours desquelles j'ai traité de nombreuses personnes atteintes de maladie mentale, car nous n'avions pas un bon accès à la psychiatrie. J'ai acquis beaucoup d'expérience dans le traitement des personnes atteintes de maladie mentale. De plus, je suis prestataire de l'aide médicale à mourir et, au cours des six dernières années et demie, j'ai évalué environ 750 personnes et j'ai prodigué l'aide médicale à mourir à environ 430 personnes.
L'une d'entre elles est l'unique personne qui a bénéficié de l'aide médicale à mourir dont le seul problème médical invoqué était une maladie mentale. Il s'agissait d'E.F., qui, comme vous le savez tous, j'en suis sûre, a reçu l'approbation de la Cour supérieure de l'Alberta pour recevoir l'aide médicale à mourir avant que je sois autorisée à la fournir. J'ai également beaucoup d'expérience auprès de notre nouveau groupe de patients, que nous appelons nos patients de la voie 2. Il s'agit des patients dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible et que nous prenons en charge depuis mars 2021. J'ai fait environ 40 évaluations et prodigué l'aide à 18 personnes.
En outre, je travaille avec l'Association canadienne des évaluateurs et des prestataires de l'AMM et j'ai été l'auteure principale des guides de pratique clinique sur l'évaluation des patients atteints de démence et de maladies chroniques complexes. Je suis également chercheuse sur l'aide médicale à mourir et j'ai publié un certain nombre d'articles sur l'AMM au Canada.
Par exemple, l'un d'eux portait sur le suicide et l'aide médicale à mourir. Nous avons parlé avec des prestataires et le grand public, ainsi qu'avec des gens qui en savaient beaucoup sur le suicide — à savoir une population très vulnérable, du type dont parlait le Dr Maher. Ils ont tous dit très clairement que le suicide et l'aide médicale à mourir étaient deux choses complètement différentes. Ils ont indiqué — et encore une fois, il s'agit d'une grande variété de personnes — que l'aide médicale à mourir signifiait que les gens pouvaient être avec les membres de leur famille et que recevoir de l'aide n'était pas illégal. Ils n'avaient pas besoin de se cacher et ils pouvaient être avec leur famille. Par exemple, E.F. est arrivée à Vancouver avec 10 membres de sa famille autour d'elle pour la soutenir dans ses derniers instants.
Je voudrais vous en dire un peu plus sur les patients de la voie 2, car mon équipe de recherche a mené un projet de recherche sur les six premiers mois des patients de la voie 2 et sur l'expérience des évaluateurs et des prestataires. Nous avons obtenu des renseignements détaillés sur 53 évaluations de patients de la voie 2. Pour 67,3 % d'entre eux, le principal problème était la maladie mentale concomitante, et c'est également ce que j'ai constaté personnellement. Ce que je veux dire, c'est que nous avons déjà beaucoup d'expérience maintenant concernant l'évaluation et la prestation ou non de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent d'une maladie mentale concomitante, et non seulement de maladie mentale.
Je tiens à vous dire que lorsque j'évalue des personnes qui endurent des souffrances insupportables en raison de problèmes de santé graves et irrémédiables qui comprennent une maladie mentale et que je leur dis qu'elles sont admissibles à l'AMM en vertu de notre loi, vous devriez voir le sourire qui se dessine sur leur visage. Elles se sentent écoutées. Leur souffrance a été reconnue d'une manière que souvent personne d'autre n'avait vraiment reconnue, c'est‑à‑dire que leur souffrance est insupportable et continuelle et elles considèrent que le reste de leur vie sera marquée par cette souffrance.
Comment puis‑je, en tant qu'évaluatrice, dire que leurs problèmes de santé sont irrémédiables?
Elles ont reçu un traitement après l'autre, de différents psychiatres, dans différents hôpitaux psychiatriques, et encore une fois, je parle de mes patients qui ont à la fois des maladies physiques et mentales, mais c'est mon expérience, bien sûr, sauf pour ce cas, soit E.F.
:
Il est certain que dans le projet de loi qu'il vient de déposer, le gouvernement québécois a vu juste lorsqu'il a dit qu'on ne peut pas déterminer si une maladie psychiatrique est irrémédiable. Ce n'est pas possible, et le paradoxe ici, c'est que je représente 80 psychiatres en Ontario qui font un travail spécialisé. Nous ne voyons que les personnes les plus malades, celles qui sont traitées depuis le plus longtemps et qui souffrent terriblement, et nous faisons partie d'un groupe de 200 spécialistes au Canada.
Nous faisons un autre type de travail. Nous ne voyons que les plus malades, et le paradoxe ici, que beaucoup de gens ne semblent tout simplement pas comprendre, et c'est incroyablement frustrant pour moi, c'est que plus une personne est malade depuis longtemps, plus il est facile de la traiter, car pour les troubles psychiatriques, nous avons, comme options de traitement, littéralement des centaines de combinaisons de médicaments. Contrairement à un cancer en phase terminale pour lequel la chimiothérapie ne fonctionne plus, il y a toujours des possibilités de traitement. J'ai littéralement des centaines de combinaisons, et lorsque les gens ont essayé des choses, cela nous permet de cibler ce qui va fonctionner avec le temps.
Il faut du temps. Je vais utiliser une analogie ici. J'ai travaillé en oncologie pédiatrique pendant de nombreuses années. Lorsque des enfants recevaient un diagnostic de leucémie et qu'ils devaient commencer un protocole de chimiothérapie qui les ferait vomir et les rendrait malades pendant deux ans, au bout d'un an, certains enfants ne voulaient plus continuer.
Ce que cette loi offre aux gens, c'est la possibilité de s'arrêter parce que la guérison est dure et longue, mais la guérison est toujours possible. J'ai interrogé mes collègues à ce sujet. Nous en avons parlé. Nous n'avons pas encore trouvé de cas où le traitement et le rétablissement n'étaient pas possibles. Le défi, c'est que 70 % de toutes les personnes atteintes de maladie mentale au Canada cessent de prendre leurs médicaments ou ne veulent pas poursuivre le traitement à cause de la souffrance. Ce que vous dites, c'est qu'il faut abandonner avant que le remède ne soit fourni, avant que la guérison ne soit possible, et cela se fait sous le prétexte que nous devons soulager les terribles souffrances de ces personnes immédiatement — les pauvres.
Si l'on faisait cela pour des enfants mourants, où en serait‑on? À l'heure actuelle, on propose de le faire pour des adultes mourants, et il s'agit de maladies neurodégénératives. Plus on attend, plus il devient difficile de les traiter, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de les traiter.
Permettez-moi de vous donner des chiffres. Mes équipes en Ontario traitent les 7 000 personnes les plus malades. Nous en avons 6 000 sur notre liste d'attente qui attendent jusqu'à cinq ans. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a eu une maladie grave pour laquelle il a dû attendre cinq ans avant de recevoir un traitement. La stigmatisation est ancrée dans notre système.
:
En effet. Dans tous les autres cas, la décision est fondée sur l'inefficacité des traitements potentiels. Or, le groupe d'experts a affirmé que les traitements antérieurs n'ayant pas fonctionné sont des renseignements utiles et essentiels pour décider de la marche à suivre.
Permettez-moi de citer une phrase tirée du rapport du groupe d'experts qui se rapporte directement à votre question.
La phrase suivante provient du rapport Gupta: « Les connaissances sur le pronostic à long terme de nombreuses maladies sont limitées et il est difficile, voire impossible, pour les cliniciens de formuler des prévisions précises sur l'avenir d'un patient donné. » C'est écrit noir sur blanc dans le rapport du groupe, qui ajoute ensuite qu'il s'agit d'une décision éthique. Contrairement à tous les autres cas d'aide médicale à mourir au Canada, pour lesquels il faut évaluer la probabilité, sur le plan clinique, que le traitement fonctionne, dans ces cas‑ci, le groupe dit qu'il s'agit d'un « choix éthique ». C'est aussi écrit dans le rapport.
Je trouve cela ahurissant. Ce rapport est ahurissant: il dégage les psychiatres et les cliniciens de la responsabilité de soigner les plus malades et les plus vulnérables. Je défie quiconque... Je vais m'adresser particulièrement à vous, docteur Kutcher.
Vous avez déclaré que tous les psychiatres canadiens qui s'opposent à l'aide médicale à mourir pour les maladies mentales étaient égoïstes et paternalistes. J'ignore pourquoi vous avez fait ce commentaire, mais je défie tout psychiatre d'affirmer que tel patient souffre d'un problème irrémédiable, car c'est impossible. J'ai des patients qui se sont rétablis après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce n'est tout simplement pas possible. Ce sont des conjectures. Si les conjectures vous suffisent, si vous faites confiance au hasard, ou si vous êtes d'avis qu'il faut respecter l'autonomie à tout prix — si quelqu'un souhaite mourir, qu'on le laisse mourir —, appelez les choses par leur nom: on parle ici de suicide assisté.
Un pépin technique m'a empêchée de bien entendre le témoignage du représentant de l'Ontario Association for ACT & FACT. Toutefois, j'ai écouté attentivement la réponse du Dr Maher à la dernière question.
Docteur Maher, vous affirmez que de l'avis du groupe d'experts, il faut tenir compte des traitements antérieurs, mais pas des traitements futurs possibles. Vous établissez ensuite un parallèle entre [difficultés techniques], du point de vue du patient, ce qu'il considère comme intolérable et irrémédiable et ce qu'il refuse de continuer à endurer n'ont pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est la volonté du médecin traitant.
Je ne vois pas les choses de la même façon. La Dre Wiebe a parlé de la chronicité; les gens en ont assez et ils ne veulent plus essayer. Il en va de même pour les décisions portant sur les maladies physiques. Les gens déclarent qu'ils ne veulent plus subir de chimiothérapie, qu'ils n'en peuvent plus.
J'aimerais vous demander quelle est la différence pour un patient atteint d'un trouble mental. Il s'agit d'un trouble réel. On ne devrait pas placer les patients ayant des troubles mentaux dans une catégorie distincte et déclarer qu'ils sont incapables de prendre leurs propres décisions.
D'après vous, la volonté du médecin devrait-elle primer les besoins du patient?
:
Merci, madame la présidente.
Je remercie l'ensemble des témoins de leurs témoignages éclairants.
Je m'adresserai d'abord à la professeure Vrakas.
Je suis heureux que les gens puissent revendiquer de meilleures conditions de vie et de meilleurs investissements en santé mentale, puisque tout le monde reconnaît qu'il y a des investissements majeurs à faire pour améliorer l'accessibilité aux soins. Cela a été établi par le Conseil des académies canadiennes et par le rapport du groupe d'experts.
J'ai bien entendu votre plaidoyer et je pense qu'il doit être pris en compte, et c'est la même chose pour le plaidoyer passionné du professeur Maher. Nous vous avons bien entendus.
Pour ma part, je ne suis pas psychiatre. Je suis un député, et je n'ai même pas encore la prétention d'être un éthicien. Cela dit, je m'interroge sur ce qui se trouve dans le rapport d'expert. Ce rapport a déjà été cité et je vais le citer de nouveau:
Lors de l’examen des demandes d’AMM pour des personnes souffrant de troubles mentaux, il faut reconnaître que les pensées, les plans et les actions visant à provoquer la mort peuvent également être un symptôme du problème de santé constituant la base d’une demande d’AMM.
Dans le rapport d'expert, on ne nie pas cet état de fait. On indique que des troubles mentaux induisent un désir de mourir et que l'évaluateur doit bien faire attention à cela. Voici ce qu'on mentionne:
Dans toute situation où les tendances suicidaires constituent une préoccupation, le clinicien doit adopter trois perspectives complémentaires: tenir compte de la capacité de la personne à donner son consentement éclairé ou à refuser les soins; déterminer si des interventions de prévention du suicide — y compris involontaires — doivent être déclenchées; et proposer d'autres types d'interventions qui pourraient aider la personne.
Cela vous réconforte-t-il que l'on indique qu'il faut faire attention à cet aspect? Il semble qu'on réduise cela aux troubles mentaux. Les tendances suicidaires ne se manifestent pas dans tous les cas de maladies mentales. On dit plus loin dans le rapport que, quand quelqu'un est en crise, il n'est pas question d'accéder à sa demande d'AMM.
Ne pensez-vous pas que ce rapport indique qu'il y a des précautions à prendre?
:
Merci beaucoup, madame la présidente.
Je remercie nos trois témoins de leur présence.
Professeure Vrakas, je vous remercie beaucoup de votre honnêteté, de votre sincérité et de votre franchise. C'est très touchant.
Je vais poser une question à laquelle j'inviterai les trois témoins à répondre pendant les cinq ou six minutes dont je dispose. J'ai une question qui me tarabuste. Je suis arrivé ici sans a priori. J'écoute et j'essaie d'apprendre.
Madame Vrakas, vous avez dit dans votre témoignage que vous ne vouliez pas mourir, mais cesser de souffrir. J'ai l'impression que c'est aussi la situation de beaucoup de gens qui ont des maladies physiques et qui souffrent. Ils ne veulent pas nécessairement mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Comment, comme législateur, puis-je faire la différence entre le droit de quelqu'un qui a une souffrance physique et le droit de quelqu'un qui a une souffrance venant d'un problème de santé mentale? Je veux qu'ils aient tous les deux des droits égaux.
Monsieur Maher, vous avez dit qu'il n'y avait pas de discrimination à faire entre les deux, mais pourquoi donnerais-je un droit à quelqu'un qui a une souffrance physique irrémédiable et ne donnerais-je pas le même droit à quelqu'un qui a une souffrance mentale? Je sais que la question du caractère irrémédiable est très délicate.
Madame Vrakas, vous pourriez commencer, et M. Maher et Mme Wiebe pourront répondre par la suite.
:
Pour répondre brièvement, la différence principale, c'est qu'on parle de maladies du cerveau qui sont soignables. Or, si elles sont soignables, pourquoi offrir la mort?
En ce qui concerne la souffrance, la Dre Fry m'a posé la question de façon à ce que je semble paternaliste, en sous-entendant que je suis d'avis que ma volonté prime celle de mes patients. En réalité, les patients font appel à moi parce qu'ils souffrent. Ils font appel à moi parce qu'ils croient que mon équipe et moi avons l'expertise et les connaissances nécessaires pour soulager leur souffrance. Pourquoi leur offrirais‑je la mort au lieu de faire exactement ce qu'ils me demandent de faire? Ils viennent me voir pour obtenir de l'aide et pour soulager leur souffrance. Je suis en train de vous dire que je peux les aider et que des équipes peuvent les aider. Je suis en train de vous dire que seulement un Canadien sur trois a accès à des soins de santé mentale, et au lieu d'offrir des traitements, vous offrez la mort.
Nous pourrons reprendre cette discussion une fois que vous aurez fourni des traitements à tout le monde. Offrir la mort aux patients en déclarant: « Oh, ils ont reçu toutes sortes de traitements... » Il arrive souvent que des psychiatres m'adressent des patients qu'ils considèrent comme insoignables, et l'état de ces patients s'améliore grâce à des soins spécialisés. Il faut des soins spécialisés. On ne demande pas à un médecin de famille de soigner un type particulier de tumeur; on fait appel à un spécialiste. Il en va de même dans le domaine de la psychiatrie. Vous affirmez faussement que tout est égal, que tous les psychiatres sont égaux et que toutes les maladies sont égales.
Parlez du traitement des maladies résistantes. Parlez des gens qui souffrent depuis longtemps et demandez-vous ce qu'ils veulent. La réponse, c'est qu'ils veulent soulager leur souffrance. Je vous le dirais franchement...
:
Je ne vois pas de grande différence entre la maladie et la souffrance physiques et mentales. Il arrive que des gens viennent me voir et me disent exactement ce que vous avez dit, madame Vrakas, qu'ils ne veulent pas mourir, mais qu'ils ne veulent plus souffrir.
La question à poser, c'est si les traitements susceptibles de soulager leur souffrance leur ont été offerts et s'ils ont été suffisamment efficaces pour eux. Par exemple, si je disais à mon patient qu'il y avait une liste d'attente de cinq ans pour consulter un spécialiste approprié — un spécialiste comme vous, docteur Maher —, si je lui demandais s'il était prêt à continuer de souffrir pendant cinq ans et s'il me répondait non, je considérerais le problème comme irrémédiable.
La question du soulagement de la souffrance se pose presque de la même façon dans différentes situations. La plupart du temps, ce que les gens appellent la souffrance, ce n'est pas la douleur, mais l'incapacité de mener une vie normale, et ce, que leur maladie soit mentale ou physique. Je ne vois donc pas de grande différence entre les deux. Les traitements adéquats leur ont-ils été offerts? Peuvent-ils leur être offerts? Nous avons parlé de...
:
Merci, monsieur le président.
Ma question s'adresse au Dr Maher, mais Mme Vrakas pourrait aussi y répondre.
Docteur Maher, je ne sais pas si vous avez complètement répondu à la question posée par la Dre Fry. J'ai l'impression qu'il manquait des bouts à votre réponse.
Lorsqu'il s'agit d'une maladie physique et que les spécialistes essaient de trouver toutes sortes de médicaments et de traitements, complexes ou non, pour soulager la personne, on parle d'acharnement thérapeutique. En ce qui concerne la maladie mentale, ce concept existe-t-il aussi?
Est-ce qu'il arrive qu'on ne propose pas l'AMM et que l’on continue d'espérer que la personne s'en sortira un jour si on lui fait suivre plusieurs traitements, qu'ils soient expérimentaux ou non?
:
Si vous me demandez si nous essayons des traitements sans raison ou parce que nous n'avons rien à perdre, la réponse est non. Je ne me rends jamais jusque‑là. J'offre des traitements standards qui fonctionnent, et ils prennent beaucoup de temps. La guérison s'opère lentement. Si vous me demandez si les gens devraient essayer des traitements expérimentaux, je vous dirais que d'après moi, c'est un choix subjectif. Je ne force personne à faire quoi que ce soit. J'offre des traitements standards, et ces traitements fonctionnent.
Je trouve ahurissant que si le traitement n'est pas disponible et si ce n'est pas possible de consulter quelqu'un, comme la Dre Wiebe l'a dit... Personnellement, diriez-vous: « Je vais mourir parce que je n'ai pas accès aux soins dont j'ai besoin »? Ou sommes-nous des personnes privilégiées qui avons la possibilité de nous rendre aux États-Unis ou ailleurs et de payer pour obtenir des soins? On a dit à voix haute: nous allons laisser les gens mourir. C'était dans les nouvelles: nous allons laisser les gens mourir parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'appartement. D'après ce que j'ai compris de la décision de la Cour suprême et des dispositions législatives subséquentes, le caractère irrémédiable n'a rien à voir avec les ressources psychosociales. Il était question de maladies et de troubles médicaux — dans ce cas‑ci, de maladies du cerveau — ne pouvant pas être traités par des moyens médicaux.
Les portes sont rendues grandes ouvertes si ces problèmes sont maintenant considérés comme irrémédiables. C'est un exemple précis des abus auxquels la loi donnera lieu, je le crains, parce qu'il n'y a pas de surveillance. La loi ne prévoit pas que les mesures prises par les médecins et les infirmiers praticiens fassent l'objet d'une évaluation. Franchement, je suis étonné que la Dre Wiebe soit prête à laisser un patient mourir parce qu'il ne peut pas recevoir un traitement qui améliorera son état. Ce n'est pas l'esprit de la loi, à juste titre. Si la société canadienne est prête à laisser les gens mourir parce qu'ils n'ont pas accès à des appartements, franchement, je suis dégoûté. Pardonnez-moi ma passion, mais votre devoir de parlementaires est de préserver la vie.
:
Merci, monsieur le président.
Je vous remercie, monsieur le président.
Je remercie tous les témoins de leurs témoignages, mais mon temps de parole est de seulement trois minutes.
Ma question s'adresse à la professeure Vrakas.
Professeure Vrakas, vous avez parlé d'une situation de crise, de quelqu'un qui se présente à l'urgence. Évidemment, l'intervention doit être rapide. Autrement dit, il n'y a pas de temps à perdre. Cependant, lorsqu'on parle de l'accessibilité à l'aide médicale à mourir, n'y a-t-il pas lieu d'apporter des nuances?
Des mesures de protection sont déjà dans la Loi, notamment le délai d'au moins 90 jours, ce qui est quand même assez long. Ensuite, il y a des étapes. Il faut que les évaluations soient faites non seulement par une personne, mais aussi par une deuxième personne. Selon les recommandations du groupe de travail, il faudrait même que cette deuxième personne soit spécialisée dans les maladies mentales. Il faut aussi que les personnes qui font l'évaluation aient suivi une formation spécialisée dans ce domaine et travaillent collégialement avec l'équipe qui s'occupe du traitement.
Ne croyez-vous pas que le système est quand même très différent de la réaction à une situation de crise?
En situation d'évaluation, il faut plusieurs mois avant d'en arriver à la conclusion que le patient est admissible à l'aide médicale à mourir. Dans votre cas, vous avez dit que vous auriez voulu mourir, mais cela ne veut pas dire que vous auriez eu l'autorisation d'avoir accès à l'aide médicale à mourir.
:
J'aurais eu de bonnes chances d'y avoir accès, étant donné que les traitements fonctionnaient plus ou moins bien depuis 20 ans et que j'avais toujours des épisodes de dépression.
Il s'agit de deux choses différentes. Une crise ne dure pas longtemps: on est en crise et l’on va chercher de l'aide. Quand on vit avec une maladie mentale, la souffrance et les difficultés sont vécues sur une longue période. Durant cette période, on cherche de l'aide et l’on cherche à savoir si l’on y a accès. Le hic, c'est l'accessibilité aux soins.
Personnellement, je suis psychologue et je n'ai pas le choix de refuser des clients. Je viens juste de recevoir un courriel du gouvernement dans lequel on me demande d'offrir mes services au public. Il y a un besoin criant. Les gens qui souffrent n'ont pas accès à ces services.
Peu importe la façon dont on construit cela et peu importe les protocoles permettant de bien encadrer l'aide médicale à mourir, la situation reste la même. On dit à des gens comme moi et à d'autres personnes que l'aide médicale à mourir leur est offerte, qu'ils peuvent mourir, qu'on va les aider à mourir et que la mort est une possibilité. On dit que le suicide n'est pas une solution, mais que la mort assistée en est une. Cela nous envoie le message qu'il n'y a pas d'espoir.
Si l’on offre cela à quelqu'un, celui-ci va peut-être décider de s'en prévaloir, puisque cette solution est moralement et socialement acceptable. Peu importe les protocoles que l'on mettra en place, cela ne changera pas. Cela va devenir un courant de pensée majoritaire.
Je connais la Dre Gupta depuis de nombreuses années. Nous sommes collègues. C'est une psychiatre intelligente et futée, mais je dirais qu'elle détient des renseignements, et non des connaissances. Elle sera la première à vous dire qu'elle ne travaille pas avec les personnes les plus malades. Elle a aussi dit publiquement qu'à son avis, les personnes devraient suivre des traitements pendant au moins 10 ans avant de pouvoir commencer à penser qu'elles souffrent d'une maladie irrémédiable.
En ce qui a trait au mythe évoqué par la sénatrice Wallin, voulant que nous tentions de forcer des gens à suivre un traitement, je suis certain que la Dre Gupta vous dira que nous ne forçons jamais un patient apte à subir un quelconque traitement. Les patients reviennent vers nous parce qu'ils veulent de l'aide et veulent alléger leurs souffrances. Au risque d'avoir l'air insensible, je dirais que personne ne les empêche de s'enlever la vie par eux-mêmes. J'ai le cœur brisé lorsque je vous dis cela, parce que je pense à tous mes patients qui ont planifié leur propre mort de manière méticuleuse et réfléchie. Pour ce qui est du mythe selon lequel tout cela est tragique et horrible, les gens disent tout le temps... La maladie mentale est tragique et horrible. Selon une étude réalisée en Suisse, 40 % des personnes qui ont accompagné un proche mourant souffrent du trouble de stress post-traumatique ou de dépression.
Le rapport de la Dre Gupta rassemble des données probantes plausibles, mais dit aussi qu'il est impossible de déterminer si une maladie est irrémédiable. Il s'agit là d'un critère juridique clé en matière d'aide médicale à mourir. On parle du devoir d'examen et on fait valoir qu'il s'agit d'une décision éthique et non clinique. Je suis consterné de voir que la Dre Gupta a emprunté cette voie. Je me demande aussi pourquoi deux personnes se sont retirées du groupe. J'aimerais aller au fond de cette histoire. Le rapport présente plusieurs énoncés réfléchis et très sensibles, mais aucune mesure de précaution. Dans les pays du Benelux, il faut au moins avoir subi un traitement courant avant d'avoir droit à l'euthanasie. Au Canada...
:
J'aimerais faire quelques commentaires à l'intention de nos nouveaux témoins.
Veuillez s'il vous plaît attendre que je vous nomme avant de prendre la parole. Je vous rappelle que tous les commentaires doivent être adressés aux coprésidents. Je vous demande également de parler lentement et clairement. L'interprétation de la vidéoconférence fonctionne de la même façon que dans le cadre des réunions en personne. Vous avez le choix, au bas de votre écran, entre le son du parquet, l'anglais et le français. Lorsque vous n'avez pas la parole, votre micro doit être en sourdine.
Sur ce, je souhaite la bienvenue à nos témoins, qui sont ici pour discuter de l'aide médicale à mourir dans les cas de maladie mentale ou de troubles mentaux. Nous recevons d'abord la Dre Alison Freeland, qui est présidente du conseil d'administration et coprésidente du groupe de travail sur l'aide médicale à mourir de l'Association des psychiatres du Canada. Nous recevons également le Dr Mark Sinyor et le Dr Tyler Black, à titre personnel. Nous vous remercions de vous joindre à nous pour la deuxième partie de notre réunion.
Nous allons commencer par les déclarations préliminaires du Dr Sinyor, de la Dre Freeland et du Dr Black.
Docteur Sinyor, vous disposez de cinq minutes. Allez‑y.
Mesdames et messieurs les membres du Comité, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Mark Sinyor. Je suis professeur agrégé de psychiatrie à l'Université de Toronto et psychiatre au Centre des sciences de la santé Sunnybrook, qui se spécialise dans le traitement des adultes souffrant de troubles complexes de l'humeur et d'anxiété.
Ma recherche se centre sur la prévention du suicide. J'ai été vice-président du conseil de l'Association canadienne pour la prévention du suicide, auteur principal des Lignes directrices de la couverture médiatique du suicide, membre du groupe directeur de l'International COVID‑19 Suicide Prevention Research Collaboration et on m'a récemment demandé de coordonner les efforts de l'Association internationale pour la prévention du suicide en vue de créer un réseau régional de prévention du suicide dans 35 pays des Amériques.
Je dois préciser que je ne participe pas à l'évaluation des demandes d'aide médicale à mourir et que je ne la pratique pas. Je ne suis pas non plus objecteur de conscience à l'aide médicale à mourir. Par souci de transparence, je dirais que mon agenda professionnel, tant de façon générale que dans le cadre des présentes délibérations, consiste à faire de mon mieux pour contribuer à une diminution du nombre de suicides au Canada et pour protéger la psychiatrie à titre de science fondée sur les données probantes.
Comme je ne dispose que de quelques minutes, mon discours se centrera sur ce qui devrait être la question primordiale aux fins de vos délibérations. Comme vous pouvez le lire dans le rapport du Groupe d'experts, certains de mes collègues ont fait valoir que, comme pour toute autre procédure médicale, l'aide médicale à mourir pour le seul motif de maladie mentale ne devrait être permise que lorsqu'il est prouvé que ses avantages l'emportent sur ses inconvénients. Dans son rapport déposé récemment, le groupe d'expert a fait valoir qu'il avait envisagé cette possibilité, mais qu'il n'était pas arrivé à cette conclusion.
Le principe visant à ne causer aucun préjudice est le fondement de la médecine depuis des milliers d'années; il sous-tend les principes modernes de la médecine fondée sur les données probantes, qui nous demandent de procéder à une évaluation scientifique des avantages et des inconvénients de nos traitements afin de déterminer si leur prestation est éthique. Si, en tant que pays, nous allons rejeter ces idées, nous devons d'abord être conscients de ce que nous faisons et ensuite avoir une raison impérieuse de le faire.
En résumé, nous n'avons pas les données scientifiques nécessaires pour évaluer la sécurité de l'aide médicale à mourir dans les cas de maladie mentale. Si j'avais plus de temps, je pourrais vous donner de nombreux exemples, mais je vais plutôt me centrer sur l'absence totale de recherche sur la fiabilité des prédictions des médecins quant au caractère irrémédiable de la maladie ou des souffrances dans les cas de problèmes psychiatriques. À ma connaissance, il n'y en a aucune.
Les défenseurs de cette pratique disent que nous avons en place des mesures de sécurité. Si tel est le cas, c'est parce que la pratique est associée à de nombreux dangers inhérents. On ne propose pas de mesures de sécurité pour des pratiques qui sont déjà sécuritaires, mais on ne sait pas du tout à quel point ces mesures permettront de régler le problème. Personne ne vous a fait part de ces chiffres parce qu'il n'y a aucune recherche sur le sujet. Par conséquent, si les choses vont de l'avant, les évaluateurs des demandes d'aide médicale à mourir n'auront aucune idée du nombre de fois où ils se seront trompés lorsqu'ils détermineront l'admissibilité d'une personne dans le contexte de l'aide médicale à mourir ayant pour seul motif la maladie mentale. Ils pourraient se tromper dans 2 % des cas ou dans 95 % des cas. Cette information doit être à l'avant-plan de notre discussion; or, nous ne l'abordons pas du tout.
Les données probantes au sujet des préjudices associés à cette pratique, notamment en ce qui a trait à son incidence sur le suicide et sur la prévention en la matière, sont tout simplement manquantes. Rien dans la vie ou en médecine n'est certain. Tous nos traitements peuvent entraîner des avantages comme des inconvénients. En médecine, nous fonctionnons avec les probabilités. Les médecins aident les patients à prendre des décisions pour le traitement du cancer, par exemple, en leur disant qu'ils ont 90 % ou 10 % de chances de survie. Nous ne savons jamais avec certitude quel sera le résultat pour les patients, mais ces chiffres sont essentiels pour les aider à prendre une décision éclairée. Dans le cas de l'aide médicale à mourir ayant pour seul motif la maladie mentale, nous ne disposons d'aucune statistique. Nous n'aurions aucune idée — et nos patients non plus — du nombre de fois où notre jugement au sujet du caractère irrémédiable de la maladie est tout simplement erroné. C'est complètement différent de l'aide médicale à mourir dans les situations de fin de vie ou pour les maladies neurologiques progressives et incurables, où la prédiction clinique de l'irrémédiabilité est fondée sur des données probantes.
Dans le contexte de l'aide médicale à mourir ayant pour seul motif la maladie mentale, les décisions de vie ou de mort seront prises en fonction de pressentiments et de suppositions qui pourraient être complètement erronés. Les incertitudes et la possibilité d'erreur dans les situations de maladie mentale sont énormes. Par conséquent, il est impératif, sur le plan éthique, d'étudier les préjudices possibles avant de mettre en œuvre la loi.
Ce qui est déconcertant ici, c'est qu'il serait possible de réaliser les études nécessaires. Nous demandons des données probantes sur les avantages et les inconvénients des produits de santé naturels, des nouveaux médicaments et des vaccins avant de les légaliser; pourquoi sauterions-nous cette étape dans le cadre de délibérations aussi profondes que celles que vous réalisez en ce moment? Je crois que les Canadiens qui souffrent de maladies mentales méritent que nous rassemblions les renseignements scientifiques requis avant de prendre une décision aussi lourde de conséquences.
Merci. Je vous souhaite à tous santé et bien-être en cette période de pandémie.
:
Je vous remercie de m'avoir invitée à comparaître aujourd'hui. Je m'appelle Alison Freeland, et je suis psychiatre. Je suis ici à titre de présidente du conseil d'administration et co‑présidente du groupe de travail sur l'AMM de l'Association des psychiatres du Canada.
Aujourd'hui, mes remarques seront axées sur les demandes d'aide médicale à mourir fondées uniquement sur les maladies mentales afin de compléter le mémoire de l'APC qui a été envoyé au Comité il y a quelques semaines.
L'APC n'a pas pris de position officielle sur la prestation de l'aide médicale à mourir dans les cas où la maladie mentale est la seule condition médicale sous-jacente. Cela dit, nous estimons que toute nouvelle loi doit protéger les droits et les choix des Canadiens vulnérables, et cela sans stigmatiser ou discriminer indûment les personnes atteintes de maladies mentales lorsque les critères d'admissibilité sont atteints.
En évaluant des mesures de sauvegarde, l'APC s'est penché sur l'enjeu de la capacité dans son mémoire. Être atteint d'une maladie mentale ne signifie pas qu'on est incapable de prendre une décision, mais, lorsqu'actives, diverses forces de maladies mentales peuvent affecter la prise de décision et la capacité. Les psychiatres ont une formation et une expertise qui leur permettent d'évaluer, de diagnostiquer et de traiter des maladies mentales; ils peuvent notamment évaluer la capacité décisionnelle d'une personne ainsi que la durabilité, la stabilité et la cohérence de sa volonté et de ses préférences. Ils savent aussi tenir compte de toute contrainte externe ou de la psychopathologie interne qui pourraient affecter ces aspects.
Pour tous les types de conditions, il existe des iniquités dans la prestation de services et dans le financement. La situation est particulièrement problématique pour ceux qui vivent avec une maladie mentale. Ces iniquités sont encore plus exacerbées dans les régions rurales ou éloignées. Que la maladie soit d'ordre physique ou mental, ou une combinaison des deux, il faut veiller à ce que les gens aient accès à des services cliniques culturellement appropriés axés sur la science de façon juste et opportune; il s'agit là de la première mesure de sauvegarde nécessaire pour veiller à ce que les gens ne demandent pas l'aide médicale à mourir en raison d'un manque de traitements, de soutiens ou de services disponibles.
Dans le contexte des maladies mentales, il n'existe aucune définition généralement acceptée de l'incurabilité. Dans le milieu psychiatrique, certains refusent de croire qu'une maladie mentale puisse être incurable et pensent qu'il y aura toujours un autre traitement à tenter. Cet enjeu, pour être résolu, requiert une approche pragmatique qui équilibre l'expertise clinique et l'évaluation de l'incurabilité avec le point de vue du patient et son expérience face à sa maladie.
Il est important de tenir compte des déterminants socioéconomiques de la santé, qui jouent un rôle clé dans l'expérience d'une personne, que ce soit en matière de souffrance ou d'adaptabilité à la maladie mentale. Si un patient refuse sans raison valable de suivre le traitement recommandé pour sa maladie, en pesant le pour et le contre, il est peu probable qu'il remplisse le critère d'admissibilité de l'incurabilité.
L'état de vulnérabilité ne se limite pas à ceux qui sont atteints de maladies mentales. De nombreuses personnes atteintes de maladies non psychiatriques sont également vulnérables en raison de circonstances psychosociales telles que l'isolement, la pauvreté, les distorsions cognitives et la démoralisation causées par des tentatives de traitement infructueuses ou encore la difficulté à s'adapter à une vie avec la maladie. Une maladie physique peut être tout aussi imprévisible qu'une maladie mentale. Les gens peuvent perdre espoir, mais une rémission soudaine peut aussi survenir. Prédire les résultats d'un traitement est un défi aussi bien dans le milieu psychiatrique que dans le reste du milieu médical.
Il faut prendre en compte et évaluer les idées suicidaires, qu'elles soient aiguës ou chroniques, afin de déterminer au mieux si le désir du patient de mettre fin à ses souffrances représente une évaluation réaliste de la situation, plutôt qu'un symptôme potentiellement traitable de sa maladie mentale. Une demande d'aide médicale à mourir devrait découler d'un processus réfléchi et soutenu, et non pas d'un désir transitoire ou impulsif. Cela est particulièrement important pour ceux qui sont atteints de maladies non terminales, comme une maladie mentale à caractère épisodique.
Par conséquent, indépendamment de toute évaluation d'admissibilité à l'aide médicale à mourir, il est essentiel qu'au moins un psychiatre indépendant effectue une évaluation clinique exhaustive pour déterminer si le patient a reçu un diagnostic exact et a eu accès à une évaluation, à un traitement et à du soutien en matière de santé mentale fondés sur la science pendant une durée adéquate selon les normes de soin généralement acceptées.
Merci beaucoup. Je serai heureuse de tenter de répondre à vos questions.
:
Je vous remercie de me donner l'occasion de donner mon point de vue.
Je suis un médecin avec 14 ans d'expérience tertiaire en psychiatrie d'urgence impliquant la suicidalité, et je suis aussi un chercheur, un professeur, ainsi qu'un expert sur le suicide et la suicidologie.
Il est très important de noter que ce que la majorité des gens considèrent comme un suicide diffère grandement de la plupart des expériences d'aide médicale à mourir. Je vous ai envoyé un mémoire sur de nombreux mythes qui comparent le suicide à l'aide médicale à mourir, et j'espère qu'il vous a été utile. J'aimerais souligner trois points que j'avais soulevés en particulier.
Premièrement, les motivations pour l'aide médicale à mourir et le suicide sont rarement les mêmes. Pour ce qui est du suicide, il est très rare d'avoir une combinaison de motivation fataliste, qui est une réponse contrôlée à un stress perçu, d'absence convenue de remède et de calcul rationnel sur la probabilité du changement, alors que c'est presque toujours le cas dans le contexte de l'aide médicale à mourir. Dans la littérature, les psychiatres s'entendent généralement sur la souffrance insupportable du patient et l'inutilité du traitement dans les cas psychiatriques d'aide médicale à mourir dans les pays où cet enjeu a été étudié.
Deuxièmement, le désir de mourir ne signifie pas qu'on est atteint d'une maladie mentale. Bien que la suicidalité fasse partie des neuf critères de la dépression, il n'existe aucun diagnostic de maladie mentale grave dans 40 à 50 % des cas de suicide. Parmi ceux qui ont des idées suicidaires, nombreux sont ceux qui n'ont pas de diagnostic de maladie mentale, et la majorité ne se suicide pas.
Troisièmement, les évaluations sur la capacité sont un élément essentiel de la formation en psychiatrie. Il s'agit probablement de l'aspect le plus réalisable et le moins controversé de ces discussions, et ce n'est pas non plus un enjeu qui soulève particulièrement la controverse dans le milieu psychiatrique.
En ce qui concerne l'enjeu plus large et complexe des cas psychiatriques d'aide médicale à mourir, je suis rassuré par une approche qui m'aide dans ma vie clinique. La plupart de mes patients me sont envoyés par d'autres psychiatres ou médecins qui sont à la recherche de soins et d'expertise pour des cas complexes. Je suis leur psychiatre tertiaire. Les médecins de première ligne suivent des consignes ou des algorithmes, ce qui est rarement mon cas. En fait, le livre d'algorithmes pour mon métier serait minuscule.
J'ai rarement une réponse parfaite à offrir. J'enseigne et je pratique une médecine fondée sur la science et des principes. Pour ce qui est de la médecine fondée sur la science, nous utilisons les meilleures preuves dont nous disposons à un moment donné. Nous appliquons le principe de la plausibilité dans notre expertise et reconnaissons l'importance de mettre à jour nos informations à mesure que de nouvelles et excellentes informations sont découvertes.
À cet égard, certains pays ont des décennies d'expérience en matière d'aide médicale à mourir pour des maladies physiques et psychiatriques. Pour ce qui est des cas psychiatriques, la pratique semble bien acceptée et ne représente qu'une infime fraction des morts par aide médicale à mourir, soit de 1 a 2 %. Compte tenu du nombre de personnes ayant des pensées suicidaires, la peur que la décision de permettre la prestation d'aide médicale à mourir pour des maladies psychiatriques mène à une avalanche de décès au Canada n'est tout simplement pas justifiée.
Une étude a estimé que les adultes aux Pays-Bas avaient 8 % de risque d'avoir des pensées suicidaires au cours de leur vie. Or, 65 adultes reçoivent l'aide médicale à mourir pour des raisons psychiatriques chaque année aux Pays-Bas, ce qui représente 0,0004 % de la population adulte.
En ajoutant les procédures qui devraient être en place pour l'aide médicale à mourir, il est nettement moins probable que les conclusions en la matière soient hâtives et pas assez réfléchies. J'ai aussi soumis des preuves au Comité concernant un examen des études sur les cas psychiatriques d'aide médicale à mourir dans divers pays.
Pour ce qui est de la médecine fondée sur des principes, on utilise une liste de principes pour prendre des décisions. Je tiens compte de nombreux principes pour les cas psychiatriques d'aide médicale à mourir. Premièrement, nous devons respecter l'autonomie de nos patients, surtout lorsque nous avons déterminé qu'ils ont la capacité de prendre des décisions par eux-mêmes.
Deuxièmement, nous devons être conscients du racisme et du capacitisme systémiques et du manque d'accès aux soins en santé mentale au Canada. Personne ne devrait jamais choisir de recevoir l'aide médicale à mourir en raison d'un système qui lui inflige du racisme ou du capacitisme ou qui limite sa capacité à avoir accès à des soins en santé mentale de qualité.
Troisièmement, nous ne devons pas faire de la discrimination à l'encontre de personnes atteintes de maladies mentales ou de troubles psychologiques.
Quatrièmement, ce ne sont pas toutes les conditions qui répondent nécessairement aux traitements. Aucun traitement en psychiatrie n'a un taux de guérison de 100 %, et, comparée à d'autres spécialités, la psychiatrie a été terriblement lente à accepter la notion médicale qui veut que certaines personnes ne répondent pas positivement aux traitements, et ce pour diverses raisons connues et inconnues. Pour certains, un traitement peut être une expérience misérable dépourvue de quelconque avantage.
Cinquièmement, la psychiatrie a un long héritage de paternalisme, et l'expertise des médecins et l'expérience des patients doivent pouvoir se recouper pour la prise de décisions. Enfin, un médecin ne devrait se servir que de son opinion professionnelle, et non de ses croyances personnelles, pour influencer la prise de décisions en matière de santé d'un patient.
Je peux m'imaginer un système au Canada qui honore les meilleures données scientifiques et principes dont nous disposons à ce sujet, et c'est pourquoi, bien que prudent, j'y suis généralement favorable.
Merci.
J'estime qu'il y a quelques points clés à soulever. Tout d'abord, la loi ne traite pas uniquement des maladies incurables, mais aussi de la souffrance incurable et intolérable. Or, il n'existe pas de définition scientifique pour la souffrance incurable et intolérable. Un article paru le mois dernier dans le Journal de l'Association médicale canadienne réclamait qu'une telle définition soit établie, ce qui nous permettrait d'étudier l'enjeu. Il est important que vous sachiez qu'il n'existe pas de définition scientifique pour le concept sur lequel nous tentons de nous pencher. C'est ce qui explique entre autres le manque d'études à ce sujet.
Je pense que nous devons examiner bien d'autres facteurs au‑delà... Il y a non seulement l'enjeu de l'irrémédiabilité des troubles psychiatriques, mais aussi de l'irrémédiabilité de la souffrance psychiatrique. Bien que je sois d'accord avec les autres témoins pour dire qu'il existe des maladies psychiatriques pour lesquelles il est impossible de guérir la maladie sous-jacente, cela diffère de l'idée de savoir s'il est possible d'offrir un traitement qui pourrait soulager la souffrance causée par la maladie. À ce que je sache, aucune étude d'ordre général ou psychiatrique ne s'est jamais penchée sur cet enjeu précis.
On aurait aussi besoin d'un grand nombre d'études sur le suicide et la prévention du suicide. Nous venons d'entendre à juste titre, par exemple, que certains se demandent si l'aide médicale à mourir peut être considérée comme un suicide ou non. Certains estiment que c'est exactement la même chose, d'autres que c'est entièrement différent. La vérité se trouve probablement entre les deux. Évidemment, dans le cas des maladies mentales, il faut penser au fait qu'il peut y avoir un chevauchement important. Essayer de quantifier le degré de ce chevauchement et le degré des messages...
Je dirai simplement que mes recherches ces jours‑ci sont surtout axées sur les messages publics. Les recherches ont démontré que lorsqu'on envoie le message dans la société qu'il est possible de suivre un traitement et de recevoir de l'aide lorsqu'on a de la difficulté à vivre avec une maladie mentale, moins de gens se suicident. Lorsque les médias font des reportages sur le fait que les gens vont mettre fin à leurs jours s'ils vivent des moments difficiles, le taux de suicide augmente. Le degré d'influence des reportages médiatiques et de ce type de changement culturel mériterait d'être étudié, tout comme les répercussions sur la relation médecin-patient et la perception de la population face à la psychiatrie.
Je dirais que la dernière chose qui vaudrait probablement la peine d'être étudiée serait une analyse économique des éléments dissuasifs pervers potentiels. Évidemment, si on va de l'avant, on voudrait réinjecter tout argent épargné grâce à l'aide médicale à mourir dans le système de soins en santé mentale. Il est possible, bien sûr, qu'il y ait des éléments dissuasifs pervers à l'investissement. Si on n'investit pas, plus de gens auront ce qui semble être une maladie irrémédiable et recevront l'aide médicale à mourir. Notre système de santé ne fera alors qu'empirer, ce qui serait un désastre complet. Je pense que nous nous entendons tous là‑dessus.
Il serait d'utile d'avoir accès à de telles études avant d'aller de l'avant.
:
Je vous remercie de la question.
Si j'ai bien compris la question, vous voulez savoir si consacrer plus de temps aux déterminants socioéconomiques et leur incidence sur la façon dont les gens composent avec leurs problèmes de santé permettrait d'éviter le recours à l'aide médicale à mourir comme solution.
Vous savez, je pense, du point de vue de l'APC, encore une fois, que dans la réflexion sur les traitements, la notion d'interventions biopsychosociales pour traiter la maladie mentale occupe une partie très importante et fait partie des soins fondés sur des données probantes. Nous pensons à l'évaluation et au traitement des symptômes biologiques de la maladie grâce à une diversité de mesures et de traitements, tout en pensant aux mesures psychologiques et en tenant compte du contexte social dans lequel vit une personne.
De façon générale, l'accès adéquat d'une personne à une équipe de traitement pouvant fournir des interventions biopsychosociales devrait nous aider à assurer la prestation des meilleurs soins possibles, ce que nous souhaitons tous faire lorsqu'une personne éprouve des problèmes de santé physique ou mentale et pense mettre fin à sa vie en raison de la nature de ses expériences.
Comme je l'ai indiqué, une des premières et principales mesures de sauvegarde est de veiller à ce que les gens aient un bon accès aux traitements. Cela dit, il est toujours possible qu'indépendamment des soins qu'une équipe de traitement peut offrir, elle ne puisse satisfaire aux besoins particuliers d'un patient en raison de circonstances particulières de son vécu ou parce qu'il se trouve dans une situation unique. Si l'on considère qu'il s'agit de la seule façon d'essayer de réduire le recours à l'aide médicale à mourir, je ne crois pas que ce soit possible. À mon avis, c'est précisément pour cela que nous devons examiner ces choses de manière très holistique et les considérer comme faisant partie intégrante des mesures de sauvegarde. Nous devons faire de notre mieux pour guider les gens vers l'espoir et la guérison, puis réfléchir aux mesures de sauvegarde nécessaires pour nous assurer que les gens ne considéreront pas l'aide médicale à mourir comme une option trop rapidement.
:
Merci beaucoup, madame Freeland.
Je vais poser une question simple, et j'aimerais bien que les trois témoins y répondent s'ils ont suffisamment de temps.
À quelques reprises, lors de nos discussions, nous nous sommes demandé si les experts et la science étaient en mesure de faire une différence nette entre un état suicidaire et une souffrance inadmissible. Il me semble qu'il y a là une question fondamentale.
Madame Freeland, est-on capable de dire à un patient, à une personne, qu'elle se trouve dans un état suicidaire ou qu'elle vit une souffrance inadmissible? Est-on capable de faire la part des choses de manière raisonnable, mais surtout sur une base scientifique?
Docteure Freeland, je vous remercie sincèrement de vous attaquer à la question de savoir qui détermine si la souffrance est intolérable.
Si je comprends bien, vous êtes d'avis que la souffrance telle que la vit une personne apte déterminera sa décision. Un psychiatre doit offrir toutes les options au patient, mais c'est cette personne — si elle est apte —, et non pas le psychiatre, qui décide de l'issue.
Certains ont soulevé des préoccupations selon lesquelles des psychiatres n'accepteront jamais que la souffrance d'un patient soit irrémédiable. Dans une telle situation où le psychiatre croit que la souffrance du patient n'est pas irrémédiable et veut que le patient persévère alors que celui‑ci affirme qu'il n'en peut plus, qu'arrive‑t‑il à la relation? Quelle voie devrait-elle prendre?
:
Je crois que dans ce genre de situations tendues...
Je dirais, en guise de préambule, que ces décisions sont idéalement prises d'un commun accord puisque le patient écoute la perspective et les conseils du psychiatre, dont le rôle est de réfléchir à l'espoir et au rétablissement. Parallèlement, il faut écouter la perspective et les souhaits d'un patient apte afin de prendre une décision pour son avenir qu'il trouvera convenable.
Lorsqu'un patient croit qu'un praticien ne lui apporte pas ce dont il a besoin, la solution qui s'offre à lui est comparable à ce qui est offert aux patients vivant une situation difficile dans un autre domaine de la santé. Il est possible de demander de l'aide, une deuxième opinion ou une réévaluation, ou même de parvenir à une décision commune quant aux prochaines étapes, puis d'obtenir une deuxième opinion.
Je crois qu'il y a différentes solutions, mais idéalement ces conversations sont transparentes, éclairées et entre deux personnes qui se soucient des résultats, du traitement et des soins du patient.
Je remercie tous les témoins. Nous allons nous préparer à notre prochaine séance, mais je voulais vous remercier au nom de tous les membres du Comité de vos témoignages d'experts, de votre vive franchise, de vos déclarations préliminaires et de vos réponses à nos questions sur un dossier épineux que nous prenons très au sérieux.
Vos perspectives d'experts sont d'une aide inouïe. Merci énormément de nous avoir consacré du temps aujourd'hui en dépit de vos horaires chargés.
Sur ce, nous allons suspendre cette séance. Comme vous le savez, chers collègues, nous devons permettre aux interprètes et à d'autres membres du personnel de faire une pause, alors nous reprendrons avec le témoignage de la Dre Gupta à 16 h 30.
Merci à tous. La réunion est suspendue temporairement.
:
Bon retour, chers collègues.
Nous recevons maintenant un témoin très spécial pendant une heure et demie. Nous accueillons la présidente du groupe de travail du groupe d'experts sur l'AMM et la maladie mentale, la Dre Mona Gupta. Je ne sais pas si elle est accompagnée de collègues, mais je la vois en ligne.
La discussion avec notre invitée durera une heure et demie. Le format sera ainsi quelque peu différent qu'à l'habitude. Après la déclaration préliminaire de cinq minutes de la Dre Gupta... En fait, je me suis trompée. Nous allons reprendre l'ordre d'interventions d'origine. Nous n'avons jamais réussi à nous rendre à la deuxième série de questions, comme vous le savez. La première série de questions sera avec les députés et les sénateurs, puis la deuxième série donnera trois minutes aux conservateurs et aux libéraux, et deux minutes au Bloc québécois et au NPD. Nous ne nous sommes jamais rendus à la deuxième série de questions, mais, comme nous disposons d'une heure et demie, nous serons en mesure de donner la parole à tous les intervenants prévus.
Docteure Gupta, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de l'expertise que vous apportez à la discussion. Vous disposez de cinq minutes pour votre déclaration liminaire. Vous avez la parole.
:
Merci beaucoup, madame la présidente.
Je suis heureuse de comparaître devant vous au nom du Groupe d'experts sur l'AMM et la maladie mentale, qui a été créé en vertu du projet de loi et dont le rapport final a été déposé au Parlement du Canada le 13 mai 2022.
Je suis médecin-psychiatre et chercheuse régulière en philosophie et éthique de la psychiatrie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Dans ma pratique clinique, je travaille en psychiatrie médicale, le sous-domaine consacré aux soins psychiatriques pour les personnes atteintes d'autres problèmes médicaux. J'ai été impliquée dans des cas de personnes qui demandaient l'AMM, principalement comme consultante en psychiatrie et parfois comme évaluatrice de la demande.
Dans cette présentation, je vais faire un survol du raisonnement derrière les recommandations du Groupe. Je pourrai donner plus de détails sur ce raisonnement pendant la période de discussion, au besoin.
Rapidement, j'aimerais dire quelques mots sur le choix des termes. Malgré le fait que notre mandat utilisait l'expression « maladie mentale », le Groupe a choisi d'utiliser le terme « trouble mental », parce que c'est un terme normalisé en médecine. Dorénavant, je vais donc utiliser l'expression « trouble mental ».
Notre mandat était de faire des recommandations concernant des sauvegardes, des protocoles et des directives pour les demandes d'AMM faites par des personnes atteintes de troubles mentaux, et non de tenir un débat pour savoir si ces personnes devraient y avoir accès. Néanmoins, nous avons pris très au sérieux les enjeux soulevés par ceux qui s'opposent à cette pratique. Je parle des enjeux soulevés dans le rapport, par exemple: l'incurabilité d'un problème médical, l'irréversibilité du déclin des capacités, l'aptitude à prendre une décision pour avoir l'AMM, les tendances suicidaires et la vulnérabilité structurelle.
[Traduction]
Lorsque nous avons entamé notre travail, nous avons d'abord remarqué que les personnes souffrant de troubles mentaux demandent maintenant l'AMM et y ont accès. Parmi ce groupe, on compte tout un éventail de demandeurs: des personnes dont le trouble mental est stable; des patients dont les problèmes psychiatriques et physiques sont actifs et motivent conjointement la demande d'AMM; et, à l'extrémité du spectre, des personnes dont les demandes sont principalement motivées par leur trouble mental, mais qui ont également un autre problème de santé admissible. Ces demandeurs ont dans certains cas des comportements suicidaires depuis longtemps. On peut s'interroger sur leur capacité à prendre des décisions. Ils se trouvent peut-être aussi dans des situations de vulnérabilité structurelle.
Une deuxième observation connexe que nous avons faite est que certains patients qui demandent et obtiennent l'AMM à l'heure actuelle ont des problèmes de santé dont il est difficile d'évaluer l'incurabilité et l'irréversibilité du déclin. C'est notamment le cas de certains demandeurs souffrant de douleur chronique.
En se fondant sur ces observations, le groupe d'experts a conclu qu'il n'existe pas de problème caractéristique unique touchant toutes les personnes atteintes de troubles mentaux et seulement les personnes atteintes de troubles mentaux. L'expression « troubles mentaux » n'est qu'un terme imprécis pour désigner ces problèmes. Si on espère éviter de devoir aborder ces questions difficiles en empêchant les personnes dont le trouble mental est le seul problème médical invoqué pour avoir accès à l'AMM, l'expérience clinique en matière d'AMM nous apprend que nous faisons fausse route. Nous nous heurtons déjà à ces problèmes concrètement. C'est ce qui explique pourquoi l'approche du groupe d'experts consiste à tenter d'aborder ces problèmes de front.
En examinant attentivement les préoccupations liées à l'AMM pour les troubles mentaux, nous avons constaté qu'elles sont de nature clinique. J'entends par là que les difficultés se manifestent lorsque des médecins cliniciens doivent appliquer des termes juridiques aux évaluations en matière d'AMM: il est par exemple complexe d'interpréter le mot « incurabilité » pour un problème de santé précis, tout comme il est difficile d'évaluer les comportements suicidaires chroniques.
Ce qui semble nécessaire pour répondre à ces préoccupations est de travailler davantage sur l'applicabilité des critères d'admissibilité et sur l'élaboration de meilleures approches pour évaluer certains enjeux problématiques particuliers de la pratique clinique. Le groupe d'experts a tenté de faire une partie de ce travail d'élaboration et de définition dans ses recommandations.
Ce processus d'élaboration et de définition a également permis au groupe d'experts de préciser que, pour qu'un trouble mental soit considéré comme un état pathologique grave et irrémédiable au sens du Code pénal, il doit être de longue date, et la personne qui en souffre doit avoir reçu de nombreux traitements et bénéficié abondamment de mesures de soutien social. L'aide médicale à mourir n'est pas destinée aux personnes en crise ou à celles qui n'ont pas eu accès aux ressources sanitaires et sociales.
Je vais m'arrêter là. Je serais très heureuse de poursuivre la discussion avec vous.
:
Merci, madame la présidente.
Soyez la bienvenue, madame Gupta.
Je vous remercie de nous avoir fourni toute cette information à titre de présidente du Groupe d'experts sur l'AMM et la maladie mentale.
Les gens qui vous font face aujourd'hui sont des députés, des sénateurs et des sénatrices. Ultimement, nous sommes des législateurs et nous n'avons pas tous votre expertise en psychiatrie.
Nous traitons des troubles mentaux comme seule condition pour faire une demande d'aide médicale à mourir. Je ne peux pas dire dans quelle proportion les psychiatres sont pour ou contre, mais nous entendons des arguments très contradictoires de la part de ces professionnels.
Cela dit, il semble y avoir un consensus au sein de la profession selon lequel on peut très bien faire la distinction entre quelqu'un qui a des tendances suicidaires et quelqu'un qui n'en a pas, même s'il s'agit d'une personne qui souffre uniquement de troubles mentaux. Ai-je bien compris?
:
C'est intéressant. Comme vous l'avez déjà entendu dans les autres témoignages, il y a un débat dans la documentation scientifique cherchant à établir si le fait de vouloir l'AMM est la même chose qu'être dans un état suicidaire. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Dans le rapport, nous avons pris note de cette divergence dans la documentation scientifique. Je vais enlever mon chapeau de présidente du Groupe pour parler de mes propres travaux en tant que chercheuse au sein de notre groupe de recherche. Je n'analyserai pas cette question de cette façon, c'est-à-dire en tentant de déterminer si on peut distinguer ces deux états. Je vais plutôt demander si on sait comment réagir quand on juge que quelqu'un présente un risque suicidaire et quand ce n'est pas le cas.
Pour y répondre, je vais me fier à d'autres sphères de la médecine. Par exemple, certains patients vont faire des choix qui vont certainement mener à la fin de leur vie, par exemple, en cessant leurs traitements. Doit-on considérer que tous ces patients sont suicidaires, les hospitaliser contre leur gré et les forcer à continuer leur traitement? Dans certains cas, oui, et dans d'autres cas, non. Sur quels principes et sur quelles pratiques doit-on se baser pour prendre ces décisions?
Je remets maintenant mon chapeau de présidente du Groupe. Nous nous basons sur ces mêmes principes et ces mêmes pratiques pour évaluer le cas d'une personne qui demande l'AMM. Doit-on agir, même si cela va à l'encontre de la volonté du patient, ou s'agit-il plutôt d'évaluer son aptitude à prendre une telle décision?
Votre question touche plusieurs éléments. Je vais essayer d'y répondre au mieux.
D'abord, la position du Groupe, c'est que le mot « irrémédiable » n'est pas un mot clinique. C'est un mot qui se trouve dans le Code criminel et qui est basé sur trois sous-critères: l'incurabilité de la condition, le déclin avancé et irréversible des capacités et la souffrance. Tous ces termes ont un sens clinique. On peut donc essayer de comprendre ces mots-là et de les définir d'une façon qui a du sens pour les cliniciens et qui correspond à ce que nous faisons dans notre pratique et à ce que les patients reçoivent comme traitements.
Je pense qu'une grande partie du débat entre ceux qui disent qu'on ne peut pas dire qu'une maladie est irrémédiable et ceux qui disent que c'est possible est due au fait qu'ils utilisent des définitions différentes. C'est pour cela que, dans le rapport, le Groupe a essayé de proposer une définition de « maladie incurable » dans le contexte des troubles mentaux qui pourrait avoir du sens dans un contexte clinique.
Bien sûr, nous savons maintenant qu'il existe des maladies que nous ne réussirons jamais à guérir. Nous en sommes certains à 100 %. Toutefois, il y a beaucoup d'autres maladies sur lesquelles nous en savons moins, notamment en ce qui concerne leur évolution à long terme. Dans ces cas-là, quel est le niveau de certitude nécessaire? C’est dans les détails que le bât blesse. Grosso modo, voici ce que nous en pensons. Si on doit réfléchir à ce qu'est un état incurable et qu'on fait un parallèle avec d'autres maladies chroniques, on peut dire que le seuil est atteint une fois qu'on a épuisé tous les traitements conventionnels. Cela vient rejoindre votre commentaire sur l'arrêt Carter.
Comme le Dr Maher l'a dit tantôt, on ne forcera certainement pas les gens qui ont toute leur tête à faire des choses qui sont inacceptables pour eux. En même temps, si je dois constater que quelqu'un a une maladie incurable, comment puis-je procéder s'il n'a essayé aucun traitement? Combien de traitements devrait-on avoir essayés? Cela dépend de l'entente négociée entre le clinicien et le patient.
:
Cependant, dans le cadre de la révision de la Loi, on devait déterminer si on appliquait ou non la mesure de temporisation ou si on enlevait totalement cette possibilité. Il me semble qu'il aurait été intéressant que cette discussion ait lieu au sein du Groupe d'experts sur l'aide médicale à mourir et la maladie mentale. La situation fait que le Québec ne veut pas aller de l'avant. Si on allait de l'avant, on aurait probablement des problèmes d'applicabilité sur le terrain. On verra ce qui se passera.
Selon l'Association des psychiatres du Canada, et selon ce qu'on retrouve cela dans votre rapport, pour établir qu'une personne ayant une maladie mentale répond au critère d'incurabilité, il faut prendre en considération trois critères, soit la chronicité du trouble, la portée des tentatives antérieures de traitement, donc, l'efficacité des traitements, et le refus de traitement de la personne. J'imagine qu'il faut évaluer s'il s'agit de refus répétés ou de refus qui ont un effet sur l'évaluation qui doit être faite.
Des gens disent qu'il n'y a aucun trouble mental incurable, en aucune circonstance. Évidemment, ce n'est pas ce que vous dites. Cela dit, tous les patients ont le droit de refuser un traitement. Quel rôle ce droit joue-t-il dans l'évaluation que vous faites pour établir qu'une personne répond au critère d'incurabilité? Dans le cas d'un patient qui a refusé ou qui refuse un traitement, est-ce qu'on pourrait conclure qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour se faire soigner? Auquel cas, cela exclut-il l'admissibilité du patient?
On dit que, dans certaines situations, la maladie mentale est incurable. Il y a aussi une souffrance qui vient avec cela.
:
Je vous remercie beaucoup de votre question.
Je vais faire une petite digression pour aborder un sujet plus clinique et technique.
Dans le cas de certaines maladies paradigmatiques comme un cancer avancé, lorsqu'on obtient le bon diagnostic au moyen d'une biopsie ou d'une imagerie par résonance magnétique, par exemple, on peut savoir d'emblée ce qui va arriver au patient.
Cependant, pour d'autres maladies, au moment du diagnostic, on ne peut pas savoir comment cela va évoluer. Cela va dépendre du traitement que la personne va suivre, de sa réponse au traitement et des effets secondaires, entre autres. On ne peut pas faire beaucoup de prévisions sans avoir essayé le traitement.
C'est pour cette raison que, dans le rapport, nous essayons d'arrimer la nécessité d'avoir essayé des traitements pour pouvoir établir que la trajectoire de la maladie est sombre et la nécessité de respecter le fait qu'une personne a déjà expérimenté beaucoup de traitements et qu'elle en a assez. Où trace-t-on cette ligne exactement? Je pense que cela va différer d'une personne à l'autre. Il faut aussi prendre en considération son état de santé général et les circonstances entourant son cas.
:
Je vais répondre brièvement à la question, mais on pourra revenir sur le sujet plus tard.
Je pense que c'est faisable. En ce moment, lorsqu’une personne atteinte d'une maladie complexe fait une demande d'aide médicale à mourir, on demande l'avis des spécialistes.
Je vais donner un autre exemple, avec lequel nous pouvons faire un parallèle.
Lors des évaluations relatives à la garde en établissement, la loi exige que l'on ait l'avis de deux psychiatres, et non pas celui d'un seul psychiatre, et ce, peu importe qu'on soit le jour, la semaine ou la fin de semaine, or on s'assure que cela se fait. Ces patients sont malades et ils sont les plus vulnérables. Selon moi, on peut créer une structure qui va bien encadrer leur demande.
:
Merci beaucoup, madame la coprésidente.
Docteure Gupta, je vous remercie beaucoup de vous joindre à notre comité aujourd'hui et de nous aider à nous y retrouver quant à ces questions très difficiles. J'apprécie le rapport auquel nous devons désormais nous référer pour amorcer notre étude.
Je suis membre du Parlement depuis 2015. J'étais présent lors des débats sur les projets de loi et . Pour moi, le problème avec tout ce processus, c'est qu'il semble qu'avec les amendements qui ont été apportés par le Sénat au C‑7, on pourra effectivement évoquer la maladie mentale comme condition sous-jacente d'ici mars de l'année prochaine. Voilà encore une situation où nous avons mis la charrue devant les bœufs. Nous sommes engagés dans cette étude très approfondie, mais nous travaillons avec une date limite imminente qui est maintenant dans moins d'un an. Vous avez beaucoup parlé du fait que nous devons nous assurer que toutes les options sont sur la table.
Or, avant de passer aux questions complémentaires, ma première question est la suivante: comment était‑ce pour le groupe d'experts de travailler en sachant qu'il avait cette échéance? Avez-vous senti de la pression? Quelle incidence cela a‑t‑il eue sur votre travail, sachant qu'en mars de l'année prochaine, cela fera partie du Code criminel et sera autorisé?
:
Merci de cette réponse.
Dans vos échanges avec certains de mes autres collègues du Comité, vous avez parlé du fait que nous devons vraiment nous assurer de disposer des ressources nécessaires pour que les patients puissent se prévaloir de toutes les options de traitement. Dans des témoignages précédents, nous avons entendu parler de « recherches révolutionnaires » sur l'utilisation de la psilocybine en tant que traitement pour aider les gens à surmonter leurs problèmes de santé mentale. Je sais que cette recherche en est encore à ses débuts.
Je suis conscient que les futurs patients qui auront accès à l'aide médicale à mourir seront encadrés par des mesures de sauvegarde. Ils devront avoir un historique complet. Or, quand je regarde autour de moi, dans mon propre milieu, et que je vois tant de personnes qui vivent dans la rue et qui souffrent manifestement de détresse mentale, cela me préoccupe. Je me demande sans cesse: que serait‑il arrivé si elles avaient bénéficié d'interventions précoces? Cela aurait‑il pu les empêcher de se retrouver dans un état à ce point sérieux qu'elles ne voient plus comment s'en sortir?
Je sais que le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place une grande stratégie en matière de santé mentale, mais pourriez-vous nous parler un peu de ce qu'il faut faire de plus pour combler les lacunes? Ces derniers temps — en particulier ces deux dernières années —, les projecteurs ont été braqués sur ce problème qui touche de nombreuses collectivités comme la mienne.
:
C'est une très bonne question, une question importante. Je tiens d'abord à dire que je ne suis d'aucune façon une experte de l'administration ou du financement des services de santé mentale.
Pour faire le lien entre votre question et le sujet qui nous occupe, je pense que nous devons tenir compte du fait que les personnes qui souffrent de troubles mentaux ne constituent pas un groupe homogène. Il existe des sous-groupes. Très souvent, dans le débat public et politique sur l'aide médicale à mourir, nous faisons un amalgame entre les personnes qui souffrent d'affections graves, celles qui sont malades depuis des décennies, celles qui ont reçu beaucoup de traitements et qui sont suivies de près, et les personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux ressources de première ligne pendant les périodes de détresse, les périodes de difficultés personnelles ou, peut-être, au début d'une maladie alors que leur affection n'est pas encore très avancée.
Je ne pense pas que cela réponde tout à fait à votre question, mais en réfléchissant à ce qui est nécessaire pour combler les lacunes, il faut penser à ces différents sous-groupes, car je considère que les besoins en matière de services diffèrent beaucoup de l'un à l'autre. Je sais que ce n'est pas quelque chose que l'on entend souvent, mais je vais le dire quand même: il y a au Canada des patients qui reçoivent d'excellents soins. Je suis certaine que les patients du Dr Sinyor qui sont dans un centre de soins tertiaires à Toronto et les patients du Dr Maher reçoivent d'excellents soins.
Une partie du problème consiste à établir où sont les lacunes et à reconnaître qu'il n'est probablement pas nécessaire d'adopter une grande stratégie en matière de santé mentale et de dépenser beaucoup d'argent, mais plutôt de cibler le financement de différents types de services pour différents sous-groupes.
:
Merci, monsieur le président.
Madame Gupta, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui.
J'ai pris connaissance des recommandations du groupe d'experts. La recommandation 16 a trait à la surveillance prospective, la recommandation 18 porte sur la collecte de données et la recommandation 19 concerne les recherches périodiques.
À votre avis, comment le fédéral pourrait-il s'organiser?
Devrait-il y avoir des comités qui se penchent sur la surveillance prospective et la collecte des données? Quant aux recherches périodiques, elles seraient faites par période. Quelles seraient ces périodes?
Comment pourrions-nous arrimer tout cela?
:
Je vous remercie beaucoup de votre question.
Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. La recherche peut être centralisée dans les trois bureaux du Conseil national de recherches Canada. Ils peuvent lancer les appels pour les projets libres ou pour les projets sur des sujets ciblés.
Ces recherches peuvent être greffées aux collectes de données faites par Santé Canada. Dans le rapport, nous avons proposé que les nouvelles variables soient intégrées au système de surveillance existant. Greffer les recherches à la collecte de données est quelque chose qui se fait déjà aux Pays‑Bas. À ce jour, le Canada a un système qui est davantage centré sur les appels de projets sur des sujets ciblés ou libres. Je pense donc que cela peut être fait de diverses façons.
On parle de la surveillance prospective, mais la surveillance est un champ de compétence provincial. Pour le moment, c'est comme cela. Je pense que le gouvernement fédéral peut jouer un rôle de coordination pour s'assurer que les provinces et les territoires peuvent développer des systèmes de surveillances prospectives. Dans le rapport, nous avons noté qu'il s'agissait d'une demande des psychiatres. Un tel système de surveillance leur permet de bien faire leur travail et d'avoir un regard extérieur. Ainsi, on leur assure qu'ils ont fait les évaluations comme il faut, étant donné les complexités.
:
Merci de cette question.
Nous étions conscients du fait qu'il ne nous appartenait pas d'assumer de nombreux nouveaux mandats différents. En même temps, et comme j'ai essayé de le présenter dans ma déclaration liminaire, notre analyse nous a amenés là, parce que les choses qui inquiètent les gens quant à la pratique de l'aide médicale à mourir ne se limitent pas aux troubles mentaux. Nous étions un peu coincés et nous avons dit que ces choses sont vraiment importantes, mais qu'elles ne sont pas seulement importantes pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Elles le sont chaque fois que vous vous questionnez sur l'incurabilité d'une affection.
Ce que nous présentons est une approche. Chaque fois que vous avez à vous pencher sur la suicidalité d'une personne, voici une approche et une façon d'y penser. J'espère que nos recommandations seront considérées comme utiles dans le cadre du 2e volet, et même dans le cadre du premier. La suicidalité existe dans le 1er volet, comme c'est aussi le cas des questions de capacité.
Merci de cette question et, oui, c'était bel et bien ce que nous espérions en tant que groupe d'experts.
:
Merci de cette réponse.
Plus précisément, il est surprenant que la sénatrice Mégie, qui est également médecin, ait insisté sur les trois mêmes points au sujet desquels je vais maintenant vous interroger: le cadre national de surveillance protectrice, le cadre d'examen des cas et l'importance pour le ministère de la Santé d'ajouter les éléments de recherche évoqués dans votre rapport.
Seriez-vous d'accord pour que le commence à intégrer ces éléments dès maintenant?
Ensuite, en ce qui concerne les deux autres points, à savoir la surveillance protectrice et l'examen des cas, pensez-vous qu'il serait possible pour le gouvernement fédéral de convoquer les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les autres intervenants concernés afin de faire avancer les choses immédiatement?
:
Merci, monsieur le président.
Docteure Gupta, je vous remercie de votre participation, et je vous remercie surtout d'avoir présidé un comité qui a fait un rapport important.
La présidente de l'Association des psychiatres du Canada a témoigné juste avant vous. Vous l'avez peut-être écoutée. Elle disait que, afin d'améliorer votre rapport, il faudrait établir des normes nationales qui s'appliqueront à tous les psychiatres et aux autres évaluateurs qui vont participer au processus. Les psychiatres participeront au processus, car, parmi les deux évaluateurs, il faut au moins un expert.
Pensez-vous qu'il est possible de créer des normes ou des suggestions nationales, des paramètres nationaux applicables d'ici le mois de mars 2023?
:
C'est une grande question.
Comme vous le savez, les soins de santé sont de compétence provinciale. Je ne pense pas que le gouvernement fédéral puisse décider pour les provinces comment elles doivent organiser l'aide médicale à mourir ni dire aux cliniciens de partout au pays ce qu'ils doivent faire.
Cela dit, je pense qu'il y a déjà un organisme national, soit l'Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l'AMM, ou ACEPA, qui joue un rôle de chef de file en publiant divers documents de réflexion, des lignes directrices cliniques et ainsi de suite. L'organisme mène actuellement un projet sur les normes de pratique, les lignes directrices et les meilleures pratiques en matière d'aide médicale à mourir.
Dans les faits, les cliniciens vont se tourner vers ce genre de formations et de documents pour connaître les détails quant à ce qu'ils doivent faire quotidiennement. Même s'il était possible pour le gouvernement fédéral de travailler avec les provinces et de créer par magie un système national, je ne pense pas que c'est à cet égard que les cliniciens ont besoin d'aide et de directives. Je pense qu'ils ont plutôt besoin de savoir quoi faire, comment évaluer telle ou telle chose. Cela se trouve de toute façon entre les mains des organismes nationaux.
Oui, je pense que c'est possible. Je crois que c'est à l'automne de cette année que le programme de formation national sera offert. Les travaux sont donc déjà très avancés à ce sujet.
:
Merci. C'est une excellente question.
Pour formuler nos recommandations relatives à la consultation, nous avons réellement tenu compte des conseils que nous ont donnés nos trois députés autochtones. Bien qu'ils pensent que de nombreux membres des collectivités autochtones sont favorables à l'aide médicale à mourir et pourraient, à l'avenir, souhaiter y accéder à titre personnel ou aider les membres de leur famille à y accéder, ils reconnaissent également que la tenue de ces consultations est importante. C'est en fait quelque chose qu'ils attendent depuis que l'aide médicale à mourir a été autorisée, et il faut que cela se concrétise.
Quels sont les mécanismes à privilégier pour y parvenir? Nous sommes arrivés à la conclusion que cela devrait se faire au niveau provincial, peut-être avec la collaboration et le leadership du gouvernement fédéral. Étant donné que les collectivités sont très différentes, un seul type de consultation autochtone pancanadienne ne fonctionnerait pas nécessairement ou ne refléterait pas les différences et les nuances importantes entre les nombreuses collectivités autochtones.
Si nous pouvons le faire en respectant le délai fixé au mois de mars, je pense qu'il appartient à ces collectivités de s'exprimer à ce sujet.
:
Je vais commencer par dire que mon domaine d'expertise n'est pas l'administration et la prestation de services dans le domaine de la santé mentale. Je m'appuie un peu sur mon expérience clinique et mon travail sur ce rapport et sur ce sujet.
Je pense que la situation varie grandement. Je pense que certains groupes ne bénéficient pas d'un accès rapide et adéquat. Je le constate tous les jours dans ma pratique. En particulier pour ce qui est des soins de première ligne, les gens attendent longtemps pour des choses assez simples. Je vois des gens qui bénéficient d'un excellent accès aux soins intermédiaires, mais pour qui les soins de sous-spécialité sont difficiles à obtenir — et je vois également l'inverse. Cela dépend de l'endroit où vous vivez dans ce pays, malheureusement.
Certaines personnes sont en fait assez gravement affectées et reçoivent — c'est une bonne chose, c'est vrai, le système fonctionne parfois — des services adaptés au niveau d'intensité nécessaire pour leur traitement. Je pense en effet que la situation varie énormément. Évidemment, comme pour tous les services de soins de santé, plus on s'éloigne des centres urbains, plus la situation est mauvaise et plus l'accès est difficile. Dans les centres urbains, il y a beaucoup de fournisseurs, mais il y a une discontinuité qui est peut-être moins évidente que dans les zones rurales. J'en ai fait l'expérience lorsque j'ai travaillé comme suppléante dans le Nord, où l'offre était moins importante, mais plus cohérente.
Je pense que la situation est très variable.
:
Oui, je suppose que dans chaque province, qui a sa propre géographie, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, etc., et certaines sont très longues, d'autres sont comme ci ou comme ça, et ont des caractéristiques régionales différentes, il faut réfléchir, comme pour tous les services de soins de santé, je dirais, à la meilleure façon de déployer un service ou une pratique.
Je doute que toutes les communautés rurales aient la même vision de la façon dont nous devrons procéder. Je pense qu'au niveau de la planification provinciale, nous devrons travailler avec différentes zones rurales, pour nous assurer que la prestation des services correspond à leurs attentes.
Par exemple, j'imagine que dans certaines régions, si l'on s'appuie sur ce que nous avons fait pendant la pandémie, l'idée de procéder à des consultations par vidéoconférence sera très bien accueillie. Dans d'autres régions rurales où il n'est pas si difficile de se rendre sur place, les gens pourraient vouloir faire ce que j'ai fait dans le Nord, c'est‑à‑dire envoyer des suppléants que les gens pourront voir en personne.
Je pense qu'encore une fois, la situation variera grandement en fonction de la région.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
J'ai deux questions à poser à la Dre Gupta. Je vous remercie d'être venue et de vous être acquittée de ce devoir inestimable aujourd'hui en passant tout ce temps à répondre à nos questions.
Je voudrais souligner deux choses. Lors de la comparution de nos témoins, un point est revenu sans cesse. Ils nous ont dit que nous ne devrions pas chercher à établir l'incurabilité en nous basant sur le passé, sur les traitements reçus par les gens, sur leur accès, etc., mais vous tourner vers l'avenir, vers le prochain grand remède ou la prochaine solution, et leur donner ce genre d'espoir avant d'offrir l'aide médicale à mourir. Cela revient à dire: « Non, continuons et regardons vers l'avenir pour voir ce que nous avons à offrir ». Voilà la première question sur laquelle j'aimerais recueillir vos commentaires.
J'aimerais aussi parler d'un point que vous avez soulevé dans le rapport. En gros, beaucoup de personnes ne peuvent pas... Lors des audiences, les témoins ont eu tendance à mélanger le suicide et les problèmes de santé mentale. Vous avez clairement indiqué dans votre rapport que les idées suicidaires ne découlent pas uniquement de problèmes de santé mentale. En fait, la majorité des personnes ayant des problèmes de santé mentale n'expriment pas d'idées suicidaires.
La deuxième chose est que beaucoup de personnes ayant des idées suicidaires n'ont pas de problème de santé mentale. Doit‑on assimiler ces deux éléments? Devons-nous les considérer comme des problèmes distincts? Vous faites valoir qu'il s'agit de deux problèmes distincts.
:
Merci beaucoup pour ces questions.
Je vais commencer par la deuxième. Je pense que c'est tout à fait exact. Il y a évidemment un chevauchement entre les troubles mentaux et les tendances suicidaires. Ces dernières peuvent être un symptôme d'un certain nombre de diagnostics psychiatriques. Elles sont associées au suicide accompli, mais il arrive aussi que des personnes suicidaires n'aient pas de diagnostic psychiatrique. Il faut donc les comprendre comme deux choses distinctes.
Comme je l'ai mentionné précédemment, il peut également y avoir des tendances suicidaires chez les patients de la voie 1. Je me souviens d'un cas dans lequel un homme a tenté de se suicider en raison de la gravité de ses douleurs chroniques. Il a échoué et il est revenu demander l'aide médicale à mourir. Je pense que ce cas a soulevé des questions très semblables. Sommes-nous en train de l'aider à se tuer? Cet homme n'avait pas d'antécédents psychiatriques.
Vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas les confondre et que les tendances suicidaires doivent être traitées comme un phénomène à part entière, indépendant des troubles mentaux. Il se peut que la personne souffre d'un trouble mental, mais nous devrions être tout aussi préoccupés par le suicide chez les personnes qui n'ont pas de diagnostic psychiatrique que chez celles qui en ont un.
En ce qui concerne l'incurabilité, je vais revenir sur le point clinique technique que j'ai soulevé plus tôt, à savoir que pour certains diagnostics, en raison de ce que nous savons de la trajectoire de ces conditions, au moment où la personne reçoit le diagnostic, nous avons une assez bonne idée de la façon dont les choses vont évoluer et nous avons un degré de certitude accru. Pour d'autres, en particulier pour ce que nous appelons les maladies chroniques, il est très difficile de savoir ce qui va se passer au moment où la personne reçoit le diagnostic. Elle doit donc essayer un tas de choses et voir quels seront les effets sur son état.
Lorsque nous transposons ce principe à la situation de l'aide médicale à mourir, si quelqu'un souffre d'une maladie chronique, la seule façon dont nous pouvons nous prononcer sur la gravité de sa maladie est de regarder en arrière et de dire: « Qu'a fait cette personne? » Est‑il vrai que certaines personnes essaient beaucoup de choses et n'obtiennent pas un degré significatif de soulagement ou une amélioration de leur qualité de vie? Heureusement, beaucoup y parviennent.
:
J'aimerais dire deux choses à ce sujet.
D'abord, c'est vrai que très peu de gens vont y avoir accès si l'on suit nos recommandations. En même temps, ce sont des recommandations semblables à celles des pays où cette pratique est permise et où très peu de gens ont accès à l'aide médicale à mourir. S'ils y ont peu accès, c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'options de traitements.
On devrait s'assurer que les gens ont accès aux soins et aux services. Une minorité de gens se trouveront au bout d'un trajet long et sombre causé par une maladie mentale, mais cela pourrait arriver si l'on définissait ainsi « incurable ».
Ensuite, en ce qui concerne l'exclusion et la notion de consensus ou d'acceptabilité sociale, j'hésite. Parfois, ce qui est acceptable socialement n'est pas la bonne chose à faire. Il n'y a pas très longtemps, l'homosexualité n'était pas acceptable socialement. Il n'y a pas très longtemps, conduire alors qu'on était intoxiqué était acceptable socialement.
Docteure Gupta, dans la conclusion de votre rapport, on peut lire ce qui suit: « Le présent rapport est le début d'un processus, pas la fin. » Vous avez très clairement souligné que le groupe d'experts jouait un rôle très précis. Il a été clairement défini par votre mandat. Alors que nous, en tant que comité parlementaire, prenons le relais, pour ainsi dire, et poursuivons cette étude, nous sommes aux prises avec un rôle majeur, car nous allons en fin de compte formuler également des recommandations au gouvernement. En tant que législateurs, nous pourrions jouer un rôle dans le débat sur un futur projet de loi à ce sujet.
Je n'ai pas beaucoup de temps, donc ma question pour vous serait la suivante: En vous fondant sur votre expérience, étant donné que vous avez travaillé en profondeur sur les questions qui nous occupent, avez-vous des conseils à nous donner sur ce que nous devrions garder à l'esprit alors que nous poursuivons cette étude?
:
Je vous remercie beaucoup de votre question.
Je vais en profiter pour répondre également à la question que la sénatrice Mégie a posée tout à l'heure au sujet du dernier conseil.
Je pense que je me montrerais très critique à l'égard de l'exceptionnalisation des troubles mentaux et du traitement des troubles mentaux en tant que seul problème de santé sous-jacent ou en tant que réalité entièrement distincte de celle des personnes souffrant de troubles mentaux et physiques comorbides ou des personnes souffrant d'autres types de troubles physiques. Voilà le conseil que je vous donnerais. La réalité clinique n'appuie pas cette idée.
Il convient de noter que, dans le petit nombre de pays où cette pratique est autorisée, il n'y a pas de mesures de protection législatives propres aux personnes souffrant de troubles mentaux, en tant que seul problème de santé sous-jacent. Je pense que la réflexion s'est arrêtée là où nous nous sommes arrêtés en ce qui concerne le fait qu'il y a davantage de points communs que de différences, notamment en matière d'admissibilité.
En ce qui a trait à la question de la sénatrice Mégie...
:
Merci, monsieur le coprésident.
Je vais m'adresser à vous très rapidement, docteure Gupta. Tout d'abord, permettez-moi d'ajouter mon nom à la longue liste de personnes qui vous sont reconnaissantes de tout ce que vous avez fait, y compris en étant présente parmi nous aujourd'hui.
Je veux juste revenir sur une question que M. Cooper vous a posée. Il a fait ce que les avocats font parfois. Il a rendu la question tendancieuse en insérant dans celle-ci la réponse voulue et en utilisant le mot « prématurément » quand il vous a demandé si vous pensiez que le risque que les gens mettent fin à leur vie prématurément était acceptable.
Je veux juste vous donner l'occasion de répondre à nouveau à cette question, parce que votre réponse m'a donné l'impression que vous disiez que cela dépendait de la personne, ce qui était l'argument que vous tentiez de faire valoir, et non l'aspect prématuré de sa question. Est-ce juste?
L'outil principal, ce sont les critères d'aptitude que nous utilisons en pratique clinique au Québec et en Nouvelle‑Écosse. Nous utilisons aussi les critères d'Applebaum, qui sont complémentaires.
Comme vous le savez probablement, il y a aussi un mouvement qui vient des Nations unies et selon lequel on souhaite respecter la volonté des gens, même quand ils ont une invalidité mentale. Nous parlons de la prise de décision soutenue dans le rapport. Nous ne voulions pas nous aventurer trop loin parce que c'est une question qui exige beaucoup plus de réflexion.
Il y a une réforme législative au Québec. Il y a déjà des lois en Colombie‑Britannique, ainsi qu'en Alberta, je crois, dans le cadre desquelles on met en place des structures permettant une prise de décision soutenue pour les patients qui ont une autonomie limitée. C'est un peu la tendance actuelle.
Cela s'inscrit dans la tendance plus large de ne plus dire aux gens que, puisqu'ils ne sont pas aptes à prendre des décisions, on les force à faire des choses ou on donne à quelqu'un d'autre le droit de prendre des décisions pour eux.
À ce stade, on n'est pas allé trop loin. On voit qu'il y a déjà des initiatives législatives partout au pays. Cela dit, c'est pour cette raison que nous avons recommandé une collecte de données là-dessus.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Mes questions et remarques s'adressent à Mme Gupta. J'aimerais simplement vous entendre sur ce qui suit.
D'abord, croyez-vous que les textes législatifs qui donnent accès à l'AMM mettent véritablement en danger une communauté minoritaire ou un ensemble de personnes handicapées, une communauté religieuse ou les personnes ayant des contraintes sociales?
Ma deuxième question est la suivante, et vous pouvez gérer votre temps de réponse comme vous le voulez: vous nous avez tous mis au défi de nous acquitter d'une tâche difficile. Si, en tant que législateurs, nous refusions de traiter de questions complexes, nous savons tous qu'il n'y aurait pas d'assurance-maladie, de voies ferrées, de constitution, d'énergie ou de nourriture dans ce pays. Je sais que les médecins, les citoyens et les patients ont besoin que tout cela soit clair. Quelle est la chose la plus importante que ce comité doit faire?
:
À propos du danger, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas de répercussions sur certains des autres groupes, car c'est l'avenir qui nous le dira. Ce n'est pas ce que nous voyons dans les pays qui autorisent cette pratique, donc dans la mesure où nous pouvons nous appuyer là‑dessus, un tel danger semble très peu probable.
En fait, c'est tout à l'honneur de ces communautés de faire entendre ces préoccupations. Les personnes handicapées, plus particulièrement, ont, je crois, sensibilisé tout le monde dans ce débat à la nécessité de tenir compte de ces menaces au bien-être et à la qualité de vie, et que les évaluateurs et prestataires de l'aide médicale à mourir ne doivent pas l'oublier, y être sensibles et en tenir compte.
En fait, elles doivent poursuivre leurs efforts afin de nous sensibiliser à leur réalité. C'est un travail inestimable. Vous remarquerez que, dans l'élaboration du programme de formation de l'Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l'AMM, cela a mené à l'inclusion de personnes ayant une expérience directe, de personnes handicapées, etc., afin que les évaluateurs et prestataires de l'AMM puissent apprendre de leur expérience. Voilà ce que je vous répondrais.
En ce qui a trait à votre deuxième point, vous êtes bien aimable de me demander mon avis. Je suis l'évolution de ce débat et ce qui me perturbe dans celui-ci, c'est l'illogisme ou l'incohérence de certains arguments voulant que l'on puisse permettre l'AMM pour cause de trouble mental quand la personne présente une comorbidité physique, comme si cela annulait sa vulnérabilité ou ses antécédents de suicidabilité. Maintenant, la personne a une affection physique, donc c'est correct, on peut lui donner accès à l'AMM, mais si la même personne n'a pas de trouble médical, elle ne doit en aucune circonstance y avoir accès. C'est intrinsèquement illogique, et je n'ai jamais compris ce raisonnement. Quand quelqu'un a une affection pour laquelle il est très difficile de prévoir ce qui va se produire, il peut obtenir cet accès tant que son trouble n'est pas mental. Cet illogisme me préoccupe, et je vous inviterais à trouver une façon d'y remédier. Je crois que différentes options s'offrent à vous.
C'est inquiétant, car on laisse entendre que notre société ne croit pas que les personnes qui ont un trouble mental sont vraiment aptes à prendre des décisions qui les concernent. Il me semble que nous luttons vigoureusement contre cela depuis longtemps, donc je suis surprise.
Je comprends tout à fait les arguments quant au manque de ressources. À mes yeux, toutefois, nous n'avons pas à choisir entre avoir l'AMM ou de meilleures ressources. Nous devons avoir de meilleures ressources, point barre, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir l'AMM.
Je vais enchaîner sur les propos de mon collègue, le sénateur Dalphond, soit « pécher par excès de prudence » et revenir sur ce que monsieur Thériault et vous avez dit, ainsi que sur le fait que le 23 mars est dans moins d'un an. Les questions sont nombreuses. En fait, Mme Abby Hoffman, à sa comparution devant ce comité, a déclaré qu'il n'y avait pas eu de consultation auprès des Premières Nations, des Métis et des Autochtones.
Si les provinces ne sont pas prêtes, reviendra‑t‑il au praticien de trancher? Je suis très préoccupée par l'état de préparation de notre pays, de chaque province et de chaque territoire.
Pourriez-vous commenter n'importe lequel de ces points pour me rassurer, ainsi que ceux qui nous écoutent et les autres membres du Comité? Il reste moins d'un an et il ne semble pas y avoir de normes ni d'uniformité à l'échelle du pays.
Avant de vous remercier, docteure Gupta, il y a la recommandation 14, selon laquelle il faut consulter les Premières Nations, donc je crois que vous répondez également à la question dans votre rapport.
Merci beaucoup de nous avoir consacré de votre temps cet après-midi pour répondre à une pléthore de questions, ce qui témoigne de notre grand engagement par rapport à ce sujet fort important. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir pris le temps de venir nous entretenir avec tant d'éloquence du travail que votre comité et vous faites. Merci. Cela nous sera utile pour la suite des choses.
Comme vous le voyez, nous avons encore des questions. C'est inévitable dans notre travail.
Sur ce, chers membres, nous allons suspendre les travaux avant de passer aux affaires du Comité. Comme vous le savez, cela requiert un lien et un mot de passe différents. Je vais suspendre les travaux un instant et vous demander de vous rebrancher grâce à un autre lien dans une minute ou deux.
Merci beaucoup. La séance est suspendue.
[La séance est levée à 18 h 53. Voir le Procès-verbal.]