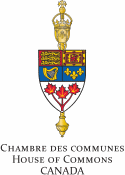:
Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à la 23
e réunion du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir. Je souhaite la bienvenue aux membres du Comité ainsi qu'aux témoins et aux gens du public qui suivent cette réunion sur le Web.
[Traduction]
Je m'appelle Marc Garneau. Je suis coprésident du Comité pour la Chambre des communes. Je suis accompagné ce matin de l'honorable Marie-Françoise Mégie, la coprésidente du Sénat.
Nous poursuivons aujourd'hui notre examen prévu par la loi des dispositions du Code criminel concernant l'aide médicale à mourir et leur application.
Je veux d'abord faire quelques observations d'ordre administratif.
Je rappelle aux députés et aux témoins de garder leurs microphones en sourdine à moins d'avoir été nommés par l'un des coprésidents. À titre de rappel, tous les commentaires doivent être adressés par l'entremise des coprésidents. Lorsque vous vous exprimez, veuillez le faire lentement et clairement. C'est important pour les interprètes. L'interprétation durant la vidéoconférence fonctionnera comme nous le faisons pendant les séances en présentiel du Comité. Au bas de votre écran, où il est écrit « interprétation», vous avez le choix entre le parquet, l'anglais et le français.
Sur ce, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre premier groupe de témoins, qui sont ici pour discuter des demandes anticipées.
Nous accueillons la Dre Alice Maria Chung, qui est professeure agrégée de clinique et qui témoigne par vidéoconférence.
[Français]
Nous accueillons le Dr Jude Poirier, professeur titulaire de médecine et de psychiatrie au Centre de recherche sur la prévention de la maladie d'Alzheimer de l'Université McGill. Il participera à la réunion par vidéoconférence.
[Traduction]
Nous accueillons aussi le Dr Ross Upshur, qui est professeur au département de médecine familiale et communautaire de la Dalla Lana School of Public Health, à l'Université de Toronto, et qui comparaît aussi par vidéoconférence.
Je vous remercie tous de vous être joints à nous.
Nous allons commencer par les observations de la Dre Chung, qui sera suivie du Dr Poirier et ensuite du Dr Upshur.
Docteure Chung, vous avez cinq minutes. La parole est à vous.
:
Je remercie l'équipe de soutien des TI d'avoir rendu ma comparution moins stressante pour moi.
Je remercie aussi le Comité de me permettre de parler de mes préoccupations concernant les directives anticipées pour l'aide médicale à mourir chez les personnes atteintes de démence.
Je suis une spécialiste de la médecine gériatrique qui s'occupe de personnes âgées fragiles depuis 1989, soit depuis plus de 30 ans. Je fais des visites aux domiciles d'aînés confinés chez eux trois demi-journées par semaine et j'en vois aussi à l'hôpital et en clinique. C'est également moi qui prends soin de mon père de 97 ans. Je l'ai aidé à s'occuper de ma mère, qui est décédée alors qu'elle souffrait de démence sévère, après avoir vécu avec grâce et dignité jusqu'à l'âge de 96 ans. Je prodigue également des soins à un couple, des proches de mon père. L'un des deux est octogénéraire avancé et l'autre, nonagénaire. Je suis professionnellement et personnellement déterminée à aider les personnes qui souffrent de démence, des premiers symptômes aux symptômes avancés.
Je crois fermement en l'autonomie du patient. Lorsqu'un patient comprend l'information sur un traitement par rapport aux autres options et qu'il peut prendre une décision et la communiquer, sa volonté doit être respectée, peu importe à quel point il est fragile. S'il est capable de prendre des décisions, je vais le soutenir. Les patients devraient également pouvoir retirer leur consentement à tout moment, surtout lorsque les effets peuvent changer leur vie. J'enseigne à des étudiants en médecine, à des résidents et à des médecins praticiens comment déterminer si un patient est capable de prendre des décisions d'ordre médical.
Les directives anticipées pour l'aide médicale à mourir posent plusieurs problèmes. Premièrement, nous ne pouvons pas prédire exactement ce que sera notre qualité de vie à l'avenir, encore moins lorsque nous sommes atteints d'une maladie chronique. De quel droit la personne que nous sommes à 60 ou à 70 ans peut-elle juger de la qualité de vie qu'elle aura à 80 ou 90 ans? Les patients atteints d'une maladie chronique peuvent souvent s'adapter à leur nouvelle situation et trouver un équilibre et une estime de soi, et sentir que leur qualité de vie est plutôt bonne. C'est ce que démontre la documentation médicale. Je l'ai également moi-même constaté pendant mes années de pratique.
Deuxièmement, dans les cas de démence avancée, on n'aurait pas la moindre occasion de retirer le consentement, ce qui est également essentiel au consentement donné en connaissance de cause. Quelqu'un d'autre, un travailleur de la santé qui ne connaît peut-être pas le patient ou un dispensateur de soins, devrait choisir quand donner suite à l'aide médicale à mourir. Les patients atteints de démence s'exposent à un préjudice attribuable non seulement au capacitisme, mais aussi à l'âgisme. On a également démontré que les dispensateurs de soins pourraient ne pas être en mesure d'évaluer correctement la qualité de vie de leurs proches atteints de démence. Leur fardeau influence souvent leur jugement.
Enfin, le recours aux directives anticipées pour les patients atteints de démence peut aussi mener à des abus. Les patients font déjà face à une influence indue pour faire la bonne chose et ne pas être un fardeau pour la société ou leurs proches. J'ai de nombreux patients qui ont eu le cœur brisé après avoir été incités par leur famille à vendre leur maison et à déménager dans un centre pour ne pas être un fardeau. À l'heure actuelle, les mesures de sauvegarde ne me permettent pas de protéger les aînés vulnérables contre l'exploitation financière. Je pense qu'il est impossible d'élaborer des mesures de sauvegarde qui permettraient de les protéger adéquatement contre une influence indue en vue de leur faire accepter ou demander l'aide médicale à mourir.
Bref, je m'oppose aux directives anticipées pour l'aide médicale à mourir, car les gens ne peuvent pas prédire exactement comment ils se sentiront dans une situation future qu'ils n'ont pas encore vécue et parce qu'ils ne peuvent pas retirer leur consentement. Même les personnes qui prodiguent des soins à des personnes atteintes de démence et qui les connaissent bien ont de la difficulté à évaluer leur qualité de vie. De plus, ces directives pourraient ouvrir la porte à d'autres formes de mauvais traitement des aînés vulnérables.
Merci beaucoup de m'avoir écoutée.
Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin.
Je remercie les coprésidents et les membres du Comité de cette invitation. Je suis à la fois très heureux et honoré d'avoir été invité à discuter avec les membres de ce très important comité.
Ce matin, je porte essentiellement deux chapeaux distincts.
Premièrement, je suis un chercheur spécialisé dans les causes et les traitements de la maladie d'Alzheimer depuis 35 ans et codécouvreur du gène principal lié à la forme commune de la maladie d'Alzheimer. Je connais parfaitement bien les facteurs de risque génétiques et environnementaux qui se cachent derrière la maladie. Nous pourrons en parler plus longuement, si vous le voulez, pendant la période de questions.
Deuxièmement, je suis l'enfant de deux parents ayant eu la maladie d'Alzheimer auprès desquels j'ai agi en tant qu'aidant naturel, d'abord avec mon père, ensuite avec ma mère. J'ai effectué le parcours habituel du combattant. J'ai vécu de très près et de façon très émotive la progression de la maladie à toutes les étapes, jusqu'à la toute fin, avec quelques combats qui ont été pénibles.
Bien que je travaille dans un hôpital psychiatrique depuis 35 ans et que je sois professeur titulaire en psychiatrie à l'Université McGill, mon propos, ce matin, ne concerne que la maladie d'Alzheimer. Les maladies mentales sont une autre situation qui, à mon avis, est très différente.
Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer en 2022?
C'est avant tout une maladie incurable et irréversible dont les facteurs de risque principaux sont la génétique et l'âge. Ce sont deux facteurs qu'il est malheureusement impossible d'atténuer ou de manipuler à l'aide de médicaments.
La maladie d'Alzheimer existe sous deux formes principales. L'une est dite de forme jeune, génétique et agressive, pour laquelle nous avons identifié plusieurs gènes causatifs. J'insiste sur le terme « causatif ». Cela veut dire qu'on sait si et quand ces personnes vont avoir la maladie. Ce petit groupe de familles représente environ 2 % à 3 % de tous les cas. Ce n'est pas beaucoup, mais, lorsque cette forme frappe une famille en particulier, c'est un enfant sur deux qui deviendra malade à chaque génération. S'il y a huit enfants, il y en aura quatre de malades.
L'autre forme de la maladie d'Alzheimer est la forme sporadique. C'est probablement celle que vous connaissez le plus. Vous avez sûrement côtoyé quelqu'un, à un moment ou à un autre de votre vie, qui était affecté de la forme sporadique. Cette forme a une composante génétique qui représente environ 60 % du risque. Je ne parle plus de gènes causatifs, mais bien de gènes de facteur de risque. Contrairement à la forme familiale, ce ne sont pas des gènes causatifs qui sont en jeu, mais des gènes de risque. Ce gène de risque va se combiner à des facteurs qu'on qualifie d'environnementaux ou liés au style de vie. Cela inclut des problèmes cardiovasculaires comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol non contrôlé, l'obésité, et même les problèmes de sommeil non contrôlés. C'est donc la combinaison des gènes et des facteurs cardiovasculaires ou liés au style de vie qui déclenche la maladie d'Alzheimer.
C'est une maladie qui va durer en moyenne de huit à onze ans. À la toute fin, une personne perd progressivement ses capacités physiques et mentales et éprouve de la difficulté à accomplir les activités de la vie quotidienne. Dans sa période plus grave, il y a détérioration du système immunitaire à un point tel que ce sont les infections, comme la pneumonie ou la bronchopneumonie, qui tuent la personne. La maladie d'Alzheimer ne tue pas la personne, mais l'amène à un tel état de faiblesse que ce sont les infections qui la tuent.
Au cours des deux dernières années, c'est la COVID‑19 qui a tué les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les CHSLD. Ce n'était plus la pneumonie.
Cela m'amène à la deuxième portion de ma présentation qui se veut un survol de la situation des pays européens qui ont inclus la maladie d'Alzheimer dans la liste des maladies susceptibles d'être invoquées dans le contexte de l'aide médicale à mourir.
Les Pays‑Bas ont mis en place une loi visant l'aide médicale en 2005, mais dont l'application s'est trouvée difficile à exercer pendant une dizaine d'années dans le contexte des maladies mentales, en particulier dans le cas de la maladie d'Alzheimer.
En 2018, l'Association médicale royale des Pays‑Bas a finalement établi des directives très claires qui ont été reconfirmées, en avril 2021, par la Cour suprême des Pays‑Bas et qui permettent l'utilisation des directives anticipées dans le contexte spécifique de la maladie d'Alzheimer.
Je vous donne des chiffres qui m'ont personnellement un peu surpris, mais en même temps rassuré. En 2018, 6 126 patients ont demandé l'aide médicale à mourir aux Pays‑Bas. De ce nombre, 144 patients ont fait une demande alors qu'ils avaient un diagnostic de maladie d'Alzheimer en phase légère ou modérée, c'est-à-dire dans la phase de la maladie où il est encore possible de poser un jugement éclairé et de donner un consentement.
Ainsi, 144 des quelque 6 000 demandeurs ont eu l'autorisation d'avoir cette aide. De ce groupe, seulement deux ont utilisé des directives anticipées, c'est-à-dire des directives qui avaient été formellement mises par écrit et que leurs familles ont activées pour respecter les vœux de la personne. Ainsi, vraiment très peu de gens y ont eu recours dans une situation de maladie d'Alzheimer.
En Belgique, 4 % des gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ont demandé cette aide. Malheureusement, les données ne différencient pas les directives médicales anticipées des autres demandes.
En Suisse, ce sont environ 3 % des gens ayant des troubles mentaux ou de comportement, incluant l'alzheimer, qui ont demandé une aide médicale à mourir. Les chiffres ne distinguent pas les deux types de demandes.
Pour conclure, je tiens à vous rappeler qu'on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer, mais qu'elle pose certainement de sérieux problèmes à mourir dans la dignité. L'alzheimer vous amène dans un état de dégradation physique sévère, au point où vous devenez vulnérable à n'importe quelle infection. La COVID‑19, récemment, a été celle qui nous a privés de nombreux sujets souffrant d'alzheimer.
Je vous rappelle que, au cœur de ce débat, il y a aussi la notion de douleur psychologique. Cette douleur n'est pas seulement vécue au moment du diagnostic, mais elle est présente tout au long de la maladie, particulièrement dans la deuxième portion.
Je m'arrête ici et je vais attendre vos questions.
Je vous remercie.
:
Madame et monsieur les coprésidents et distingués membres du Comité, bonjour. Je vous remercie de me donner le privilège de comparaître devant le Comité aujourd'hui. Je félicite le Comité de s'attaquer aux tâches colossales dont il est saisi.
Je suis professeur au département de médecine familiale et communautaire de la Dalla Lana School of Public Health, à l'Université de Toronto, où je suis également président et chef de division des services cliniques et de santé publique. De plus, je suis directeur associé de la Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, directeur scientifique du Bridgepoint Collaboratory for Research and Innovation et médecin membre du personnel à l'hôpital Hennick Bridgepoint, Sinai Health, à Toronto.
Je suis clinicien depuis plus de 30 ans, et je m'intéresse plus particulièrement à la recherche et aux soins cliniques pour les aînés. J'ai fait partie en 2011 du groupe d'experts sur la prise de décisions concernant la fin de vie de la Société royale du Canada. J'ai aussi été membre du groupe de travail du comité d'experts du Conseil des académies canadiennes sur les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. De plus, j'ai présidé le comité de l'éthique du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je suis actuellement président du comité de l'éthique du Collège des médecins de famille du Canada. De 2006 à 2011, j'ai également été directeur du centre conjoint de recherche en bioéthique de l'Université de Toronto.
Aujourd'hui, je vais m'exprimer à titre personnel et pas au nom des organisations pour lesquelles je travaille ou auxquelles j'offre des services.
Je reconnais que les sondages d'opinion et les données des enquêtes indiquent un fort soutien pour les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Je veux toutefois soulever les points suivants.
Comme je l'ai mentionné, j'ai été membre du groupe de travail du Conseil des académies canadiennes sur les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. J'aimerais féliciter le Conseil et son président-directeur général, le Dr Eric Meslin; la présidente de notre comité, la Dre Jennifer Gibson; ainsi que les autres membres pour leur travail exemplaire. Ce fut une expérience révélatrice. Le processus a été suivi avec rigueur et minutie, et il a été le plus inclusif possible au moment de solliciter des points de vue et d'examiner les données probantes. À ma connaissance, c'est l'examen le plus approfondi qui a été fait à ce sujet. J'espère que les membres du Comité ont lu le rapport attentivement. Comme je l'ai moi-même signé, il contient la majeure partie de mes points de vue sur la question.
Les membres du groupe de travail représentaient le continuum de points de vue sur l'acceptabilité de l'aide à mourir proprement dite, sans parler des demandes anticipées. Les points suivants faisaient toutefois l'unanimité. Les questions liées aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir sont extrêmement complexes et d'une grande importance, et il y a de grandes lacunes dans les connaissances et de grandes incertitudes.
J'aimerais citer un passage de la dernière section du rapport, qui dit que: « [...] le principal problème causé par les demandes anticipées d'[aide médicale à mourir] est l'incertitude à laquelle font face les personnes chargées d'exécuter une demande quand vient le moment de juger si le patient désire l'aide à mourir [...] » La responsabilité pour cette décision sera assumée par une tierce partie, fort probablement un membre de la famille désigné comme décideur mandaté ou remplaçant, et pas par le médecin. C'est très différent du régime en place aux Pays-Bas.
Si nous décidons de procéder ainsi, il est alors essentiel que les lacunes dans les connaissances qui sont décrites dans notre rapport soient comblées le plus rapidement possible afin qu'il y ait des mesures de soutien fondées sur des données probantes pour les décideurs remplaçants, les cliniciens et les autres intervenants, car de nombreuses personnes participent à l'aide médicale à mourir. C'est donc ce que nous devons faire compte tenu du caractère inadéquat des mesures de soutien actuelles ainsi que du recours insuffisant aux directives anticipées et à la planification anticipée des soins dans la pratique quotidienne hors du contexte de l'aide médicale à mourir. Il reste beaucoup de travail à faire.
Il y a aussi beaucoup d'incertitude en ce qui a trait à notre compréhension de ce genre de concepts couramment employés comme celui de la souffrance, et beaucoup d'incertitude médicale quant à la meilleure façon d'évaluer cela, même dans des segments compétents de la population. Cela soulève également des questions au sujet de l'affectation des ressources, et quant à savoir si la quantité de ressources affectées pour offrir le soutien nécessaire aux décideurs remplaçants et aux cliniciens sera suffisante, et s'il y aura assez de mesures de sauvegarde et une surveillance et une évaluation continues du régime d'aide médicale à mourir mis en place. La question de savoir si de nouvelles ressources seront mises à contribution pour mettre en œuvre cette dimension particulière de l'aide médicale à mourir lorsque nous avons encore des lacunes à combler dans les soins de fin de vie est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais qui doit faire l'objet d'un examen approfondi et d'un débat.
Peu importe comment nous procédons, il y aura des choix difficiles à faire. Pour paraphraser Georg Hegel, le philosophe du XIXe siècle, les situations tragiques ne découlent pas d'un choix entre une bonne chose et une mauvaise chose, mais plutôt d'un choix entre deux bonnes choses.
Je vous remercie encore de me donner l'occasion de comparaître devant le Comité. Je suis impatient de répondre à vos questions du mieux que je peux.
Merci.
:
Je vous remercie de la question.
Il peut sembler paradoxal que la personne qui passe le plus de temps avec le patient ne soit pas nécessairement celle qui le connaît le mieux, mais c'est ce que la recherche a montré.
Dans la première déclaration que j'ai fournie, je cite une étude de psychiatrie gériatrique dans laquelle 91 personnes atteintes d'une démence légère à modérée ont été jumelées avec des principaux dispensateurs de soins, la plupart du temps l'époux ou l'épouse, ou quelqu'un qui vivait avec le patient. On leur a demandé de remplir un questionnaire sur la qualité de vie. On a remis le même questionnaire aux patients. Comme ils étaient atteints d'une démence légère ou modérée, ils pouvaient répondre aux questions.
Cinq éléments étaient abordés. Il y avait l'estime de soi ou la façon dont les patients se percevaient. Il y avait aussi l'affect positif, c'est‑à‑dire s'ils étaient généralement heureux. Un autre aspect était l'affect négatif: étaient-ils anxieux, dépressifs, tristes ou ressentaient-ils un sentiment de culpabilité. De plus, quel était leur sentiment d'appartenance? Avaient-ils l'impression de faire partie de la société? Avaient-ils l'impression d'appartenir à un groupe de personnes qui se souciaient d'eux? Enfin, il y avait le sens de l'esthétique, qui renvoie à leur capacité d'avoir du plaisir dans la vie.
On a constaté que l'entente entre les patients qui remplissaient le questionnaire et leurs principaux dispensateurs de soins n'était pas très bonne.
On s'est également penché sur le fardeau pour les dispensateurs de soins. On leur a demandé à quel point ils trouvaient leur travail stressant. On a aussi demandé à quel point les patients étaient indépendants. Plus de la moitié des patients avaient besoin de soins directs à ce stade‑là et 44 % d'entre eux avaient des problèmes comportementaux, comme de la paranoïa ou des tendances agressives. Le rapport le plus fort pour expliquer la divergence d'opinions provenait du fardeau pour le dispensateur de soins. En effet, lorsque le dispensateur de soins estimait que le fardeau était extrême, il projetait parfois ses sentiments sur la qualité de vie du patient, qui pouvait pourtant penser que sa qualité de vie était bonne.
J'espère que cela répond à votre question.
:
Je n'ai jamais effectué d'évaluations de la capacité pour l'aide médicale à mourir, mais j'en fais tout le temps pour ce qui est de la capacité à gérer ses finances, à prendre des décisions personnelles et médicales. Une grande partie de mes patients sont fragiles et risquent d'être exploités financièrement, et ils peuvent prendre des décisions que leur famille n'approuve pas. À titre d'exemple, ils pourraient vouloir rester chez eux même s'ils leur arrivent de tomber ou s'ils ne se nourrissent pas convenablement. Ils sont vraiment en mesure de prendre une décision et de dire que c'est là qu'ils veulent être. Il faut respecter ces décisions.
De toute évidence, ils ont une mémoire à court terme, ce qui signifie que lorsqu'on tente de leur présenter les avantages et les inconvénients, ils ont souvent de la difficulté à se souvenir de l'information assez longtemps pour prendre une décision. Leur jugement et leur perspicacité sont affaiblis, surtout lorsque les parties frontales de leur cerveau sont touchées.
Ils souffrent parfois de labilité émotionnelle. Par exemple, le système cérébral frontal d'un bambin n'est pas encore arrivé à maturité, et ils ont des sautes d'humeur et peuvent passer d'un profond désespoir à des éclats de rire en l'espace d'une minute. Leur humeur peut changer très rapidement. Certains aînés, surtout ceux qui sont atteints de démence fronto-temporale ou qui subissent des AVC dans la partie frontale de leur cerveau, ont le même problème. Ils se fatiguent aussi facilement, et il est donc souvent impossible d'évaluer leur capacité en les rencontrant une seule fois.
Enfin, ils dépendent aussi souvent totalement de leur dispensateur de soins. Lorsque la personne qui leur prodigue des soins habite avec eux, ils dépendent d'elle non seulement pour recevoir des soins directs, mais aussi pour prendre des décisions afin de les aider. Ils risquent donc de subir une influence indue. Étant donné que la personne peut les insulter ou les fâcher en allant à l'encontre de ce qu'ils souhaitent, ils pourraient se sentir obligés de lui donner leur consentement.
C'est ce que je vois souvent lorsque des gens me disent qu'ils veulent rester chez eux. Ils ont la capacité nécessaire, mais comme ils ne veulent pas faire de vagues ni contrarier leur famille, ils finissent par décider d'aller dans un centre. C'est légal. Ils prennent la décision à un moment où ils en étaient capables, mais c'est néanmoins déchirant, car ce n'est pas ainsi qu'ils voulaient finir leur vie.
:
C'est l'enfant, l'aidant naturel, qui va parler.
On a dit cela de ma maman. Elle semblait être dans le stade modéré sévère. C'était une démence heureuse, parce qu'elle était souriante. Elle ne causait pas de problème. Elle n'était pas un poids pour l'équipe de santé du CHSLD. Cependant, chaque fois que je lui rendais visite, elle me demandait de trouver un moyen de mettre fin à ses jours.
Différentes régions du cerveau meurent au cours de la maladie d'Alzheimer. Cela évolue différemment d'un individu à l'autre. Cela suit un schéma général, mais la maladie progresse de façon différente d'un individu à l'autre. Les changements biochimiques peuvent s'apparenter à des changements qui provoquent des modifications dans la biologie du cerveau, qui vont de pair. Par exemple, les récepteurs dopaminergiques jouent un rôle dans le plaisir et l'utilisation de drogues. Ces régions du cerveau meurent de la même façon dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Des déséquilibres chimiques se produisent.
Ces personnes sont-elles heureuses? Non. En effet, maman ne m'aurait pas demandé à mourir à répétition. Il y a des changements biologiques sur lesquels, comme je l'expliquais tout à l'heure, on n'a aucun contrôle. La sous-estimation de la douleur psychologique est souvent le problème, dans notre beau système de santé. On cherche des problèmes physiques et on voit moins les problèmes psychologiques. Je pense que c'est là que le bât blesse. En recherche, nous avons des outils pour documenter cela.
Je suis désolé, mais la démence heureuse, pour moi, c'est un drôle de mythe.
:
Je suis tout à fait d'accord.
Les chiffres de la Hollande m'ont impressionné, je ne m'en cache pas. Je m'attendais à ce que 70 % des 244 malades atteints d'alzheimer fassent une demande anticipée. Or il n'y en a eu que deux, au bout du compte.
Les familles et les équipes traitantes doivent ensemble choisir le chemin. Si c'est le cas, on le vérifie quand on fait la demande anticipée avec le malade en lui demandant comment il veut qu'on réagisse si cette situation survient.
Moi, je l'ai vécu avec ma mère. Ma mère m'avait dit qu'elle ne voulait aucun acharnement thérapeutique en fin de vie. Cela incluait le fait de ne pas avoir de tube d'oxygène dans le nez. Je suis arrivé un matin et l'infirmière, qui était d'une autre culture que je ne nommerai pas et pour qui c'était horrifiant de ne pas avoir de tube en fin de vie, avait décidé d'elle-même d'en mettre un. Ce fut une bataille à l'hôpital pour le faire enlever, parce que le syndicat s'en est mêlé.
On constate que l'interprétation se fait même par le personnel soignant à différents niveaux. Il faudrait vraiment que ce soit clair, bien en amont, en impliquant la famille et les gens qui traitent le patient ou la patiente en question.
:
Merci beaucoup, madame la présidente.
Permettez-moi de faire comme mes collègues et de remercier nos témoins. Vos perspectives orienteront l'étude du Comité.
Docteure Chung, j'aimerais commencer avec vous. Dans votre déclaration préliminaire, vous avez évoqué des préoccupations que nous avons entendues au sujet des demandes anticipées... L'idée que nous n'ayons plus la capacité de consentement au fil de la progression de la maladie. Nous savons que le mot « démence » fait peur à beaucoup de monde. Il est associé à une certaine stigmatisation.
Toutefois, lors de notre dernière réunion, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir une témoin nommée Sandra Demontigny. Elle vit avec une apparition précoce de la démence agressive. C'est une maladie génétique dont a souffert son père. Elle ne se fait pas d'illusions sur ce que sera pour elle la maladie. Elle a accompagné son père. Elle a vu sa « descente aux enfers », comme elle le dit, et elle sait qu'elle subira le même sort.
Comment réagissez-vous à une personne qui connaît aussi bien la maladie, qui sait quelle sera sa condition au fil de la progression de la maladie et qui exprime son autonomie personnelle maintenant, afin d'éviter de finir ses jours de la même façon que son père? Comment pouvons-nous aborder une telle question en comité?
:
Je crois qu'il faut d'abord reconnaître que la démence ne se vit pas de la même façon pour tout le monde.
Je vais vous parler en tant que soignante plutôt qu'en tant que médecin.
Ma mère a été la première femme obstétricienne-gynécologue et la première personne d'origine asiatique à occuper un tel poste en Colombie-Britannique. Elle a dû faire face à beaucoup de racisme et de sexisme. C'était une femme très énergique. Elle ne se laissait pas faire.
Lorsqu'elle a commencé à souffrir de démence, nous pensions que la situation allait être terrible, parce qu'elle avait perdu beaucoup d'autonomie. Mais elle était heureuse. Vous vous demandez peut-être comment nous savions qu'elle était heureuse alors qu'elle ne parlait plus. Elle s'asseyait avec ses petits-enfants — je vais pleurer... excusez-moi — et leur tenait la main. Elle chantait. Même si elle ne parlait plus, elle arrivait encore à chanter.
Elle est décédée à la maison, avec mon père à ses côtés. Elle a eu une très belle vie. Si je lui avais demandé, lorsqu'elle était au sommet de sa carrière de médecin et de pionnière, si elle voulait mourir de la sorte, elle m'aurait probablement répondu: « Jamais de la vie! » À la fin, toutefois, je dirais qu'elle a eu une belle mort, heureuse, dans la dignité, grâce au soutien de tout le monde à la maison. On ne peut pas se prononcer, lorsqu'on a 50 ou 60 ans, sur une situation que l'on n'a pas encore vécue.
Je fais souvent référence à un autre article, au sujet de patients qui allaient...
:
Vous n'avez jamais évalué de demande d'aide médicale à mourir. D'accord. Merci beaucoup.
Je vais alors m'adresser au Dr Poirier.
J'aimerais revenir à la question de... Récemment, nous avons entendu un témoin parler de la démence « heureuse ». Cette personne, qui souffre de démence précoce, a dit qu'il s'agissait d'un symptôme comme bien d'autres. Les gens peuvent être fâchés; ils peuvent devenir violents; ils peuvent être heureux. Ils peuvent passer d'un sentiment à l'autre parfois très rapidement.
Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est heureuse, c'est un jugement de l'extérieur et non de l'intérieur, qui sert souvent à conforter le soignant dans l'idée que la personne qu'il aime est heureuse, mais lorsqu'on passe de longues périodes avec les gens qui souffrent de démence, on s'aperçoit que ce bonheur va et vient, comme tout le reste.
Comment expliquez-vous cette idée, qui semble bien ancrée, voulant que ce que vous aviez décidé à 50, 60, 70 ou 80 ans au sujet de ce que signifiait mourir dans la dignité ne soit tout à coup plus valide, et que les gens subitement deviennent heureux et ne veulent plus s'en tenir à ce plan? Comment pouvons-nous aborder cette question?
:
Vous avez rencontré Mme Sandra Demontigny, qui est atteinte d'une forme précoce et héréditaire d'alzheimer.
Ce que ce type d'alzheimer a de terrible, c'est que si le père de Mme Demontigny en a été atteint à 41 ans, elle en sera atteinte à 41 ans, plus ou moins deux ans. De plus, si sa fille ou son fils possède le gène défectueux, elle ou il en sera atteint à 41, 42 ou 43 ans. Ces gens tiennent une bombe et ils savent quand elle va exploser.
Sandra est une magnifique porte-parole pour les gens atteints d'alzheimer. Elle nous explique dans ses mots où cela s'en va.
Contrairement à d'autres, elle a la chance de savoir quand la bombe va exploser. Elle a donc déjà pu faire des démarches concernant sa succession et ses finances, entre autres. Elle travaille aussi très fort à éduquer les gens. Les gens atteints de la forme commune d'alzheimer ne savent pas quand la bombe va exploser, mais ils sont sûrs qu'elle va exploser.
Certains outils nous permettent de déterminer l'évolution de la maladie selon la génétique. Jusqu'à maintenant, 75 gènes ont été identifiés comme facteurs de risque. On sait aussi que plusieurs facteurs environnementaux constituent des facteurs de risque. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même qu'il y a 10 ans, car: on sait comment la maladie évolue.
Personnellement, je dis aux enfants de gens atteints d'alzheimer de penser à ce qu'ils veulent dire à leur famille et à leurs enfants, y compris leurs volontés une fois que le risque sera clair.
Aujourd'hui, le seul morceau manquant du casse-tête, c'est que ces gens puissent donner des directives anticipées ayant trait à la fin de vie. Je travaille avec 400 personnes sur une base annuelle, et je peux affirmer qu'ils donnent des directives anticipées ayant trait à tous les autres aspects de leur vie.
On a pu éduquer ces gens en leur donnant une façon de gérer la situation ou d'en prendre le contrôle, jusqu'à un certain point.
:
Merci, madame la vice-présidente.
Je remercie tous les témoins, qui sont vraiment très intéressants aujourd'hui.
Docteur Poirier, je ne peux pas vous dire à quel point j'en ai appris sur la maladie d'Alzheimer, moi qui vis le même stress et la même peine que votre collègue, la Dre Chung. Mon père souffre d'alzheimer et ma mère est morte dans les mêmes conditions que la vôtre. e est morte de faim et de soif, parce qu'elle n'était plus capable d'avaler quoi que ce soit. De plus, trois de mes grands-oncles et grands-tantes, qui étaient frères et sœurs, en sont morts l'un après l'autre. Cela m'inquiète beaucoup personnellement.
Mme Demontigny a beaucoup impressionné tous les membres du Comité, cette semaine. Mardi soir, elle a livré un incroyable témoignage. Elle était sûre d'elle-même et avait toute sa tête pour prendre une décision importante, comme celle de demander l'aide médicale à mourir quand arrivera le bon moment.
Cela m'amène à vous poser une question sur l'échelle de 1 à 5 ou de 1 à 30 dont vous avez parlé, qui aide à déterminer le moment où l'on pourrait prendre une telle décision. J'aimerais que vous nous donniez des pistes. Comment nous, les législateurs, pouvons-nous concevoir cette échelle? Par exemple, est-ce quand on se trouve à 4 ou à 25 que l'on peut demander l'aide médicale à mourir?
Encore une fois, je renverrais le Comité au rapport du CAC, qui explique très en détail tous les éléments de la discussion d'aujourd'hui, et les incertitudes dans ce domaine.
Comme vous le savez, nous devons vivre avec une part d'incertitude, mais elle peut être réduite en établissant les priorités et en finançant la recherche pour combler les lacunes.
Le rapport contient au moins 15 recommandations, parce que nous en connaissons très peu sur le sujet. Les quelques données probantes dont nous disposons, auxquelles a fait référence le Dr Poirier, portent sur une poignée de cas aux Pays-Bas. Nous nous sommes beaucoup centrés sur l'Alzheimer et certaines formes de démence, mais ce ne sont pas les seules circonstances dans lesquelles on a recours aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir.
Je recommanderais un financement réservé à cette fin. Je siège à l'un des comités consultatifs de l'institut. Il y a des mécanismes en place pour que le financement favorise la recherche. Les instituts de recherche provinciaux peuvent offrir ce financement.
Le Dr Poirier a parlé de barèmes, mais dans quelle mesure sont-ils valides? Quel est leur degré de sensibilité, leur spécificité et leur valeur prédictive positive ou négative? Comme nous le savons depuis que nous vivons avec la COVID, les tests sont associés à des seuils. Dans le cas de l'aide médicale à mourir, les erreurs de jugement et d'action émanant de ces barèmes sont irrévocables. Il y a un poids existentiel associé aux décisions qui sont prises.
Je crois qu'il faut faire des décideurs substituts une priorité dans toute la gamme de soins. La Dre Chung a parlé du fardeau des soignants, pas seulement dans le cas des personnes qui souffrent de démence et d'Alzheimer, mais aussi dans le cas des adultes qui souffrent de plusieurs maladies concomitantes. Nous vivons une crise des soins aux aînés au Canada à l'heure actuelle.
Les demandes anticipées d'aide médicale à mourir ne sont qu'une petite partie d'un grand problème de société. Il faut se demander pourquoi les gens ont tant peur de la démence. Tout le monde a dit avoir vu des choses terrifiantes, mais pourquoi le sont-elles? Pourquoi avons-nous créé des conditions où les soins offerts aux personnes souffrant de démence sont si terrifiants?
Nous avons créé le problème. Nous pourrions changer le scénario en investissant dans les soins et dans le soutien aux soignants. Il est peut-être impossible d'éviter ce scénario de peur et d'expériences négatives. Comme l'a fait valoir le Dr Poirier, l'Alzheimer est une maladie neurodégénérative irréversible, mais nous pouvons en faire beaucoup, grâce au soutien social, pour rendre ce scénario beaucoup moins désespérant.
Merci.
J'aimerais exprimer deux réserves au sujet de la légalisation des directives anticipées pour l'aide médicale à mourir.
J'aimerais premièrement faire un rappel au sujet du principe juridique et moral voulant que les personnes inaptes à prendre des décisions concernant, par exemple, les finances et la santé soient encadrées par des régimes de protection établis dans la loi qui veillent à ce qu'elles ne se portent pas elles-mêmes préjudice. Un élément important de ces régimes est la notion selon laquelle les décisions doivent être prises dans l'intérêt supérieur de la personne et de son bien-être. Nous devons fournir à cette personne les soins qui correspondent le mieux à ses capacités résiduelles et qui favorisent le plus son bien-être.
Nous pourrions penser à première vue que le respect de l'autonomie de la personne consiste à suivre les instructions qu'elle a rédigées dans le passé sur le traitement qu'elle souhaitait recevoir dans l'avenir. Toutefois, l'identité, les désirs et les besoins changent avec le temps. Si les instructions données dans le passé peuvent très bien respecter l'autonomie de la personne dans plusieurs contextes, ce n'est pas nécessairement toujours le cas, surtout lorsque la personne connaît d'importants changements cognitifs. Le cas échéant, la situation et les volontés de la personne, qui est souvent aux prises, par exemple, avec une diminution des facultés cognitives, peuvent être très différentes de ce qu'elles étaient dans le passé.
À titre d'exemple, imaginons un patient de 75 ans du nom de John, atteint de démence, qui n'est plus en mesure de prendre des décisions sur ses soins de santé. Premièrement, les décisions prises en son nom doivent servir ses intérêts.
Nous pouvons, bien sûr, supposer que le John âgé de 50 ans, qui ne souffrait pas de démence, voulait le bien-être du John plus âgé et qu'il le connaissait mieux que n'importe qui d'autre. Il était donc le mieux placé pour dire ce qui était le mieux pour le John de 75 ans. N'empêche: ce n'est pas si évident. En effet, John pourrait prendre une décision qui n'est pas dans l'intérêt supérieur de sa version plus âgée s'il a l'intérêt supérieur de quelqu'un d'autre en tête.
Par exemple, il pourrait refuser d'être un fardeau pour son épouse âgée ou pour d'autres membres de sa famille, ou avoir ses intérêts actuels en tête plutôt que ceux de sa version plus âgée et malade. Par exemple, il pourrait s'imaginer alité et extrêmement dépendant. Il pourrait ressentir de la honte à l'idée que ses proches restent avec cette image de lui après sa mort.
Même si cette évaluation semble à première vue raisonnable, elle peut toutefois véhiculer des croyances discriminatoires sur la qualité de vie des personnes aux prises avec des maladies et des incapacités, et laisser entendre que leur vie ne vaut peut-être pas la peine d'être vécue. Plusieurs personnes ont une vie heureuse, même si elles sont aux prises avec des problèmes médicaux graves et variés et avec un degré de dépendance élevé. Toutefois, si John ou un membre de sa famille ou de son équipe de soins ne sont pas de cet avis en raison de généralisations capacitistes, John, à 75 ans, deviendra une victime de capacitisme ou de stéréotypes capacitistes.
Autrement dit, nous ne devons pas mettre fin à la vie de John pour la seule raison que nous, personnellement, ne supporterions pas de vivre si nous étions dans sa situation. Nous devons faire ce qui est le mieux pour John. Nous devons penser aux besoins du patient — en l'occurrence John, âgé de 75 ans, atteint de démence — avant de penser aux nôtres. Cela ne veut pas dire que les préférences que John a exprimées auparavant ne sont pas pertinentes. L'évaluation holistique de ce qui est dans son intérêt supérieur englobe aussi les souhaits et les préférences qu'il a exprimés dans le passé.
Premièrement, le fait de donner préséance aux souhaits formulés par le patient lorsqu'il était jeune, qui est parfois très différent du patient âgé sur les plans expérientiel et cognitif, n'est pas nécessairement conforme aux volontés et au bien-être de ce patient âgé, surtout s'il s'est écoulé beaucoup de temps. Des expériences inédites, le développement de nouvelles relations de dépendance et de soins, de nouvelles souffrances et de nouvelles formes de résilience et de joie ainsi que des changements cognitifs importants ont pu survenir entre ces deux époques. L'adéquation entre le passé et le présent devient alors de plus en plus discutable. Ce serait tout aussi discutable d'adopter une loi qui permettrait que le sort d'un patient atteint de déficience cognitive soit décidé par lui, mais lorsqu'il était beaucoup plus jeune.
Deuxièmement, si nous devons mener une nouvelle évaluation holistique des besoins du patient, et non pas appliquer sans discernement les souhaits qu'il a formulés dans le passé, il serait très difficile, voire impossible, de détecter une forme de souffrance qui justifierait de mettre fin à la vie du patient si ce même patient n'a plus les capacités cognitives pour exprimer le souhait de mourir. Il ne devrait pas échoir à l'État d'établir en quoi consiste une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue.
Ce deuxième point s'appliquerait à la fois à l'euthanasie volontaire et aux dispositions sur les directives anticipées, car pour que des directives anticipées soient activées, les médecins devraient tout de même déterminer que le patient de 75 ans atteint de démence a bel et bien atteint la forme de souffrance qui justifierait le déclenchement de l'aide médicale à mourir selon les instructions formulées dans le passé par le patient.
Merci.
Premièrement, j'aimerais témoigner ma gratitude aux présidents et au comité mixte de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour discuter d'un sujet très important, soit l'utilisation des directives anticipées liées à l'aide médicale à mourir.
Je suis éthicienne principale au centre des sciences de la santé Baycrest. Je suis également professeure adjointe au Département de médecine de l'Université de Toronto, chercheuse à l'Université Ben-Gurion, en Israël, et membre du conseil consultatif de l'organisme MAiDHouse. Je mentionne que je vais m'exprimer aujourd'hui à titre personnel et que je ne représente aucune organisation.
Mes commentaires s'appuient sur de nombreuses années d'expérience comme psychologue clinicienne, philosophe et éthicienne au sein d'organisations prestataires de soins de santé. J'ai très souvent travaillé avec les directives anticipées auprès des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de démence.
J'ai présidé plusieurs comités d'aide médicale à mourir et exercé la surveillance éthique de cas. Mes publications comptent ma thèse de doctorat en philosophie sur ce sujet, ainsi qu'un livre paru en 2018 aux éditions Springer International sur la démence et l'utilisation des directives anticipées.
Mes années de travail en tant que chercheuse et clinicienne m'ont permis de relever toute une gamme de préoccupations importantes suscitées par l'utilisation des directives anticipées — je tiens à souligner ce point —, notamment lorsqu'elles sont utilisées actuellement par des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de démence. La principale question que je pose est celle de savoir si la légalisation des directives anticipées pour l'aide médicale à mourir est moralement justifiable pour les patients atteints de démence.
Les directives anticipées s'appliquent tout autant à la renonciation aux traitements qu'à l'aide médicale à mourir. Plus loin dans ma présentation, je vais suggérer des moyens de modifier la conceptualisation et l'utilisation des directives anticipées afin de relever le niveau de justification morale.
Comme l'ont déjà dit plusieurs témoins, la conception que se font habituellement les gens de la maladie d'Alzheimer est celle d'une horrible tragédie qui entraîne invariablement la perte de la personnalité. Cette conceptualisation est prépondérante au moins en Amérique du Nord. Le stéréotype négatif associé à l'Alzheimer est souvent le motif qui pousse les gens à rédiger des directives anticipées indiquant leur volonté de renoncer aux traitements s'ils sont frappés de démence. Ces directives peuvent devenir particulièrement problématiques si la personne atteinte de démence est heureuse de façon générale.
Au moment de rédiger nos directives anticipées, nous ne possédons pas forcément l'imagination ou l'expérience nécessaires pour prévoir exactement ce que nous pourrions souhaiter ou non dans des situations futures. Nos valeurs et nos croyances peuvent changer radicalement avec le temps, tout comme nos cadres de référence.
Les mandataires peuvent aussi donner préséance à un intérêt qui n'est pas toujours l'intérêt du patient. Mes recherches ont démontré que pour une variété de raisons, les mandataires ne suivent pas toujours les directives anticipées, même celles qui indiquent clairement les souhaits de la personne concernant les traitements. Il est donc difficile de penser que d'avoir un mandataire chargé d'interpréter les directives et de fournir le consentement éclairé exigé apporte vraiment quelque chose.
La conceptualisation des directives anticipées — autant l'interprétation de leur contenu, que de leur intention, de leur utilisation et, le cas échéant, des modalités de leur application — peut comporter énormément de subjectivité, de nuances et d'incohérences.
J'ai appris également, dans le cadre de mon travail, que nous nous trompons en supposant pouvoir prédire le comportement de l'auteur des directives anticipées. Il est fréquent que la personne ne s'attende pas ou ne souhaite pas que ses directives soient considérées comme définitives. Cela dit, le mandataire est rarement au courant de ces attentes ou de ces souhaits. En fait, même si c'était le cas, la personne atteinte de démence n'aurait peut-être plus les mêmes attentes et les mêmes souhaits.
Pour accroître le degré de moralité des directives anticipées, non seulement ces sources de préoccupations devraient être corrigées, mais les auteurs des directives anticipées devraient être informés de leurs désavantages et de leurs forces. De cette manière, ils seront mieux outillés pour déterminer si la rédaction de directives anticipées servira leur intérêt clinique à long terme.
J'aurais quelques recommandations cliniques et des recommandations concernant les politiques.
Premièrement, les directives anticipées devraient être considérées explicitement comme un élément d'information parmi tant d'autres sur les intentions ou les préférences de la personne. Ces directives ne devraient pas à elles seules déterminer les décisions prises en matière de traitement médical.
Deuxièmement, comme les documents de directives anticipées sont très peu représentatifs du principe d'autonomie, les volontés concernant le traitement qui y figurent ne devraient pas être considérées comme l'équivalent ou avoir la même force d'autodétermination que les volontés exprimées en temps réel par le patient.
Troisièmement, bon nombre de personnes atteintes de démence ont encore des valeurs, des volontés et des intérêts auxquels ils tiennent. Sur ce plan, ces personnes devraient être considérées au moins comme quasi autonomes ou partiellement autonomes. Par conséquent, les décisions concernant leurs traitements médicaux devraient, dans la mesure du possible, concorder avec les valeurs, volontés et intérêts de ces personnes.
Quatrièmement, lorsqu'elles sont très récentes et qu'elles ne sont pas rendues obsolètes par des modifications apportées aux déclarations et aux dispositions du patient à l'égard des traitements ainsi qu'à sa réponse à ces traitements, ces directives peuvent être traitées comme l'expression en temps réel des volontés de ce patient. Ensuite, confusément, mais irrémédiablement, les volontés exprimées dans les directives anticipées perdent rapidement leur actualité — et par conséquent leur valeur en tant qu'expression de l'autonomie — en raison du temps qui passe et de l'apparition de nouveaux comportements ou de nouvelles attitudes — par exemple, un sentiment de bonheur généralisé — qui entrent en contradiction avec le contenu des directives ou de ce qu'elles présupposent.
:
Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler d'un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi, dont j'ai beaucoup parlé et qui m'intéresse grandement.
Mon expérience compte l'évaluation de presque 800 Canadiens pour l'aide médicale à mourir et la prestation de cette aide à plus de la moitié d'entre eux. Pendant mes plus de 30 ans de pratique comme médecin de famille, j'ai vu de multiples patients atteints de démence. En tant que chercheuse, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'aide médicale à mourir, y compris sur les directives anticipées.
La première partie de ma présentation va porter sur l'article que je vous ai envoyé, dont je vais souligner les principaux éléments.
Premièrement, la majorité des Canadiens veulent rédiger des directives anticipées. Un grand nombre d'autres chercheurs sont arrivés à la même conclusion. Nous avons demandé aux participants à notre étude s'ils voulaient avoir une demande anticipée dans certaines situations précises. Quatre-vingt-six pour cent ont répondu par l'affirmative. Nous allons donc nous retrouver avec des demandes anticipées. Si nous ne les avons pas en 2023, ce sera l'année suivante, ou à la prochaine législature, mais nous en aurons, car nous vivons dans une démocratie, et que c'est ce que veulent 86 % des Canadiens.
Notre étude traitait de la perte de dignité, notamment l'incapacité à aller aux toilettes; de la perte de liberté en étant, par exemple, enfermé dans une pièce verrouillée; de la perte de la capacité à reconnaître des membres de sa famille; de la perte de la mémoire à court terme; de la perte de la capacité à contrôler son propre comportement agressif ou déplacé.
La deuxième constatation vraiment importante de notre article est l'écart entre ce que souhaitent les gens et ce que les prestataires de l'aide médicale à mourir sont prêts à faire. Cet écart varie entre 19 % et 44 % selon les situations. Même si vous modifiez la loi, les demandes anticipées ne se concrétiseront pas pour autant. Notre groupe de recherche a travaillé fort pour trouver comment cela pourrait fonctionner. Nous avons bien sûr interrogé les prestataires de l'aide médicale à mourir et analysé leurs réponses.
Le plus utile serait d'établir une liste de circonstances précises et concrètes, bien visibles pour les praticiens, les membres de la famille et les prestataires de soins, stables — les personnes atteintes de démence peuvent aller très bien le matin, mais plus du tout en après-midi — et faciles à interpréter par les prestataires de soins.
Nous n'avons jamais travaillé avec les directives anticipées, mais nous avons de l'expérience avec la renonciation au consentement final. D'abord, nous constatons que les patients aiment cet outil. Ils sont très reconnaissants de ne pas avoir à se soucier du fait qu'ils pourraient perdre leurs capacités avant la date qu'ils ont choisie pour l'aide médicale à mourir. Ils sont vraiment soulagés, et je sais qu'ils le seront également lorsque les demandes anticipées seront mises en œuvre.
L'autre élément, c'est que les prestataires n'ont pas eu de difficulté à fournir l'aide médicale à mourir aux personnes qui avaient perdu... Pour ma part, j'ai signé plusieurs renonciations au consentement final, mais je n'en ai utilisé qu'à deux reprises. Les deux cas étaient limpides. Il faut mentionner toutefois que je connaissais ces personnes. Je les avais évaluées. Je leur avais parlé ou je les avais vues récemment. Cela n'aurait pas été la même chose si le patient avait été à un stade avancé de démence et que je ne l'avais jamais rencontré auparavant; tout aurait été à interpréter.
Habituellement, nous évaluons chaque cas séparément et nous regardons le portrait d'ensemble. Notre approche s'apparente à ce que les autres témoins ont dit. Idéalement, le patient a non seulement rédigé ses directives anticipées, mais il a également dit aux autres, pendant la progression de sa maladie, que c'est ce qu'il voulait.
La souffrance est en effet un gros problème. Si je voyais une charmante vieille dame atteinte de démence jouer avec ses poupées en ayant l'air parfaitement heureuse, serais‑je capable de mettre un terme à sa vie? Je ne pense pas, quoi qu'elle ait dit dans le passé.
Vous êtes coincés. Tout ce que peut faire le comité parlementaire, c'est de recommander une modification de la loi par l'ajout du mot « précis » pour que ce soit clair que la demande anticipée n'est pas une demande générale. La demande doit être très précise. Chaque cas doit continuer à être évalué séparément, exactement comme nous le faisons pour chaque cas d'aide médicale à mourir lorsque nous examinons la vie entière du patient, et non pas seulement quelques critères pointus.
:
Oui. Merci de la question.
Un élément clé réside dans le fait que la souffrance est extrêmement subjective. Il ne s'agit pas d'un point de référence objectif. La douleur intense peut s'avérer plus objective sur le plan médical, contrairement à la souffrance. Ainsi, sans la rétroaction du patient, la souffrance demeure un mythe sur lequel nous ne porterons pas de jugement lourd de valeurs afin de déterminer quelles vies valent la peine d'être vécues.
Pensons au projet de loi 38, dans la province de Québec, qui propose de modifier la Loi concernant les soins de fin de vie afin d'inclure des demandes anticipées. Le projet de loi stipule que la demande anticipée doit décrire en détail la souffrance physique et psychologique qui ne pourrait être suffisamment soulagée pour pouvoir être tolérée par le patient au moment de la rédaction de la demande. Puis, on mettrait en place un système de surveillance pour que le processus d'AMM puisse s'enclencher lorsque le patient manifeste des signes de cette souffrance.
Le problème, c'est que — pour revenir à l'exemple que j'ai employé tout à l'heure — si John, à l'âge de 50 ans, est en mesure de donner son consentement et d'expliquer qu'il éprouve une douleur intolérable telle que la mort serait préférable, la question est tranchée. Les médecins, les juges et les législateurs n'ont pas à poser la question existentielle absolument insoluble consistant à définir une vie qui vaut la peine d'être poursuivie. Ils doivent simplement respecter le fait que John a fait le choix existentiel que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Toutefois, cette notion de souffrance intolérable ne peut tout bonnement être transposée à la situation de quelqu'un qui ne peut faire ce choix, y compris d'un John maintenant âgé de 75 ans et atteint de démence avancée. La souffrance constitue effectivement une expérience complexe et subjective.
On peut mesurer la douleur. On peut traiter la douleur, et, au bout du compte, on peut complètement l'éliminer si rien d'autre ne fonctionne pendant la sédation profonde. Or, il n'est pas question de réaction à la douleur. L'AMM a été conçue comme étant une réaction à la souffrance existentielle — et est surtout utilisée ainsi — telle que la perte de la capacité à se livrer à des activités enrichissantes, la perte de la capacité à s'adonner à des activités de la vie quotidienne ou d'autres craintes liées à l'hygiène.
Le projet de loi 38 au Québec énonce qu'il existe un type spécial de souffrance. Ce type spécial de souffrance justifie l'AMM ou l'euthanasie, et les patients peuvent inscrire ce type particulier de souffrance dans leur demande anticipée. L'argument que je fais valoir, c'est que je ne sais pas exactement comment définir cette souffrance, à l'instar du Barreau du Québec, qui a rédigé un mémoire l'été dernier énonçant que la souffrance constitue une notion subjective, et non pas une norme objective.
Le groupe de travail se penchant sur l'AMM au sein du Barreau du Québec a affirmé se demander ce qu'entend le projet de loi 38 par ce type de souffrance « objectivable » qui peut être observée par un docteur, au même titre que les symptômes de dysfonctions physiologiques et de maladies. On peut présumer que le terme veut dire que la douleur est « objective » ou « vérifiable objectivement », mais la souffrance subjectivement intolérable qui est pire que la continuation de son existence ne semble pas vérifiable objectivement. Rien n'est objectivement vérifiable quant à la décision on ne peut plus personnelle que quelqu'un prend et qui s'élève au‑dessus de cet abîme de désaccords sur la valeur de la vie. Quand, d'une part, quelqu'un éprouve des difficultés sociales et physiques et décide de passer à...
:
Merci beaucoup, madame la présidente.
Il s'agit d'une question tellement difficile. Nous nous retrouvons à discuter des questions juridiques, de l'opinion des avocats, de l'avis des aidants, des sentiments et des opinions des familles. Au bout du compte, la personne centrale est le patient qui est piégé, ou pas — comme le Dr Poirier l'a expliqué — dans une position l'empêchant de prendre de telles décisions parce qu'une grande partie de ses cellules cérébrales sont mortes. Il faut arrêter d'employer un vocabulaire juridique et un jargon pour décrire ce qui, dans les faits, constitue une décision subjective très importante.
J'ai été très touchée par le récit du Dr Poirier qui nous a relaté que sa mère, pendant ses très rares moments de lucidité, l'a supplié et lui a communiqué qu'elle ne voulait pas continuer à vivre. Or, ses aidants, en raison de leur culture et de leur moralité, affirmaient qu'elle était heureuse et qu'elle devait continuer à vivre puisqu'ils lui apportaient du confort. C'est tellement triste. Je peux imaginer quelles réflexions lui passaient par l'esprit pendant ses moments de lucidité.
Les demandes et les consignes anticipées comportent une certaine importance. Lorsque des personnes possèdent des fonctions cognitives et sont en mesure de prendre des décisions, je crois qu'elles nous font part de leurs valeurs morales et de leur conscience d'elles-mêmes. Les patients nous en apprennent à leur sujet et, comme la Dre Wiebe l'a décrit, on apprend à connaître les patients sur une longue période; on connaît leur personnalité. Ainsi, lorsque les patients arrivent au stade où ils ne peuvent plus prendre ces types de décisions, le médecin connaît leurs croyances, leurs valeurs morales, leurs façons de penser, la valeur qu'ils accordaient à certains enjeux. La prise de cette décision doit se faire de façon continue et à long terme.
C'est une question. Je ne prononce pas de discours, mais je constate l'énigme à laquelle nous sommes tous confrontés. Il est tout à fait illogique de prétendre qu'on énoncera une déclaration juridique et claire qui constituera la décision pour tous. Il ne s'agit pas d'un enjeu générique. Il faut s'appuyer sur la situation précise de la personne et sur ce qu'on savait d'elle avant qu'elle ne se retrouve à ne plus pouvoir contrôler sa situation ou avant que d'autres ne prennent des décisions pour elle en fonction de sa demande anticipée.
Je crois que nous devons commencer à nous référer à ce que la Cour suprême a dit à l'origine, soit qu'il s'agit de décisions subjectives prises par chaque patient, qui peuvent diverger d'une personne à l'autre...
:
Est‑ce mieux? D'accord.
Je fais cette déclaration parce que je pense que nous réfléchissions à la question en tant que cliniciens, en tant que membres de la famille et en tant qu'avocats. Nous ne pensons pas à la personne pendant ses moments de lucidité, ses rares moments de lucidité — nous ne sommes peut-être même pas en mesure de lui parler pendant ces moments de lucidité — lorsqu'elle affirme fermement qu'elle ne veut plus être de ce monde ou qu'elle veut rester en ce bas monde et qu'elle désire continuer à vivre.
Nous sommes aux prises avec un problème très difficile. Je crois que si nous essayons d'analyser le problème sous l'angle juridique ou de la perspective des proches qui veulent que leur mère reste à leurs côtés plus longtemps et qui s'exclament: « Oh, regardez: maman a l'air heureuse. Elle joue avec des poupées. N'est-elle pas formidable? »... Ce sont là les enjeux qui ne doivent pas être tranchés par le gouvernement du Canada ou par les Canadiens: chaque patient doit choisir la forme que devrait prendre sa fin de vie et doit déterminer les choix qui s'offrent à lui.
Je ne connais pas la réponse. Nous vous demandons de venir nous parler et de nous donner des réponses parce que nous espérions que l'un d'entre vous nous ferait une grande révélation. Or, en fin de compte, je ne pense pas que la question est complètement entre nos mains. Je sais que le patient, cette personne unique, est au cœur de la décision.
Nous avons entendu le Dr Poirier, ainsi que la Dre Chung...
:
En matière de décisions aussi intimes que celle de notre propre mort, il me semble que le rôle de l'État n'est pas de décider à la place du patient, puisque ce n'est pas l'État qui va mourir à sa place ni son voisin. Le rôle de l'État est d'assurer les meilleures conditions d'exercice du libre-choix. Puisque le droit garantit le principe d'autodétermination tout au long de notre vie, pourquoi donc, au moment le plus intime de notre vie, soit la fin, passerait-on outre au principe d'autodétermination? C'est un principe de base.
Nul ne peut non plus s'octroyer le droit de décider de la qualité de vie d'une personne en la comparant à la qualité de vie d'une autre. C'est un autre principe. Il revient donc strictement à la personne, du patient, de décider finalement de sa qualité de vie, de son seuil du tolérable.
Sandra Demontigny nous disait qu'elle allait écourter sa vie si les législateurs que nous sommes ne le permettaient pas. C'est d'ailleurs l'esprit de l'arrêt Carter et celui du jugement Baudouin: on porte atteinte au droit à la vie, parce que les gens seront portés à écourter leur vie plutôt qu'à vivre le plus longtemps possible. Je ne connais personne qui, atteint d'une maladie, ne veut pas vivre le plus longtemps possible.
Ce que ces gens demandent donc à l'ensemble des citoyens, c'est qu'on leur garantisse que, le matin où ils se lèveront et jugeront qu'ils ont franchi leur seuil du tolérable, on va les aider à partir. Il me semble que c'est un contrat moral tout à fait acceptable. Il est de l'ordre de la bienveillance et de la bienfaisance, parce qu'on ne peut pas être bienfaisant au nom de quoi que ce soit si on porte atteinte à l'autonomie de la personne. Ce sont les principes qui guident finalement ma façon de comprendre le débat actuel.
Ce qui est douloureux, dans le débat que nous avons, c'est le fait qu'une personne peut perdre, dans un processus dégénératif, sa capacité à donner son consentement. Or le projet de loi a permis d'enlever l'exigence de consentement final pour les personnes en phase terminale de vie. Tout est très clair, alors je ne vois pas pourquoi on ne respecterait pas les dernières volontés d'une personne. Ce que nous, nous devons essayer de faire, c'est permettre les meilleures conditions d'exercice du respect de cette volonté.
En ce sens, docteure Wiebe, que devrions-nous faire pour que cette volonté soit respectée et que les doutes que nous voyons émerger ce matin puissent être en quelque sorte balayés, contournés ou écartés?


On ne peut garantir d'écarter ces doutes. C'est ce que j'essayais de communiquer. Ce n'est pas possible. Vous devez recommander une modification à la Loi qui permettra les demandes anticipées, parce que c'est ce que les Canadiens veulent. Ils y tiennent. La plupart d'entre eux veulent de ces demandes anticipées parce que la fin de vie peut s'accompagner de souffrances effroyables qui peuvent être évitées et qui horrifient certains d'entre nous. Or, il est impossible de réellement veiller à ce que... parce que nous disposons d'un nombre limité de fournisseurs d'AMM. Nous n'en avons pas suffisamment pour le premier volet composé des patients dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Nous sommes loin d'en avoir suffisamment pour le deuxième volet, qui est composé des patients dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. En mars, nous n'en aurons pas assez pour les patients dont un trouble mental constitue le seul problème médical invoqué. Puis, nous ne disposerons pas d'assez de fournisseurs pour les patients munis d'une demande anticipée qui doit être respectée.
Je dirai néanmoins que, pour offrir les meilleures circonstances possible à la majorité des patients, il faut d'abord que le patient soit très précis. Il doit même être précis sur des réalités comme celle-ci: « Si je joue, tout sourire, avec des poupées, je ne veux pas continuer cette sorte de vie. » Puis, vous devez confier la tâche aux cliniciens, comme vous le faites actuellement, et nous devons étudier chaque cas individuellement. Dans ce type de dossiers, je me réfère aux directives écrites du patient. J'essaie de déterminer quels étaient leurs objectifs de vie en général. Le patient était‑il de ceux qui ont dit à leurs enfants, 20 ans auparavant, qu'ils ne voulaient jamais vivre dans un état de démence? Faisaient-ils partie de ce groupe? Cette croyance était-elle ancrée en eux? Ces renseignements faciliteront mon travail si je dois administrer l'AMM.
On ne pourra jamais entièrement régler le problème, mais on peut faire ce qu'il y a de mieux pour la majorité des patients.
:
Je remercie les témoins.
Notre comité a eu la chance inouïe d'écouter une vaste gamme d'expériences subjectives liées à la démence, que ce soit de la perspective de la pratique clinique ou de liens familiaux personnels d'autres personnes ayant souffert de la maladie. Parfois, la perspective adoptait les deux points de vue. Nous avons accueilli des experts en démence dont un proche souffre de la maladie.
Docteure Wiebe, j'aimerais d'abord m'adresser à vous. Dans votre déclaration préliminaire, vous avez parlé de votre recherche et du recensement des attitudes et de l'appui par rapport aux demandes anticipées ainsi que des raisons les justifiant. Vous avez mentionné la crainte de perdre sa dignité, de perdre sa liberté, de perdre la mémoire et de ne plus reconnaître ses proches parents.
Il va sans dire que le thème de la stigmatisation associée à la démence est souvent revenu en comité. Je sais que la seule mention du mot « démence » évoque un éventail d'émotions négatives pour bien des gens.
Dans le cadre de votre recherche, les répondants ont exprimé leurs opinions quant à la démence et leur appui pour les demandes anticipées. Votre recherche a‑t‑elle décelé des tendances dans ce qui influence les attitudes à l'égard de la démence? Certains ne connaissent peut-être pas très bien la maladie, mais d'autres comptent dans leur entourage des personnes souffrant de la maladie de qui ils sont extrêmement proches, et sont donc bien au fait de la démence.
Voulez-vous nous faire part d'autres réflexions sur ce thème?
Je veux juste commenter les propos de M. Beaudry quant aux demandes anticipées rédigées à l'âge de 60 ans qui ne tiennent peut-être plus la route à l'âge de 75 ou 80 ans.
Je veux simplement rappeler que c'est ce que nous faisons constamment en vertu de la loi, légalement, dans ce pays. Nous rédigeons des testaments. Nous les laissons auprès d'avocats. Ils ont pu être rédigés il y a cinq, 10 ou 20 ans. Nous nous munissons d'ordonnances de non-réanimation. Nous avons maintenant des renonciations au consentement final. La pratique est employée pour de nombreuses réalités.
Le texte de loi que je propose au Sénat s'appuie sur des consultations auprès de personnes qui font partie du processus depuis très longtemps. Nous proposons qu'il y ait une longue liste — pour revenir à l'argument de la Dre Wiebe — de circonstances très précises en vertu desquelles une personne ne veut pas vivre et désire mettre sa demande anticipée en application. Nous ne voulons pas de formulations telles que « Je ne peux pas me nourrir le mardi, », mais nous voulons qu'elles soient très précises: « Je ne suis plus en mesure de me nourrir régulièrement. » La liste comprend tous les éléments qu'elle a déjà soulignés.
L'autre élément que je trouve essentiel est que les mises à jour doivent s'effectuer sur une base régulière. Nous avons proposé des mises à jour quinquennales. Je serais tout à fait à l'aise de proposer des mises à jour tous les trois ans. Je crois que nous devons choisir l'option qui rassurera la majorité de la population sur cette question.
Puis, nous en arrivons au rôle très important des décideurs remplaçants. Ils ne peuvent simplement se présenter cinq minutes avant la demande. Ces décideurs remplaçants doivent participer au processus garantissant que la demande est à jour. Cela représente un engagement énorme de la part des décideurs remplaçants, mais je crois que c'est la seule façon de procéder. Si vous êtes un de mes deux décideurs remplaçants, vous devrez participer au processus de mise à jour et participer à un entretien, peut-être, avec un avocat, un médecin ou un autre professionnel de la santé dans ce domaine. Le problème réside dans le fait que les médecins de familles des patients ne seront peut-être pas ceux qui leur administreront l'AMM. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Les décideurs remplaçants doivent être très au fait des volontés des patients, et ce, depuis longtemps.
Je crois que ce sont là toutes les mesures de protection qu'on peut mettre en place tout en respectant les opinions des patients, énoncées à maintes reprises, quant à la qualité de vie et la mort dans la dignité.
Docteure Wiebe, ajouteriez-vous quelque chose à cette liste que je devrais prendre en considération?
Je vais vous répondre en anglais, si cela ne vous dérange pas.
[Traduction]
Je n'ai pas encore mûrement réfléchi à des solutions précises à cet enjeu très difficile. Toutefois, ma propre recherche semble indiquer qu'il vaudrait la peine de se pencher sur la distinction établie, notamment, par le Conseil des académies canadiennes entre les différents scénarios: les demandes anticipées rédigées lorsque le patient est déjà admissible à l'AMM; les demandes anticipées après le diagnostic, mais avant l'admissibilité à l'AMM; et les demandes anticipées rédigées avant tout diagnostic. Je crois que tout le monde gagnerait à étudier la distinction entre ces trois scénarios.
Il va sans dire que le dernier scénario représente celui où mon argument s'appliquerait le plus fortement puisqu'il n'y a plus de continuité entre les souhaits antérieurs et les souhaits actuels. J'imagine que bien des membres de la communauté des personnes handicapées seraient alertés d'entendre que la dignité est liée au port de couches ou à l'aide reçue pour l'hygiène personnelle, et qu'on peut stipuler... Je viens d'entendre de nombreux arguments — que je trouve fort intéressants — qui ouvriraient la porte au respect de l'autonomie du patient, mais c'est là mon argument: la personne n'est fondamentalement plus la même.
Si la demande a été rédigée récemment, c'est une autre paire de manches. Dans le cas des demandes rédigées il y a longtemps, rappelons-nous que la société canadienne ne donne à personne le pouvoir — même s'il y a un consensus démocratique ou que la population s'entend d'une autre façon — de porter des jugements décidant de la vie et de la mort de quelqu'un sur la base d'arguments ancrés dans le capacitisme ou l'âgisme. Ces personnes devraient recevoir nos soins, et les régimes de protection sont habituellement, en vertu de nos lois, conçus pour protéger la personne tout en tenant compte, bien entendu, de son autonomie résiduelle et de son autonomie passée. Or, c'est un peu curieux de juger l'autonomie passée en tenant compte de détails aussi précis que « quand je ne serai plus en mesure de faire X. » Cette évaluation ne serait jamais acceptée si on tient compte du bien-être de quelqu'un et si on essaie d'imaginer un état tellement sombre qu'il nécessite la mort. Il s'agit d'un choix immensément personnel qui exige la capacité à donner son consentement.
J'ai écrit à ce sujet dans le cas d'une euthanasie non volontaire, et je crois que certains des arguments s'appliquent à la situation qui nous occupe. Je serai heureux de vous acheminer mon texte. Comme le sujet est très dense sur le plan philosophique, je ne suis pas en mesure de rendre justice à mon texte ici, mais c'est avec plaisir que je l'enverrai au Comité.
Merci.
:
Merci, monsieur Beaudry.
Je crains que le temps joue contre nous. Le temps consacré à ce groupe de témoins est écoulé, mais permettez-moi de tous vous remercier.
[Français]
Je tiens à remercier le Dr Beaudry,
[Traduction]
ainsi que Mme Sokolowski et la Dre Wiebe.
Je vous remercie de nous avoir consacré du temps aujourd'hui et, dans votre cas, docteure Wiebe, au petit matin, puisque vous vous trouvez probablement en Colombie-Britannique.
Merci beaucoup. Nous vous sommes reconnaissants de votre franchise et de vos opinions passionnées sur ce sujet des plus difficiles.
Sur ce, nous concluons la discussion avec ce groupe de témoins.
La séance est maintenant levée.