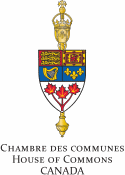:
Bonsoir, tout le monde.
Bienvenue à la 22e réunion du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir.
Je souhaite la bienvenue aux membres du Comité, aux témoins ainsi qu'aux gens du public qui suivent cette réunion sur le Web.
Je m'appelle Marc Garneau et je suis le représentant de la Chambre des communes qui copréside ce comité. Ce soir, je suis accompagné de l'honorable Marie‑Françoise Mégie, la vice-présidente du Comité représentant le Sénat.
[Traduction]
Nous poursuivons aujourd'hui l'examen prévu par la loi des dispositions du Code criminel concernant l'aide médicale à mourir et leur application.
Je voudrais rappeler aux membres du Comité et aux témoins de laisser leurs microphones en sourdine à moins que la présidence ne leur accorde la parole. Toutes les interventions doivent s'adresser à l'un des présidents. Quand vous intervenez, parlez lentement et intelligiblement.
L'interprétation de la présente vidéoconférence fonctionnera comme lors d'une séance en personne. Le bouton d'interprétation, situé en bas de votre écran, vous permet de choisir entre le parquet, l'anglais ou le français.
Sur ce, je voudrais souhaiter la bienvenue aux témoins de notre premier groupe, qui traiteront des demandes anticipées.
Nous recevons Adelina Iftene, professeure de droit, qui témoigne à titre personnel.
[Français]
Nous accueillons également, par vidéoconférence, le Dr David Lussier, médecin gériatre, ainsi que le Dr Félix Pageau, gériatre et chercheur.
Je vous remercie tous les trois de vous joindre à nous.
Nous allons d'abord entendre l'allocution d'ouverture de Mme Iftene, suivie de celle du Dr Lussier et de celle du Dr Pageau.
[Traduction]
Madame Iftene, vous avez la parole pour faire votre allocution d'ouverture de cinq minutes. Vous pouvez y aller.
:
Mon expertise ne concerne pas les directives anticipées ou l'AMM en général. Elle se situe plutôt dans les domaines des services correctionnels, des lois et des politiques en matière de soins de santé pour les personnes incarcérées, et des questions entourant la décarcération. Par conséquent, mon exposé d'aujourd'hui portera sur les questions que soulève la mise en œuvre de l'AMM en prison, des questions qui auraient dû être étudiées en priorité dans le cadre de l'examen des lois relatives à l'AMM.
Le débat sur l'AMM en prison s'est jusqu'à présent largement limité à des solutions dichotomiques. Les personnes incarcérées devraient-elles avoir accès à l'AMM? La procédure d'AMM devrait-elle avoir lieu dans l'établissement correctionnel ou quelque part dans la communauté?
Je veux être claire. Dans la mesure où l'AMM est un service de soins de santé au Canada et vu les circonstances dans lesquelles elle est donnée, selon le principe d'équivalence des soins protégé à l'échelle nationale et internationale, elle doit être offerte dans les mêmes conditions aux personnes incarcérées. Cette réponse simplifie toutefois à outrance la question, et ce, parce que les questions auxquelles elle répond passent complètement à côté du problème de la maladie et de la mort en prison.
On sait parfaitement que les soins de santé en prison — qu'il s'agisse des soins de base, des soins de santé spécialisés et particulièrement des soins palliatifs et à long terme — sont profondément inadéquats et souvent non conformes aux normes communautaires. Moi et d'autres parties prenantes, particulièrement le Bureau de l'enquêteur correctionnel, recueillons depuis longtemps des informations sur les lacunes systémiques des soins de santé, et je ne pense pas que ces lacunes puissent encore faire l'objet d'un débat raisonnable et éclairé.
Il est également manifeste que le Canada n'a pas de mécanisme fonctionnel de libération pour motif humanitaire. L'article 121 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui porte sur la libération conditionnelle en cas exceptionnels, a été invoqué 20 fois en 10 ans avant la pandémie de COVID, et elle ne peut généralement pas être utilisée pour les personnes condamnées à perpétuité. Par ailleurs, au cours de la même période, de 30 à 40 personnes sont mortes de cause naturelle et prévisible en prison chaque année. Le recours à l'article 121 ne s'est pas amélioré à la suite de la mise en œuvre de l'AMM en prison il y a quelques années.
Le fait est que dans un pays où il n'y a pas de peine de mort et de peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération, la première cause de décès en prison est la mort naturelle survenant à la fin de ce qui est souvent une maladie connue pour laquelle la personne avait peu ou pas d'options adéquates de traitement.
Si l'AMM constitue la seule option adéquate et réaliste à la souffrance, les peines canadiennes deviennent de fait des peines de mort. Il est inacceptable qu'en prison, il soit plus facile d'obtenir l'AMM que n'importe quel genre de libération pour motif humanitaire.
Par exemple, une personne qui purge une peine de prison à perpétuité ne peut même pas demander de libération conditionnelle pour cas exceptionnel à moins qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Or, nous savons que ce n'est pas le cas pour l'AMM. Pour lire des analyses sur la question et sur la libération pour motif humanitaire et son application au Canada, j'attirerais votre attention sur les articles que j'ai écrits ou coécrits avec Mme Jocelyn Downie, que je vous ai remis à l'avance.
Le problème qui fait qu'il est plus facile d'obtenir l'AMM qu'une libération, ce n'est pas l'AMM, selon moi. Le simple fait de rendre l'AMM interdite ou plus difficile d'accès aux personnes incarcérées n'est pas une solution au manque de choix, de dignité et l'autonomie de ces personnes, et ne respecte pas l'obligation d'équivalence des soins. Le fait de laisser les gens souffrir n'améliorera pas leur dignité ou leur autonomie.
Le problème n'est pas l'accès des prisonniers à l'AMM, mais l'absence de mécanismes de libération et de soutiens adéquats. Toute personne qui a une maladie grave limitant son espérance de vie ou qui éprouve des souffrances intolérables devrait être admissible à une forme fonctionnelle de libération pour motif humanitaire. Il faut autoriser la libération pour motif humanitaire pour que les personnes puissent non seulement recevoir la procédure d'AMM dans la communauté, mais aussi y prendre toutes les décisions relatives à la fin de vie, qu'elles choisissent ou non l'AMM.
Les débats sur la réforme substantielle des mécanismes de libération — qui portent sur l'admissibilité à la libération, les facteurs pertinents pour la décision de libération et l'expertise des membres de la commission des libérations conditionnelles à cet égard — sont tous intrinsèquement liés au débat général sur la mise en œuvre de l'AMM en prison.
Les modifications substantielles aux lois régissant l'AMM doivent tenir compte des personnes incarcérées et, par conséquent, devront faire en sorte que ces personnes aient des options réalistes de libération dans la communauté, où elles pourront prendre des décisions de fin de vie éclairées.
En terminant, je voudrais souligner qu'il reste un certain nombre de questions non résolues à propos de l'AMM, en plus de celle du manque d'autres options, comme les soins palliatifs et la libération. Parmi ces questions figure le fait que Service correctionnel Canada est exempté de soumettre les morts par AMM à un examen et une enquête, ce qui engendre un manque de supervision adéquate, et le rôle des médecins de prison dans le processus d'évaluation. Je traiterai avec plaisir de ces points pendant la période de questions.
Je vous remercie.
:
Merci, monsieur le président.
Je vous remercie de l'invitation à venir discuter avec vous de ce sujet important.
Je vais commencer par quelques mots de présentation.
Je suis gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre‑Sud‑de‑l'Île‑de‑Montréal. J'ai suivi une formation complémentaire en douleur et en soins palliatifs. Depuis une vingtaine d'années, ma pratique est presque exclusivement en clinique de gestion de la douleur chronique pour personnes âgées.
Je m'intéresse à l'aide médicale à mourir depuis le début de la réflexion sur le sujet au Québec. Je suis membre de la Commission sur les soins de fin de vie du Québec. Je tiens cependant à préciser que je ne m'exprime pas ici au nom de la Commission, mais à titre personnel.
Je pratique l'aide médicale à mourir de une à deux fois par mois, en moyenne, parfois pour des patients que je suis depuis très longtemps, parfois pour des patients pour lesquels je suis demandé en consultation expressément pour ce soin. En raison de mon expertise clinique, les personnes que j'évalue sont habituellement celles dont l'admissibilité n'est pas claire ou dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. Certaines de ces personnes ont des troubles neurocognitifs majeurs.
Je donne aussi des conférences sur l'aide médicale à mourir assez régulièrement à des professionnels de la santé et à la population générale.
J'aimerais vous présenter les points les plus importants au sujet des demandes anticipées d'aide médicale à mourir pour les personnes ayant un trouble neurocognitif majeur.
D'abord, je ne peux évidemment pas me prononcer sur l'opinion des Canadiens de partout au pays. Je peux cependant me fier aux témoignages entendus à la commission parlementaire spéciale de l'Assemblée nationale du Québec, l'automne dernier, et à ceux que je recueille dans mes conférences sur le sujet ou dans ma pratique. À la lumière de ceux-ci, je crois qu'il existe au Québec une acceptation assez large des demandes anticipées, autant dans la population que chez les personnes ayant un trouble neurocognitif majeur et leurs proches. Il y a aussi une acceptation assez grande chez les professionnels de la santé, même si plusieurs entrevoient des difficultés d'application. Au Québec, la population s'attend donc à ce que l'aide médicale à mourir puisse devenir possible par demande anticipée, et plusieurs personnes ont été très déçues quand le projet de loi à ce sujet a dû être abandonné, au printemps.
Dans la situation actuelle, depuis que le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible a été retiré, les personnes ayant un trouble neurocognitif majeur peuvent être admissibles à l'aide médicale à mourir et la recevoir. Il y a effectivement une petite période, dans l'évolution de la maladie, où le trouble est assez grave pour qu'il y ait un déclin avancé et irréversible des capacités, mais pas encore assez grave pour compromettre l'aptitude à demander l'aide médicale à mourir. D'après mon expérience, les personnes ayant un trouble neurocognitif majeur qui demandent l'aide médicale à mourir actuellement attendent le plus longtemps possible avant de le faire. Souvent, elles le font juste avant de perdre leur aptitude, à un point tel que le délai de 90 jours doit parfois être raccourci, car la perte d'aptitude est imminente. Si elles pouvaient faire une demande anticipée, plusieurs d'entre elles choisiraient probablement de ne pas demander l'aide médicale à mourir au même moment, pour continuer à profiter de bons moments avec leurs proches. Elles meurent donc plus tôt qu'elles ne l'auraient souhaité. En ce sens, on pourrait affirmer que leur droit à la vie, garanti par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, est bafoué, tout comme la Cour suprême en avait jugé dans l'arrêt Carter, puisque, pour pouvoir avoir recours à l'aide médicale à mourir et ne pas vivre la détérioration jusqu'à la fin, ces personnes doivent mourir plus tôt qu'elles ne l'auraient souhaité.
Je crois donc que la loi devrait être modifiée pour permettre les demandes anticipées d'aide médicale à mourir pour les personnes ayant un trouble neurocognitif majeur. C'est néanmoins une question fort complexe, tant sur le plan de l'éthique que de l'application. D'abord, il est très difficile d'évaluer la souffrance, qui est, par définition, l'expérience subjective d'une personne incapable de la communiquer. Dans certains cas, il existe une souffrance objectivable indéniable, qui s'accompagne de signes non verbaux de douleur ou de symptômes psychologiques et comportementaux associés à la démence, comme l'agressivité. Dans d'autres cas, qu'on appelle, à tort ou à raison, les démences heureuses, la personne est heureuse au quotidien malgré les troubles cognitifs et la perte d'autonomie. Par contre, si elle s'était vue dans cet état, elle n'aurait peut-être pas voulu le vivre. Le critère d'admissibilité devrait-il être la souffrance contemporaine ou la souffrance anticipée? C'est une question importante et complexe à laquelle il faudrait répondre.
Une autre question importante se pose vis-à-vis de la situation où la personne ayant fait une demande anticipée refuse de collaborer quand vient le moment de lui administrer l'aide médicale à mourir. Dans un stade avancé, plusieurs personnes résistent à tout contact ou soin et deviennent agressives quand on les touche. Elles n'accepteraient donc pas l'installation d'une intraveineuse sans être mises au préalable sous sédation ou en contention. Même si une personne souhaitait probablement, lorsqu'elle était apte, qu'on la mette sous sédation ou en contention pour lui administrer l'aide médicale à mourir, doit-on passer outre à son refus, verbal ou physique, lorsqu'elle n'est plus apte? Plusieurs cliniciens disent qu'ils auraient beaucoup de difficulté à le faire, surtout si la personne ne présente pas de signes de souffrance objectivable.
En résumé, je crois que la loi devrait être modifiée pour permettre de demander l'aide médicale à mourir de façon anticipée. Les lignes directrices et les guides de pratique devraient toutefois être très clairs pour accompagner les cliniciennes et les cliniciens qui seraient impliqués au moment de la demande ou de l'administration de l'aide médicale à mourir.
Je suis médecin, chercheur en éthique et gériatre. Je connais bien le Dr Lussier, mais je ne suis pas d'accord sur sa position et je vais vous expliquer pourquoi.
En préambule, je dois dire que je suis reconnaissant de participer de nouveau aux travaux du Comité. Lors de ma dernière comparution, j'ai parlé des contextes un peu plus philosophiques et éthiques. Aujourd'hui, je vais parler du contexte un peu plus pratico-pratique.
Je suis conscient que la responsabilité du médecin est de respecter l'autonomie du patient. Bien sûr, les principes de bientraitance et de non-maltraitance doivent être appliqués. Le gouvernement doit protéger les gens vulnérables et protéger les gens contre eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a fixé un âge légal pour la consommation d'alcool ou encore obligé le port de la ceinture de sécurité en voiture et du casque à moto. La liberté d'autonomie n'est donc pas absolue au Canada; elle est encadrée.
J'ai trois arguments à faire valoir et des clarifications à apporter. Si le temps me le permet, j'aurai aussi des recommandations à proposer.
Mes trois arguments s'orientent autour des éléments suivants: l'erreur commise par l'individu qui rédige ses directives anticipées d'aide médicale à mourir, l'erreur des personnes qui les appliquent, de même que les questions sociétales en lien avec l'aide médicale à mourir par demande anticipée chez les gens atteints de troubles neurocognitifs majeurs.
Pour ce qui est de l'erreur dans la rédaction des directives anticipées, la difficulté vient du fait que les gens n'ont pas de boule de cristal leur permettant de connaître l'avenir de façon absolue. L'autonomie doit s'appliquer dans le moment présent et ne peut être anticipée. Il faut aussi se demander avec qui seront faites ces directives anticipées. Est-ce que ce sera avec un spécialiste en démence ou en troubles neurocognitifs majeurs, en l'occurrence un gériatre, un gérontopsychiatre ou un médecin de famille qui voit beaucoup de ce type de patients? Il va falloir ouvrir des cliniques d'aide médicale à mourir. A-t-on les ressources nécessaires? Le médecin risque-t-il d'être paternaliste dans son expertise auprès de ces patients? L'autonomie ne serait alors pas entièrement respectée.
Le soi changeant est un autre argument connu, selon lequel des moments importants de la vie, comme le fait de recevoir un diagnostic de trouble neurocognitif majeur, changent la personnalité d'un individu. Souvent, les familles nous disent qu'elles ne reconnaissent plus leur proche qui a reçu un tel diagnostic. La personne n'est plus celle qu'elle était. Il y a donc un changement majeur. Ce que la personne a dit il y a 20 ans est-il encore applicable aujourd'hui, au moment de procéder à l'aide médicale à mourir?
Par ailleurs, ceux qui vont appliquer les directives d'aide médicale à mourir peuvent commettre plusieurs erreurs. D'abord, tout texte écrit nécessite une interprétation. Qu'il s'agisse de textes de loi, de textes littéraires ou même de textos, on doit toujours interpréter ce qui est écrit, surtout si la personne n'est pas là pour nous dire exactement ce qu'elle veut dire. Cette interprétation peut engendrer plusieurs erreurs. Il peut s'avérer que les directives anticipées ne sont pas du tout applicables. Dans ce cas, elles ne seront pas appliquées, ce qui est donc un moindre mal. C'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent aux Pays‑Bas. À l'inverse, il y a le danger qu'elles soient appliquées outre mesure, en raison de conflits d'intérêts chez les médecins ou parmi les membres de la famille, que ce soit par désir de toucher un héritage ou par désir de libérer des lits ou de libérer l'urgence de patients ayant des troubles neurocognitifs majeurs. Quand l'équipe médicale et la famille décident à la place du patient, ce n'est pas l'autonomie qui prévaut, mais bien une certaine forme d'expertise paternaliste.
S'il n'y a pas de refus, est-ce vraiment un consentement? Des gens qui disent tout simplement oui, sans comprendre tout ce que cela implique, ne donnent pas réellement leur consentement. C'est quelque chose qu'on entend souvent à l'hôpital. Si une personne dit, par exemple, qu'elle veut qu'on lui enlève l'utérus, doit-on le lui enlever? Est-ce que la personne a vraiment bien compris? Les directives anticipées ne permettent pas de résoudre ce problème. L'assentiment, même implicite, n'est pas un consentement.
Sur le plan sociétal, l'argument est peut-être un peu plus philosophique. On parle ici de la « démentophobie », c'est-à-dire de la crainte des gens d'être atteints d'une maladie mentale. C'est la stigmatisation des troubles neurocognitifs majeurs, ainsi que des handicaps et des symptômes comportementaux et psychologiques qui y sont associés, qui cause cette crainte et amène les gens à se projeter dans l'avenir. En raison de cette discrimination, ils ne veulent pas devenir ces gens qui sont laissés pour compte.
J'aimerais maintenant apporter quelques clarifications. Tout d'abord, l'aide médicale à mourir, ce n’est pas la même chose que des directives médicales anticipées. Il y a effectivement une différence entre exiger un soin, comme l'aide médicale à mourir, et refuser des soins jugés futiles. Aussi, l'aide médicale à mourir n'est pas comme un retrait de soins. Comme pour ce qui établit la distinction entre un meurtre au premier degré, de la négligence ayant causé la mort et un accident ayant causé la mort, ce sont les intentions qui comptent. Selon qu'il s'agit de directives anticipées d'aide médicale à mourir ou d'un retrait de soins, les intentions sont différentes.
En ce qui a trait à mes recommandations, je crois que le gouvernement doit protéger les plus vulnérables. Il doit aussi augmenter le financement accordé à la promotion du travail en soins palliatifs, gériatriques et gérontopsychiatriques. De plus, il doit en améliorer l'accès en faisant la promotion des emplois essentiels à ces soins. Enfin, il doit éviter à tout prix la « démentophobie » et ne pas en faire la promotion, contrairement à ce que font certaines personnes qui défendent l'aide médicale à mourir par directives anticipées.
:
Je vous remercie, madame Iftene, de cette réponse.
Bien entendu, une partie du problème vient du fait qu'en l'absence des soins médicaux adéquats dans le système pénal, il me semble difficile d'ajouter des soins comme l'AMM. Je vous remercie de cette réponse.
Je m'adresserai au Dr Lussier, si vous le permettez.
Vous avez fait remarquer que la question est très difficile, et je pense que votre collègue, le Dr Pageau, a peut-être énuméré certaines des difficultés qui se présentent à cet égard. Il semble que vous ayez peut-être des idées différentes. Je me demande, docteur Lussier, si vous pourriez traiter du délai entre le moment où on émet une directive anticipée et celui où il peut être nécessaire de mettre fin à la vie. Des difficultés se posent-elles à ce chapitre, docteur? Quelles mesures de protection pourraient s'avérer nécessaires à ce sujet?
:
Je comprends cela. Là, vous parlez de la perception du patient. J'aimerais savoir ce qu'il en est du point de vue du professionnel de la santé.
Nous avons entendu beaucoup de professionnels parler des mesures de protection et de tout cela. Corrigez-moi si je me trompe, mais, peu importe la province canadienne où l'on se trouve, je n'ai pas l'impression que des professionnels de la santé ont dit à des patients qu'il n'y avait pas de spécialistes pour traiter leur maladie et que, par conséquent, s'ils voulaient l'aide médicale à mourir, on la leur administrerait.
Je cherche à connaître le point de vue de la profession. Avez-vous vu de vos pairs administrer l'aide médicale à mourir parce qu'il n'y avait pas d'autres traitements disponibles?
:
Non, évidemment. Il ne serait pas possible de faire cela dans le contexte actuel, parce que la personne doit avoir un déclin avancé de ses capacités pour être admissible à l'aide médicale à mourir.
Quand on pose un diagnostic, habituellement, on s'assure que la personne a fait un testament et un mandat en cas d'inaptitude. On s'assure qu'elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour la gestion de sa personne et de ses biens. Cependant, on ne va pas, dans la même phrase ou dans la même rencontre, lui parler d'aide médicale à mourir.
Il y a un grand débat au sein de la profession médicale sur ce point précis: devrait-on proposer l'aide médicale à mourir parmi les options thérapeutiques à quelqu'un qui y est visiblement admissible, ou devrait-on s'abstenir de le faire? Il n'y a pas de consensus. Pour ma part, je considère qu'on doit attendre que la demande d'aide médicale à mourir vienne de la personne, plutôt que de la proposer comme une option thérapeutique. C'est une prise de position qui peut être critiquable, mais c'est la mienne.
Je poserai mes questions au Dr Pageau.
Vous avez abordé deux sujets dans votre allocution.
D'abord, il peut y avoir des problèmes d'erreur d'interprétation des instructions écrites du patient, particulièrement quand ce dernier a perdu la capacité d'aider quelqu'un à interpréter son intention initiale. Vous avez également indiqué que la démence est stigmatisée. Je veux vous interroger sur ces deux points, car des témoins précédents ont indiqué qu'il faudrait établir des critères objectivement évaluables et très faciles à comprendre, comme, par exemple: « Quand j'aurai atteint un certain stade de démence, voici ce que je voudrais qu'il se passe. »
Je comprends que la maladie d'Alzheimer est stigmatisée et pas très bien comprise. D'un autre côté, n'est‑il pas paternaliste de notre part d'évaluer les sentiments de quelqu'un à l'égard de la démence, particulièrement si cette personne a déjà vécu avec un membre de la famille atteint de démence, et comprend intimement la maladie et sait ce qui l'attend?
J'aimerais que vous traitiez de ces deux points, si vous le voulez bien.
:
Effectivement, c'est une question d'interprétation. Le tiers doit amorcer la demande, comme on l'a mentionné précédemment, et le médecin doit ensuite déterminer si celle-ci est valide. Il examine alors ce que le patient a écrit.
Les critères cités sont souvent l'incontinence et le fait de ne pas reconnaître sa famille. Or, ces critères peuvent arriver assez tôt dans l'évolution de la démence, mais la personne peut quand même être heureuse. Il y a des gens qui ne veulent justement pas utiliser le terme « démence », étant donné qu'il est tellement péjoratif pour certains. Cela montre à quel point il y a de la « démentophobie » dans la société.
Par ailleurs, mon collègue parlait du malaise qu'on peut ressentir à l'idée de proposer l'aide médicale à mourir et du fait qu'on préfère parfois attendre que le patient la demande. Pour ma part, quand l'un de mes patients a une infection, je n'attends pas qu'il me demande des antibiotiques; je sais que c'est le traitement offert et je le lui suggère. Le patient peut alors décider de l'accepter ou non. Quand je sais qu'un traitement est bon, je le propose sans attendre qu'on me le demande.
Il est intéressant de constater ce malaise à l'égard de l'aide médicale à mourir. Si les médecins attendent que les patients la leur demandent, c'est peut-être qu'ils ne sont pas à l'aise de la proposer. Ce malaise est peut-être alimenté aussi par la « démentophobie ». Le mot « démence » fait tellement peur que certains, aux États‑Unis, ont décidé d'appeler cela un « trouble neurocognitif majeur ». La stigmatisation liée à la démence est connue et présente.
Quand une personne est rendue à un stade avancé de démence et que l'équipe médicale tente de déterminer si le fait de ne pas reconnaître ses proches représente assez de souffrances pour justifier l'aide médicale à mourir, on se base sur des critères possiblement « démentophobes ».
Je poserai ma prochaine question à Mme Iftene.
Je vous remercie de nous avoir donné votre point de vue sur l'expérience que vivent les prisonniers dans les prisons fédérales, un sujet dont il n'est pas souvent abordé, je pense. Au cours de l'été, j'ai visité deux établissements fédéraux situés en Colombie-Britannique. L'expérience a été fort instructive.
Vous avez longuement parlé des soins de santé inférieurs aux normes offerts aux prisonniers des établissements fédéraux. Pour les patients qui se trouvent peut-être dans une prison à sécurité maximale parce qu'ils ont commis un crime très grave pour lequel ils ont été condamnés à une peine à perpétuité, comment progressent-ils de façon générale quand ils commencent à présenter des symptômes de démence et ne peuvent manifestement pas se conformer à la routine habituelle de la prison ou même d'agir en interaction avec les gardiens ou les autres prisonniers? Sont-ils transférés dans un établissement à sécurité réduite?
Pourriez-vous parler brièvement des prisonniers qui reçoivent un diagnostic de troubles neurocognitifs et qui commencent à présenter des symptômes?
:
Vous avez raison, il s'agit d'une demande anticipée.
Vous avez parlé de ce qui arrive lorsqu'on fait une demande anticipée. L'acte médical se fera plus tard. Les soins de fin de vie seront administrés alors que la personne n'aura plus la capacité de consentir.
Actuellement, compte tenu des modifications qu'on a faites, les gens qui souffrent d'une maladie incurable et dont la mort est imminente peuvent-ils leur recevoir l'aide médicale à mourir, même s'ils n'ont plus la capacité d'y consentir, alors qu'ils l'avaient au moment de la demande? Par la suite, on la leur administrerait quand même; par contre, si la personne manifestait des signes de résistance, on ne pourrait pas la lui administrer. Est-ce ce que vous recommanderiez qu'on applique en matière de demande anticipée? Dès que le patient manifesterait de la résistance, on n'administrerait pas l'aide médicale à mourir.
Ma deuxième question s'adresse au Dr Lussier.
En ce qui a trait aux mesures de protection, certains témoins nous ont dit que, si une personne présente une demande d'aide médicale à mourir à un moment donné de sa vie, il faut revoir ou réévaluer cette demande après un certain temps.
Quelle est votre opinion à cet égard, et à quelle fréquence faudrait-il réévaluer la demande, selon vous?
:
Je vous remercie beaucoup de cette réponse. J'apprécie votre concision.
Docteur Lussier, notre collègue, M. Arseneault, a parlé brièvement des soins inadéquats offerts pour certains diagnostics. Je pense que nous avons tous eu vent de l'affaire de l'ancien combattant qui s'est vu offrir l'AMM dans ce qui semble être un cas où ce serait tout à fait inapproprié, sans accès à du soutien en matière de santé mentale. C'est certainement une situation à considérer.
Vous avez longuement parlé de la difficulté de juger si les personnes atteintes de démence ou d'autres troubles neurocognitifs sont aptes. Procédera‑t‑on chaque fois au cas par cas ou incombera‑il à tous les médecins d'aider les patients à prendre cette décision? Cela devient très difficile.
Je vais revenir encore à la question suivante. Vous avez brièvement traité des mesures de protection. Quelles mesures doivent être en place pour les demandes anticipées, selon vous?
:
En ce qui concerne le nombre de cas, en fait, je l'ignore. À une demande que j'ai déposée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, on m'a dit au bout d'un an que l'information est trop confidentielle pour être communiquée. Les mécanismes de reddition de comptes et de surveillance sont si déficients qu'il est impossible d'obtenir des données fiables à ce sujet. C'est dire à quel point l'affaire est grave.
Le Bureau de l'enquêteur correctionnel a fait état de trois cas d'aide médicale à mourir il y a deux ans environ, mais nous ignorons combien de personnes l'ont demandée.
Essentiellement, selon la procédure, la personne doit présenter sa demande et être évaluée par le médecin de l'établissement. Le médecin n'est donc pas un évaluateur indépendant, mais plutôt quelqu'un qui travaille dans le système carcéral. Si le médecin de l'établissement juge que la personne est admissible à l'aide médicale à mourir, celle‑ci est alors évaluée par un second évaluateur indépendant issu de la collectivité. Si le médecin de l'établissement juge que la personne n'est pas admissible à l'aide médicale à mourir, l'évaluation s'arrête là, ce qui, à ma connaissance, est très différent de ce qui se passe dans la collectivité.
Voilà donc brièvement en quoi consiste le processus. Si la personne reçoit l'aide médicale à mourir, le processus s'arrête là. Normalement, Service correctionnel Canada a l'obligation de passer en revue tous les décès survenus en milieu carcéral, qu'ils soient de cause naturelle ou non, et, évidemment, leurs causes. Toutefois, la loi le dispense d'un tel examen dans les cas d'aide médicale à mourir, ce qui, à l'évidence, cause un problème important sur le plan de la surveillance et des balises du processus d'évaluation, des autres mesures disponibles et des autres possibilités offertes. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, cela pose de grands problèmes, comme je l'ai indiqué, même sans parler de l'absence de mécanismes de mise en liberté.
:
On hésite toujours un peu à parler de démence heureuse. Ce qu'on appelle la démence heureuse, ce sont les gens qui sont heureux dans le quotidien et qui ne démontrent pas de souffrances objectivables. Ils ne reconnaissent pas nécessairement leurs proches ou n'ont aucune idée du jour ou de la date. Or ils sont heureux dans le moment présent. Par exemple, ils sont heureux de manger et de participer à de petites activités; ils semblent tout à fait satisfaits et heureux.
Devrions-nous considérer que ces gens souffrent suffisamment pour entamer une demande anticipée? C'est une grande question.
Des gens disent qu'ils sont heureux maintenant. Cependant, si, avant d'être malades, ils s'étaient vus dans cette condition, ils auraient peut-être décidé qu'ils ne voulaient pas vivre cette situation. Certains croient que, si tout ce qu'ils aiment, c'est manger et participer aux petites activités du centre de soins de longue durée, ce n'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est une souffrance existentielle pour eux et ils préfèrent recevoir l'aide médicale à mourir. Or il est aussi possible que les gens s'adaptent et deviennent heureux.
Tout à l'heure, on a parlé de refus. C'est d'autant plus difficile d'administrer l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui semble heureux et qui ne se souvient pas du tout l'avoir demandée plusieurs années auparavant. C'est cela, la difficulté que pose la démence heureuse.
:
Merci, madame la présidente.
[Traduction]
Chers collègues, voilà qui met fin à notre séance.
J'aimerais remercier sincèrement les témoins qui ont comparu aujourd'hui.
Madame Iftene, je vous remercie de nous avoir quelque peu éclairés sur la question de l'aide médicale à mourir au sein des services correctionnels.
[Français]
Docteur Lussier et docteur Pageau, je vous remercie de votre présentation et de vos réponses à nos questions sur ce sujet extrêmement complexe que sont les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Je vous remercie de nous avoir consacré de votre temps ce soir.
Nous allons faire une pause de quelques minutes afin de nous préparer à recevoir le prochain groupe de témoins.
:
Nous allons interroger le deuxième groupe de témoins. Je note que nous avons sept minutes de retard, donc nous irons jusqu'à 8 h 37 pour disposer d'une heure entière.
Avant que nous commencions, j'aimerais formuler quelques observations d'ordre administratif.
Je demanderais aux témoins d'attendre que la coprésidente ou moi‑même les ayons désignés nommément avant d'intervenir. Je vous rappelle également que toutes les observations doivent être adressées à la présidence.
Lorsque vous parlez, veuillez vous exprimer lentement et clairement. Des services d'interprétation sont offerts et il n'est pas aisé d'interpréter, en particulier lorsque quelqu'un parle trop rapidement. Durant cette vidéoconférence, l'interprétation fonctionnera de la même façon que lors d'une réunion en présentiel. Au bas de votre écran, vous pouvez choisir entre le parquet, l'anglais et le français. Lorsque vous ne parlez pas, veuillez mettre votre microphone en sourdine.
Cela étant dit, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre deuxième groupe de témoins, qui sont ici pour parler des demandes anticipées.
Ce soir, nous avons avec nous le Dr Blair Bigham, médecin en médecine d'urgence et soins intensifs à l'Université McMaster, par vidéoconférence. Nous avons Mme Dorothy Pringle, professeure émérite à la faculté des sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg de l'Université de Toronto, également par vidéoconférence. Nous espérons que notre troisième témoin, Sandra Demontigny, se joindra à nous dans les prochaines minutes.
Commençons. Merci de vous être joints à nous. La procédure consiste à donner cinq minutes à chacun des témoins pour qu'il fasse sa déclaration préliminaire, et que nous passions ensuite aux questions.
Docteur Bigham, si vous êtes prêt, veuillez commencer. Vous avez cinq minutes.
C'est un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui en ma qualité d'urgentiste et de médecin d'unité de soins intensifs, de scientifique et d'auteur d'un ouvrage sur la manière dont les changements technologiques et sociétaux ont modifié notre rapport à la mort.
Je vous prie de m'excuser de prendre part à cette séance tout en étant de garde dans une unité de soins intensifs au nord d'Ottawa. J'ai été invité à comparaître devant votre comité après m'être engagé à m'occuper des patients ce soir durant la crise des ressources humaines en santé que connaît l'Ontario. Si je dois m'absenter pour répondre à une urgence médicale, j'espère que mon absence sera brève.
Au cours de mes 17 ans de carrière en tant qu'ambulancier et médecin, j'ai vu bien des gens mourir. Mais les gens que je vois mourir ne sont pas habituellement ceux auxquels on pense dans le cas des soins palliatifs et de l'aide médicale à mourir. Les patients des urgences et des unités de soins intensifs meurent parfois lententement d'une maladie chronique, par exemple d'un cancer ou d'une insuffisance cardiaque congestive. D'autres meurent de manière plutôt subite et inattendue à la suite d'un accident de voiture, d'une infection grave ou d'une rupture d'anévrisme.
Bon nombre de mes patients espèrent se rétablir complètement et vivre longtemps. À cette fin, des équipes formées de médecins, d'infirmiers, d'inhalothérapeutes d'autres professionnels de la santé mettent tout en œuvre, en s'aidant de médicaments et d'appareils, de scalpels et de la science, pour éviter une mort et tirer les gens d'affaire. Toutefois, au moment d'amorcer une réanimation, l'issue est plus qu'incertaine. Parfois, les médicaments et les appareils ne suffisent pas à sauver une vie. Parfois, je ne peux pas remettre un patient sur pieds.
Un dilemme moderne est apparu avec les progrès de la médecine, qui a engendré une crise du mourir. Pour certains patients, il devient manifeste après un moment que les appareils qui les maintiennent en vie ne parviendront pas à les aider à se rétablir, mais plutôt qu'ils les empêchent de mourir. Retenus à des machines qui ont échoué à leur redonner la santé, ces patients subsistent dans un espace linéaire entre la vie et la mort. Beaucoup d'entre nous ne voudraient pas exister ainsi.
Dans les hôpitaux, les équipes tiennent déjà compte des valeurs individuelles et des dernières volontés pour restreindre les interventions médicales, fixer les objectifs de soins et atténuer la douleur et la souffrance. Le problème, c'est que le recours bien intentionné de la technologie dans le but de sauver une vie se solde souvent par un échec et empêche les patients de franchir le fil d'arrivée pour mourir dans la paix et la dignité.
Certains pourraient faire valoir que l'aide médicale à mourir et la pratique qui consiste à soustraire un patient à la technologie de maintien en vie présentent des similitudes pragmatiques. Dans certains cas, le retrait de la technologie entraîne une mort quasi immédiate, et le confort du patient est maintenu grâce à divers médicaments. Dans d'autres cas, toutefois, le retrait de la technologie laisse le patient dans un état de flottement persistant qui est avilissant et parfois pénible. Même une fois la technologie écartée, la mort, bien que certaine, peut être lente à venir.
À mon avis, les Canadiens méritent d'avoir leur mot à dire sur leur propre fin, parce que maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie peut empêcher, et empêche, la nature de suivre son cours. L'aide médicale à mourir pourrait probablement jouer un rôle plus important dans les établissements de soins actifs, où l'état de conscience et la capacité de donner son consentement sont souvent compromis.
En marge de la question de l'aide médicale à mourir, il y a celle, plus générale, de savoir comment nous pouvons mieux informer les Canadiens des choix qui s'offrent à eux en cas de maladie grave irrémédiable et encourager les discussions avec les proches sur les valeurs de fin de vie avant que la tragédie ne frappe. Le défi auquel votre comité doit réfléchir en est un que tous les Canadiens doivent envisager. Le prononcé d'un pronostic est souvent incertain et toujours complexe. Il est très difficile de savoir à quel moment la probabilité d'une guérison réussie est inférieure aux capacités de l'équipe médicale et aux souhaits du patient.
J'espère aujourd'hui pouvoir contribuer à vos délibérations sur la façon dont les directives anticipées concernant l'aide médicale à mourir peuvent contribuer à résoudre ce dilemme des temps modernes sur la mort, afin qu'aucun Canadien ne meure trop tôt ou trop tard.
Je vous remercie.
Je suis une infirmière diplômée à la retraite, avec une expérience en soins infirmiers psychiatriques et gérontologiques. J'ai exercé et enseigné aux étudiants en soins infirmiers dans des établissements de soins actifs et de soins de longue durée.
J'ai eu le plaisir et l'occasion de faire partie des groupes d'experts sur l'aide médicale à mourir et sur les demandes anticipées d'aide médicale à mourir du Conseil des académies canadiennes.
Je suis très favorable à l'aide médicale à mourir et aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Selon moi, les patients atteints de maladies terminales dévastatrices qui ne nuisent pas à leur cognition — par exemple, la plupart des types de cancer, les maladies cardiaques et la sclérose latérale amyotrophique — tirent un sentiment de contrôle et de réconfort à déterminer à quel moment et dans quelles conditions ils seront soulagés de la douleur et de la souffrance.
Les maladies qui entraînent une démence et une perte de cognition sont plus difficiles à gérer, car elles exigent qu'une personne autre que le patient prenne la responsabilité d'entreprendre l'aide médicale à mourir en fonction des conditions précisées par le patient. L'expérience des Pays‑Bas indique que l'aide médicale à mourir une fois qu'un patient n'est plus compétent est peu courante, mais difficile. La plupart des patients atteints de démence recourent à l'aide médicale à mourir tandis qu'ils sont encore compétents.
Des pratiques visant à améliorer l'efficacité des demandes anticipées ont été identifiées, mais nous ne savons pas vraiment dans quelle mesure elles sont efficaces. Je pense que la gestion des demandes anticipées des patients atteints de troubles cognitifs est une question cruciale. Nous ne sommes pas sans avantages à cet égard. Nous avons les leçons tirées aux Pays‑Bas, qui ont une excellente vue d'ensemble et de très bonnes données, et nous avons l'expérience de l'aide médicale à mourir au Canada dont nous pouvons nous inspirer.
Je vous remercie.
:
Merci, monsieur le président.
Contrairement à mon habitude d'avant ma maladie, je vais lire le texte que j'ai écrit, parce que, sinon, je n'y arriverai pas.
C'est avec le sentiment d'urgence au corps et au cœur que je transmets ce mémoire au Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir de la Chambre des communes du Canada.
En guise de présentation, je vous lirai un extrait du rapport du Groupe d'experts sur la question de l'inaptitude et l'aide médicale à mourir fait pour le compte du gouvernement du Québec.
Sandra Demontigny est âgée de seulement 39 ans lorsqu'elle reçoit le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Son père a été emporté par cette maladie à l'âge de 53 ans, après avoir souffert [de symptômes affectant grandement sa dignité]. Madame Demontigny souffre de la forme héréditaire, plus rare, de cette grave maladie.
Cette jeune femme a une famille, un conjoint et trois enfants. Son cadet est âgé de [16] ans, et son aîné a [24] ans. Ses enfants risquent à 50 % d'être, eux aussi, atteints de cette forme héréditaire de la maladie d'Alzheimer.
[...] préoccupée par le sort des personnes qui, comme elle, sont affectées d'un trouble neurocognitif, ainsi que par le vécu des proches qui les soutiennent dans leur quotidien, [Sandra] Demontigny participe à des projets de recherche sur la maladie et prend la parole publiquement, afin de la démystifier. Elle accorde des entrevues pour sensibiliser les élus et le grand public à la question de l'élargissement de l'AMM aux personnes qui sont affectées d'une maladie qui entraînera leur inaptitude à y consentir.
Nous voilà quelques années plus tard. Je suis maintenant âgée de 43 ans, et je dépose ce mémoire à la Chambre des communes. Ma motivation est de partager mon expérience de vie avec la maladie d'Alzheimer précoce génétique, tant comme proche aidante que comme personne atteinte. Je vous donnerai également ma vision des années à venir, au cours desquelles, progressivement mais sûrement, s'accentueront mes deuils et mes peurs. Je sais pertinemment à quoi m'attendre: je l'ai vu de près et pendant des années auprès de mon père.
Depuis l'annonce de mon diagnostic, en 2018, c'est sur ceci que je concentre mes énergies: préparer ma sortie afin de la rendre la plus douce possible. Il vaut mieux chercher à y voir du positif. Je travaille à apaiser mon cerveau qui se perd et mon cœur qui se serre. J'éprouve le besoin de me rassurer au sujet de mon avenir pour mieux vivre mon quotidien et ses épreuves de plus en plus présentes.
J'aspire à profiter de mes dernières années de belle vie, l'esprit libre et sans peur. Avec ma mère et mon frère, j'ai accompagné mon père, Denys, jusqu'à la fin de sa maladie. Il est décédé à l'âge de 53 ans. Il était porteur du même défaut génétique que sa mère, que la mère de sa mère, et ainsi de suite.
Il y a un risque de transmission génétique de 50 %; c'est pile ou face. En présence de cette mutation génétique, la maladie se développera dans 100 % des cas. Cette forme génétique se développe précocement, dans la trentaine ou la quarantaine, selon le gène responsable. Cette personne est la mère ou le père d'enfants relativement jeunes, qui deviendront, à leur mesure, des proches aidants. Mes trois enfants le sont au quotidien. Il est important de préciser qu'ils ont chacun au moins 50 % de risque d'avoir la même maladie que leur parent atteint. C'est un spectre qui pèse très lourd sur des adolescents ou des jeunes adultes.
Je suis catégorique. Depuis que j'ai accompagné mon père dans sa descente aux enfers aux mains de la maladie d'Alzheimer, je sais que je ne veux pas vivre ce que mon père a vécu. C'est hors de question. Je ne veux pas terminer ma vie complètement dépossédée de ma dignité. Je ne veux pas errer de jour et de nuit, à quatre pattes, parce que trop épuisée, en pleurant souvent, le regard fuyant ou perdu, tout en grommelant quelques mots difficiles à déchiffrer, en devenant agressive avec mes enfants, que je ne reconnaîtrai plus. Moi, j'oublie de plus en plus, mais les images de mon père m'habitent encore, 15 ans plus tard. Je suis convaincue qu'elles se tairont lorsque j'aurai su les calmer en leur disant qu'elles n'auront pas à renaître encore une fois.
Notre politique canadienne est progressiste et humaniste. Les citoyens canadiens demandent que soient légalisées les demandes médicales à mourir anticipées, les DMA, notamment à la suite d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer, afin de vivre les années restantes avec plus de quiétude de cœur et d'esprit, de savourer pleinement et sereinement chacune de leurs journées, sachant que, lorsque le moment qu'ils auront déterminé dans leur DMA sera venu, ils pourront compter sur leur mandataire pour faire valoir leur droit de mourir dans la dignité.
Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre intérêt porté à ma présentation ainsi qu'à mon mémoire. Ce fut un honneur d'avoir pu partager mon vécu avec vous et vous faire part de mon opinion concernant l'aide médicale à mourir anticipée.
:
Merci beaucoup, sénatrice.
Merci aux témoins d'être ici pour discuter de ce sujet très important pour tous les Canadiens.
C'était un discours très passionné, madame Demontigny. Le sujet est difficile et il y a des questions difficiles. Cependant, je pense qu'elles sont importantes. Encore une fois, c'est très personnel. Si vous êtes mal à l'aise, je le comprends.
Comment déterminer le moment où sa souffrance est devenue trop intense? Comment arriver à cette décision, en supposant que l'on ait encore la capacité de la prendre?
Y avez-vous réfléchi et en avez-vous discuté avec votre prestataire de soins de santé?
:
En effet, c'est une question que je me pose encore: quel moment devrais-je choisir?
Je penche de plus en plus vers le moment où j'aurai de la difficulté à reconnaître un de mes proches, notamment un de mes enfants. Je sais que cela arrivera, et, pour moi, c'est la goutte de trop. Il faut trancher quelque part, mais ce n'est pas facile.
C'est mon opinion pour le moment, mais, pour être honnête, je dois dire que ma décision n'est pas arrêtée.
:
Merci beaucoup pour cela. Je vous en suis reconnaissant.
Bien sûr, la difficulté réside alors dans le fait que, parfois, avec la démence, la capacité à reconnaître les gens fluctue. Avez‑vous également réfléchi à cela? On peut avoir de bons jours et de mauvais jours. Est‑ce une combinaison de ces éléments?
Une fois de plus, je m'excuse de poser ces questions, mais je pense qu'il est important que nous comprenions la question du point de vue de quelqu'un comme vous. Merci, encore une fois, d'être ici.
:
C'est très gentil. Ne vous gênez pas. Ce sont de très bonnes questions.
Vous avez raison de dire que les journées varient lorsqu'on est atteint de la maladie d'Alzheimer.
Je veux me raccrocher à mes valeurs de base et à ce que je ne veux pas vivre. Je ne veux pas perdre ma dignité et devoir dépendre de tout le monde pour mes besoins de base, c'est-à-dire pour me faire manger, pour changer ma couche et pour m'emmener me coucher parce que je ne fais plus toujours la différence entre le jour, le soir et la nuit. Ce sont certains repères.
C'est évidemment au risque de partir un peu trop tôt, mais, bien que j'adore ma vie, j'aime mieux partir un peu trop tôt qu'un peu trop tard, quand je ne pourrai plus prendre une décision et que je ne pourrai plus donner mon consentement.
:
C'est une très bonne question.
Du haut de mes 43 ans, je suis grand-mère depuis un an déjà. La vie a bien fait les choses. Je suis gâtée, j'ai déjà un premier petit-fils et je suis contente qu'il soit là.
Je suis devant une situation difficile, car je dois déterminer jusqu'à quand je veux vivre de bons moments, alors que je sais que je risque de vivre des moments vraiment difficiles. Un jour ou l'autre, à mon avis, ces moments seront dénudés de dignité. Malheureusement, je ne courrai pas ce risque.
J'aurai effectivement à faire des choix difficiles, mais je ne veux pas risquer d'être prise dans mon corps pendant des années. Je ne veux pas errer ou être agressive. Je refuse tellement cela que, malheureusement, je partirai probablement un peu plus tôt que je ne l'aurais voulu idéalement.
:
Merci, madame la présidente.
Je remercie les témoins.
Madame Demontigny. C'est tellement important pour nous de vous entendre aujourd'hui, car vous apportez une autre perspective sur les demandes anticipées. Je vous en remercie grandement. Nous avons entendu d'autres témoins qui ont fait une telle demande, mais vous avez encore cette jeunesse en vous, ce qui est cruel, comme vous nous l'exposez, parce qu'un jour, vous devrez choisir de partir plus tôt que trop tard.
Nous avons entendu quelques témoins dire que ceux qui s'opposaient aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir faisaient preuve d'âgisme. Qu'en pensez-vous?
Pensez-vous qu'on vous surprotégerait en disant que vous êtes trop jeune pour être consciente de ce que vous demandez et que vous ne savez pas tout à fait ce que vous voulez? Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet?
:
Je vous remercie de cette question. C'est intéressant.
En fait, l'intérêt des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, c'est justement le fait qu'on est encore capable de réfléchir et de prendre des décisions. En ce moment, bien que j'aie la maladie d'Alzheimer à un stade modéré, j'arrive tout de même à vous parler de façon assez fluide.
Je préfère pouvoir déterminer à quel moment j'aurai atteint ma limite, ou celui où je penserai l'avoir atteinte, au risque de me tromper, plutôt que de laisser le temps passer et d'atteindre un stade où je ne pourrai plus m'exprimer clairement.
Ce que je vais dire est peut-être bête, mais je sais que la fin de mon parcours avec la maladie d'Alzheimer peut être très difficile, tant physiquement que moralement. Or je n'ai pas envie de remettre ma destinée entre les mains de quelqu'un qui me laisserait être malade comme cela longtemps.
Mon père a vécu la fin de sa maladie assez promptement. Les années difficiles n'ont pas duré très longtemps. Par contre, ma grand-mère, c'est-à-dire sa mère, a été dans un état neurovégétatif pendant sept ans.
:
Je pense que son témoignage est à peu près tout ce que nous devons savoir sur l'importance des demandes anticipées. Je pense qu'elle présente le plus grand dilemme de l'ensemble des demandes anticipées, à savoir les demandes que présentent des personnes atteintes de démence, qui sont en faveur de l'AMM.
Là encore, s'ils choisissent de tirer parti de l'AMM, pendant qu'ils sont encore aptes, je ne pense pas qu'il y ait un problème. C'est ce qui a été vécu aux Pays-Bas, un pays qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. En fait, très peu de patients atteints de troubles cognitifs vivent jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en mesure de prendre des décisions et qu'ils soient forcés de s'en remettre à d'autres personnes. La plupart des personnes atteintes de troubles cognitifs prennent cette décision avant de ne plus être aptes à le faire.
Je pense que nous devons réfléchir à la question de savoir si, dans la loi, nous continuerons ou non d'autoriser les demandes anticipées lorsque la personne est atteinte de troubles cognitifs.
:
Je vous remercie, madame la présidente.
Madame Demontigny, vous avez terminé votre témoignage en disant que c'était un honneur pour vous de rencontrer les députés et les sénateurs. J'aimerais vous dire que cet honneur est réciproque. En fait, ce n'est pas la première fois que je vous entends, mais c'est la première fois que je suis aussi touché et bouleversé. Peut-être est-ce causé par la proximité.
Vous avez dit des choses très fortes, entre autres: « mon cerveau qui se perd et mon cœur qui se serre », et que vous ne vouliez pas être prisonnière de votre corps.
J'essaie de déterminer quelles seraient les meilleures conditions pour qu'une personne atteinte d'une maladie neurocognitive dégénérative majeure puisse, en toute confiance, vivre le plus longtemps possible, sachant que sa volonté sera respectée, même quand elle n'aura plus la capacité de faire valoir son point de vue, parce qu'on aura mis en place tout ce qu'il faut pour qu'une tierce personne puisse, avec l'équipe soignante, déclencher le processus, même si l'équipe soignante, à ce moment-là, dit qu'elle pense que ce n'est pas encore le temps et qu'à son avis, rien ne presse.
Ce qui me bouleverse, ce soir, c'est que vous nous dites que vous n'attendrez pas d'être inapte à faire ce choix, que vous allez plutôt écourter votre vie. En tant que législateur, j'aimerais être assez compétent pour vous éviter de faire cela.
Qu'est-ce qui fait que, actuellement, vous croyez que vous devrez le faire avant d'être inapte à faire des choix?
:
C'est sûr que cela me permettrait d'aller plus loin dans la maladie. En ce moment, par exemple, il n'y a pas de demande anticipée d'AMM. Alors, il est certain qu'il y aura un moment où je ne voudrai même pas prendre le risque que cela aille trop loin et que je passe tout droit, au-delà de mon aptitude à faire des choix éclairés. Par contre, avec une demande anticipée, j'aurai clairement établi ce qui est acceptable ou pas pour moi. D'ailleurs, j'en parle déjà avec mes proches, mes enfants, et tout le monde est d'accord.
En fait, idéalement, j'aimerais vivre relativement longtemps, quand même. Je veux vivre une partie de ma maladie. Je ne veux pas partir au début de la maladie, et j'accepte d'être perdue et d'avoir besoin d'assistance.
Toutefois, je ne veux pas vivre la dernière phase de la maladie, alors que les gens sont complètement dépendants, incapables de s'exprimer ou à peu près. Je l'ai vu et je ne veux pas le vivre. C'est ce que je voudrais préciser dans une demande anticipée. Bien sûr, cela me donnerait plus de temps.
Par exemple, sans vouloir vous mettre de la pression, si les demandes anticipées ne sont pas acceptées par le Parlement, malheureusement, je devrai choisir seule de partir avant d'entrer dans cette phase, sinon j'y serai coincée.
:
J'ai bien entendu cela et c'est pour cette raison que je suis aussi touché.
Je pense que nous pouvons y arriver parce qu'il me semble qu'en matière de décisions aussi intimes que celle de décider, selon un libre choix, de sa propre mort, je ne vois pas en quoi l'État doit se mêler de cela, surtout pas dans les conditions que vous avez vécues. Vous êtes très consciente de ce qui vous attend, vos enfants et vous. En fait, votre témoignage parle d'un processus familial.
Il y a des gens qui voient le mal partout, qui voient des gens qui pourraient profiter de la situation. Finalement, j'oserais dénoncer un processus paranoïaque d'avocasseries entourant une décision tout à fait sereine consistant, pour une personne, à affirmer qu'elle est un être humain, qu'elle a le droit de décider, en toute liberté de conscience, du moment où elle quittera ce monde, et qu'elle aimerait que quelqu'un l'aide à le faire.
Moi, je suis prêt à vous aider.
:
Merci beaucoup, madame la présidente.
Je remercie également tous nos témoins.
Merci, madame Demontigny.
Dans toutes les conversations que nous avons eues au sein du Comité, lorsque nous avons parlé de démence, la plupart des témoignages provenaient de professeurs et de membres de la profession médicale qui pouvaient parler de la maladie en général et de cas particuliers d'une manière légèrement abstraite. Je pense que votre témoignage est très puissant, car vous prenez la parole en tant que personne atteinte de démence. Vous savez ce qui vous attend, et vous plaidez pour pouvoir décider de votre propre vie de façon autonome. Je pense qu'il s'agit d'une déclaration très puissante.
J'aimerais vous poser une question au sujet de la stigmatisation qui est associée à la démence. Nous avons entendu plusieurs témoins dire que, lorsque les gens reçoivent un diagnostic de démence, ils ne connaissent peut-être pas parfaitement la maladie, mais habituellement, ils savent qu'il s'agit d'une maladie qui a une évolution très négative, ce qui peut influencer leurs décisions.
En revanche, vous avez une connaissance très approfondie de la maladie en raison de votre histoire familiale. Au cours de votre déclaration préliminaire, vous avez déclaré que vous vouliez éviter la descente aux enfers qu'a connue votre père. Vous comprenez donc très bien cette maladie.
Pouvez-vous nous parler de votre expérience personnelle de la stigmatisation associée à la maladie, en tant que personne qui la connaît parfaitement? Je pense que vous avez une bonne idée de la situation.
Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes et je sens que c'est un peu mêlé dans ma tête.
Vous avez raison, je connais la maladie de l'intérieur.
Honnêtement, je ne souhaite à personne d'accompagner en fin de vie une jeune personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Souvent, les personnes âgées décèdent avant d'arriver à la fin de cette maladie, celle dont les symptômes sont épouvantables. Les personnes plus jeunes ne meurent pas, car elles sont en forme. Mon père était un grand sportif, alors il ne mourait pas.
Si quelqu'un était témoin d'une telle fin de vie et qu'il recevait un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, j'ai de la difficulté à croire qu'il voudrait continuer à vivre jusqu'à la fin. C'est clair que ce n'est pas mon cas.
Mon père a reçu de bons soins. Il a été bien accompagné. Malgré tout cela, la souffrance se lisait sur son visage et dans ses yeux. Il avait le visage crispé. Il pleurait en me regardant, mais il n'arrivait plus à parler. Il se promenait à quatre pattes par terre. Il léchait le plancher. Selon moi, la majorité des êtres humains ne voudraient pas vivre cela. Moi, je ne veux pas le vivre. Sachant ce que c'est, justement, je veux l'éviter.
Cela dit, d'autres personnes ont une autre vision différente de la fin de vie et c'est bien. L'idéal, c'est que chacun puisse suivre la voie qui lui convient, en fonction de ce que la vie lui apporte.
La vie m'a envoyé un gros cadeau empoisonné. J'ai décidé de prendre les devants, de travailler afin d'avoir une fin de vie digne malgré la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas vraiment possible, en ce moment.
:
C'est très intéressant.
Je ne vous cacherai pas que c'est quand même un domaine que je connais bien. J'ai travaillé dans le domaine de la santé et j'ai accompagné mon père au cours de sa maladie. Je connais donc bien le sujet. Ce n'est pas nécessairement le cas de la plupart des gens et cela peut être complexe.
Dans le réseau de la santé, certaines personnes, comme les travailleuses sociales, ont notamment pour mandat d'accompagner les malades pour ce qui est des démarches à suivre. Elles les aident aussi à remplir les formulaires compliqués. Il y a aussi les psychologues, qui peuvent aider les malades à se faire une idée, au besoin. Ce sont des gens très aidants.
J'ai accès à une psychologue et à une travailleuse sociale. Je parle librement avec elles de ma démarche concernant la maladie d'Alzheimer. Cela me fait du bien. Au besoin, si je ne trouve pas de réponse à mes questions, elles vont s'informer pour moi et me transmettre les réponses. Il est important que les gens puissent avoir accès à de tels services. On sait qu'ils sont difficiles à obtenir dans le réseau de la santé. Toutefois, pour faire un choix éclairé après avoir bien examiné tout l'éventail des possibilités, il faut, à mon avis, avoir accès à des professionnels qualifiés.
:
Merci, monsieur le président.
Je remercie le Dr Bigham, ainsi que Mmes Pringle et Demontigny, d'être avec nous ce soir. Vos témoignages sont extrêmement importants.
Ma question s'adresse à vous, madame Demontigny. C'est une question difficile que je vais vous poser. Certains nous ont dit que, quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer, le soi est changeant et qu'on atteint un stade de démence heureuse. Vous, par exemple, l'avez-vous vécu? Est-ce que vous l'acceptez? Vous dites-vous que la démence heureuse est un stade qui doit être franchi, par exemple, avant de recevoir l'aide médicale à mourir? Pensez-vous que le dernier stade survient lorsque le malade souffre de pneumonie d'aspiration, de double incontinence, et ainsi de suite?
:
C'est une excellente question, monsieur, et je suis contente que vous me la posiez.
En effet, il y a souvent d'autres professionnels qui parlent de la démence heureuse. Pour être bien honnête, je n'y crois pas. La démence heureuse, ce sont les symptômes d'une maladie qui s'expriment. Ce n'est pas la personne qui est contente, mais les plaques dans son cerveau qui dérèglent ses neurotransmetteurs et lui font manifester des expressions de joie. Personne ne nous dit qu'elle ressent cette joie, même si c'est ce qu'elle manifeste. Honnêtement, je trouve cela triste d'entendre dire, et je l'ai entendu souvent de la part de certains professionnels de la santé qui exercent l'aide médicale à mourir, que lorsque les gens font de la démence heureuse, ils sont contents. Nous ne le savons pas.
Aujourd'hui, je peux nommer les comportements qui me feront sentir que je perds ma dignité. C'est le cas, par exemple, si je ne reconnais plus mes enfants, si je n'arrive plus à aller à la toilette seule ou si je ne peux pas manger par moi-même. Ce sont des comportements que j'ai déjà nommés et qui sont facilement observables.
Certaines personnes n'aimeront pas ce que je vais dire, mais, à mon avis, la démence heureuse est un concept qui plaît à certains soignants. Ils aiment croire que les malades sont heureux. Or nous ne savons pas s'ils le sont et ne pouvons pas présumer qu'ils le sont, d'où l'intérêt des demandes anticipées.
:
La réponse à toutes ces questions est oui.
Dans mon cas, ce sera lorsque mon autonomie pour mes besoins de base sera grandement altérée. Ce sera lorsque je ne serai plus capable de manger ou d'aller à la toilette seule, ou que je ne pourrai pas me laver par moi-même. Pour moi, c'est cela, l'autonomie. J'ai peut-être trop de fierté, mais je ne veux pas partager cela, surtout que je sais que j'ai une maladie dégénérative qui ne va nulle part.
Si j'avais une maladie qui faisait en sorte que je doive supporter qu'on me donne des soins intimes de façon temporaire, je pense que je pourrais l'accepter, sachant que je recouvrerais la santé à un moment donné. Dans mon cas, je sais que les choses iront en empirant, et je ne vois aucun intérêt à accepter cela. Mes enfants sont tous d'accord...
:
À l'heure actuelle, d'après ce que Mme Demontigny nous a dit, elle ne serait pas en mesure d'obtenir l'AMM.
Je pense que le seul problème dont nous n'avons pas parlé, c'est que, lorsque vous êtes atteint de troubles cognitifs et que vous avez dressé cette liste d'indications du moment où vous voulez recevoir l'aide médicale à mourir, quelqu'un d'autre doit la mettre en oeuvre. Il faut que ce soit un membre de la famille, mais si un membre de la famille n'est pas disponible, alors la demande sera probablement adressée à l'équipe médicale. Les difficultés qui ont été observées sont survenues lorsque la personne qui mettait en oeuvre l'AMM ne connaissait pas bien le patient. La situation devient problématique si le patient résiste parce qu'il est atteint de troubles cognitifs et ne comprend pas ce qui se passe.
Je pense que dans le cas de Mme Demontigny, il s'agit d'une horrible situation et d'un parfait scénario en même temps, en ce sens que sa famille est d'accord et qu'elle serait prête à suivre ses directives. Lorsque cela se produit, je crois que c'est le but des demandes anticipées.
:
Merci, monsieur le président.
Ma question s'adresse au Dr Bigham.
Je sais que vous travaillez beaucoup dans les services de soins intensifs. Ce n'est pas là que vous trouverez un grand nombre de personnes démentes qui font des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Cependant, parmi vos patients en soins intensifs, il y en a beaucoup pour qui vous allez retirer les appareils technologiques. Il y en a qui vont mourir, mais il y en a d'autres dont la vie va être prolongée.
Selon votre expérience, parmi ceux-ci, y en a-t-il qui vous disent qu'ils auraient bien aimé mourir aussitôt la canule de trachéotomie enlevée, ou qui vous demandent s'ils auront la possibilité, un jour, de demander l'aide médicale à mourir?
Avez-vous eu cette discussion avec un patient à qui vous avez retiré les appareils technologiques?
:
Tout d'abord, il est très peu probable qu'à ce stade de la maladie, la personne soit capable de communiquer avec moi, mais j'entends très souvent des membres de la famille me dire: « Pouvons-nous accélérer les choses? C'est une torture pour nous de voir tout cela s'éterniser ».
Dans de nombreux cas, lorsque nous retirons la technologie, les patients meurent assez rapidement. Dans d'autres cas, ils peuvent survivre pendant des heures, des jours et parfois même des semaines, mais leur fin est certaine. Cette situation peut être très pénible pour les familles et, parfois, inconfortable pour les patients.
Pour les patients qui ont besoin d'une technologie pour avoir une chance de vivre, mais pour qui cette technologie échoue par la suite, l'aide à mourir a certainement un rôle à jouer.
Madame Demontigny, avant de vous adresser ma question, je tiens à vous remercier infiniment de nous avoir livré votre témoignage et parlé de votre expérience personnelle.
Lors des conférences que vous faites un peu partout, vous rencontrez sûrement des familles qui ont eu à peu près le même vécu que vous. Quel genre de commentaires recevez-vous? Ces familles vous disent-elles qu'elles auraient aimé que leur mère, par exemple, demande l'aide médicale à mourir? Vous disent-elles, au contraire, qu'elles n'auraient pas aimé cela afin qu'elle puisse vivre plus longtemps après d'elles?
J'ai déjà entendu ce type de commentaires. Cependant, vous, qu'avez-vous entendu dans vos rencontres?
:
Je vous remercie de votre question.
Évidemment, en raison de mon approche concernant les soins en fin de vie, notamment ceux de la dernière phase de la maladie d'Alzheimer, et étant la porte-parole de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, les personnes que je rencontre sont souvent des gens qui se sont déjà livrés à cette réflexion, qui veulent justement partir dignement et qui souhaitent que leurs attentes soient respectées.
Je peux vous parler d'eux.
Justement, aujourd'hui, nous avons eu notre rencontre annuelle. Plusieurs personnes sont venues me voir; elles me touchaient le bras, elles avaient les yeux dans l'eau ou des larmes qui coulaient. Elles me remerciaient en disant que c'était ce que leur mère voulait, mais qu'elle n'y avait pas eu accès. D'autres me remerciaient en disant que cela les rassurait et les encourageait, parce qu'elles avaient reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer.
Bien sûr, les gens réfractaires à l'idée n'étaient pas là, parce que c'est une association de gens qui souhaitent la mort dans la dignité. J'ai reçu des commentaires positifs. Les gens voient cela comme un début de soulagement et ils souhaitent qu'il y ait une loi favorable à cet égard. Pour eux, c'est l'espoir de finir leur vie dignement, contrairement à ce que leurs proches ont vécu.
Cela conclut l'audience de notre groupe d'experts. J'aimerais remercier Dr Blair Bigham et Mme Dorothy Pringle de s'être joints à nous ce soir, d'avoir fait des déclarations préliminaires et de nous avoir fait part de leurs compétences à ce sujet.
[Français]
Madame Demontigny, nous vous offrons particulièrement nos sincères remerciements.
Comme beaucoup de mes collègues l'ont souligné, votre témoignage a été très puissant et très émouvant. J'ajouterais qu'il a aussi été d'une très grande éloquence. Vous avez de toute évidence beaucoup réfléchi aux questions que nous vous avons posées ce soir, et vos réponses nous seront extrêmement utiles dans nos délibérations.
[Traduction]
Je remercie encore une fois nos trois témoins.
Cela met fin à notre audience.
La séance est levée.