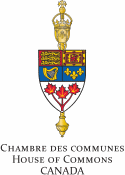:
Je déclare la séance ouverte.
Je vous souhaite la bienvenue à la 26e réunion du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir.
Je souhaite la bienvenue aux membres du Comité, aux témoins et aux gens du public qui suivent la réunion sur le Web.
[Traduction]
Je m'appelle Marc Garneau et je suis le coprésident de la Chambre des communes de ce comité.
Je suis accompagné de l'honorable Yonah Martin, coprésidente du Sénat.
Nous poursuivons aujourd'hui notre examen prévu par la loi des dispositions du Code criminel concernant l'aide médicale à mourir et leur application.
J'aimerais aborder quelques points d'ordre administratif. Je rappelle aux membres du Comité et aux témoins de garder leur microphone en sourdine jusqu'à ce qu'ils soient nommés par l'un des coprésidents.
Je vous rappelle aussi que tous les commentaires doivent être adressés aux coprésidents.
[Français]
Lorsque vous avez la parole, veuillez parler lentement et clairement, pour aider les interprètes à bien faire leur travail.
Les services d'interprétation sont offerts autant à ceux qui participent à la réunion par vidéoconférence qu'à ceux qui y participent en personne. À distance, les gens peuvent choisir, au bas de l'écran, entre le parquet, l'anglais et le français.
[Traduction]
Sur ce, je vous présente nos premiers témoins, qui sont ici pour discuter des personnes mineures matures.
Nous recevons, à titre personnel, la Dre Dawn Davies, qui est pédiatre et médecin en soins palliatifs. Nous recevons également à titre personnel Mme Cheryl Milne, qui est la directrice exécutive du David Asper Centre for Constitutional Rights; elle se joint à nous avec vidéoconférence. Enfin, nous recevons la directrice du Département de bioéthique de l'Hospital for Sick Children, Randi Zlotnik Shau.
Je vous remercie toutes les trois de vous joindre à nous ce soir.
Nous allons commencer par les déclarations préliminaires, puis nous passerons aux questions. Vous disposez de cinq minutes chacune pour votre déclaration préliminaire. La Dre Davies sera notre première intervenante.
Docteure Davies, si vous êtes prête, vous pouvez procéder. Vous disposez de cinq minutes.
:
Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invitée à témoigner devant vous.
En plus d'être la directrice du David Asper Centre, je pratique aussi le droit. J'ai passé de nombreuses années à représenter des jeunes à la clinique juridique Justice for Children and Youth, notamment à titre d'intervenante dans l'importante affaire de la Cour suprême du Canada A.C. c. Manitoba. J'ai donc de bonnes connaissances du fonctionnement de la loi en ce qui a trait à la prise de décisions médicales pour les enfants.
La Cour suprême du Canada a fait valoir que les jeunes personnes matures devraient pouvoir prendre ce genre de décisions, même si elles entraînent de graves conséquences, si elles ont la capacité de le faire.
Au pays, la loi relative à la façon dont les jeunes peuvent prendre ce genre de décisions varie d'une région à l'autre. Dans les lois de certaines provinces qui préconisent l'intérêt supérieur, par exemple, la norme devrait être interprétée de manière à respecter le choix d'une personne mineure indépendante et capable de prendre des décisions.
En plus d'émaner de la Cour suprême du Canada, cette décision se fondait sur l'article 7 de la Charte des droits et libertés.
Le tribunal a aussi fondé sa décision sur la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Les articles pertinents à cette fin sont principalement l'article 12, qui exige du Canada qu'il prenne dûment en considération le point de vue de l'enfant selon son âge et son degré de maturité, et l'article 5, qui exige du Canada qu'il respecte la responsabilité, le droit et le devoir qu'on les parents de donner l'orientation appropriée à l'exercice des droits de l'enfant d'une manière qui correspond au développement des capacités de l'enfant.
Il y a aussi d'autres articles qui ajoutent complexité et nuance à ces décisions. L'article 2 aborde la non-discrimination; l'article 6 porte sur la survie et le développement de l'enfant; l'article 24 vise l'accès aux soins et aux services de santé. Tous ces articles sont pertinents dans le cadre de l'étude sur l'aide médicale à mourir pour les personnes de moins de 18 ans.
En ce qui a trait aux mesures de protection, l'article 23 exige des États qu'ils reconnaissent que les enfants handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
L'une de mes principales recommandations — et je crois que d'autres témoins qui ont comparu avant moi l'ont dit également — dans ces circonstances consiste à écouter ce qu'ont à dire les enfants et les jeunes. Je sais que d'autres organisations ont recommandé ce qu'on appelle une évaluation des répercussions sur les droits de l'enfant, qui vise notamment la consultation avec les experts, ce que nous faisons ce soir et que vous avez fait jusqu'à maintenant, de même qu'une consultation avec les jeunes qui sont directement touchés.
Je n'irai pas plus loin. Mes notes d'allocution abordent les divers groupes vulnérables dont il faut tenir compte de manière particulière.
Je tenais aussi à dire qu'en plus de parler aux enfants et aux jeunes en tant que groupe, et de les consulter, il faut se rappeler de ne pas laisser traîner la question trop longtemps parce que, dans l'intervalle, des jeunes de moins de 18 ans qui souffrent se voient refuser ce traitement. Ainsi, leurs opinions et leurs préférences ne sont pour le moment pas prises en compte. Bien que je sois d'avis que la consultation auprès des enfants et des jeunes de façon plus générale est essentielle, il ne faut pas oublier les jeunes de façon individuelle.
Je vais en rester là. J'espère avoir l'occasion de répondre à vos questions détaillées plus tard.
:
Merci, monsieur le président. Je vous remercie de m'avoir invitée à témoigner devant le Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir.
En plus d'être la directrice du département de bioéthique de l'Hospital for Sick Children de Toronto, je travaille à titre de bioéthicienne pédiatrique depuis plus de 22 ans. Je suis aussi professeure agrégée au département de pédiatrie de l'Université de Toronto.
Tout comme les autres experts invités aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être membre du groupe de travail du Conseil des académies canadiennes sur l'aide médicale à mourir pour les mineurs matures. De plus, j'ai collaboré avec des collègues qui travaillent auprès des enfants et des familles à l'hôpital SickKids et ailleurs, aux prises avec des questions associées à l'aide médicale à mourir pour les personnes mineures matures.
La perspective de la bioéthique peut être utile dans le cadre de la prise d'une décision, alors que les valeurs au cœur de cette décision peuvent pousser le décideur à faire divers choix. Dans le cadre de questions aussi difficiles en matière de soins de santé, l'objectif est de tenir compte, de façon minutieuse et responsable, des lois et renseignements pertinents, des preuves cliniques et de la documentation en matière d'éthique afin de prendre une décision qui reflète le mieux les valeurs jugées les plus importantes et qui réduit les préjudices qui en découlent.
Étant donné les décisions juridiques prises par les plus hauts tribunaux du pays et les freins et contrepoids associés à la promulgation des lois, l'aide médicale à mourir est légale au Canada pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé graves et irrémédiables, qui connaissent un déclin avancé et irréversible de leurs capacités et qui ont des souffrances persistantes qui donneront lieu à une mort naturelle raisonnablement prévisible. Ces personnes doivent avoir 18 ans ou plus et avoir été informées des moyens qui existent pour soulager leurs souffrances.
Sur le plan éthique, le cadre du Canada en matière d'aide médicale à mourir est appuyé par des considérations relatives à la bienfaisance et à la non-malfaisance, au devoir de présenter des avantages et d'éviter les préjudices, de même qu'au respect de l'autonomie et de la justice. À l'heure actuelle, la question à se poser semble être: y a‑t‑il des éléments de l'aide médicale à mourir qui devraient être abordés par une autre approche que celle permettant aux mineurs matures de prendre d'autres décisions pour eux-mêmes en matière de soins de santé, même celles qui ne prolongeront peut-être pas leur durée de vie? Je pense par exemple à une personne mineure mature qui choisit les soins palliatifs ou qui refuse un autre traitement de chimiothérapie offrant peu de chances de réussite.
Dans le cadre d'une telle réflexion, on pourrait choisir de respecter l'autonomie des mineurs matures tout en voulant s'assurer de mettre en place des mesures de protection appropriées. Le cadre actuel pour l'accès à l'aide médicale à mourir est associé à de telles mesures qui pourraient s'appliquer aux mineurs matures, si l'accès leur était ouvert.
Par exemple, pour qu'une personne soit jugée capable de consentir à l'aide médicale à mourir, elle doit être en mesure de comprendre ce qu'elle signifie et de comprendre les conséquences du consentement à la procédure ou de son refus. La capacité est propre à chaque décision, puisque plus la décision sera complexe et ses conséquences seront importantes, plus le niveau de développement cognitif et la maturité requis pour prendre la décision seront élevés. Il faut donc que des mesures de protection soient incluses dans le processus, afin de veiller à ce que seules les personnes qui répondent à ces exigences strictes et qui ont les capacités cognitives et la maturité requises puissent accéder à l'aide médicale à mourir.
J'aimerais faire deux recommandations supplémentaires.
Premièrement, il faudrait accroître l'accès aux soins palliatifs, afin qu'ils soient offerts à toutes les personnes qui en ont besoin à titre de solution de remplacement à l'aide médicale à mourir. Cela étant dit, selon ce que je comprends de ce que disent mes collègues expérimentés dans le domaine des soins palliatifs, dans certains cas rares, même les soins palliatifs ne peuvent suffire à soulager les souffrances irrémédiables d'une manière acceptable pour le patient.
Enfin, bien que le rapport du Conseil des académies canadiennes soit excellent, les membres du groupe de travail ont reconnu que l'analyse du point de vue des jeunes relatif à l'aide médicale à mourir n'était pas suffisante pour veiller à ce que l'opinion des personnes les plus touchées par un élargissement de l'accès soit prise en compte.
Nous ne connaissons pas le point de vue des jeunes qui ont un éventail d'expériences de vie pertinente: les jeunes Autochtones, les jeunes handicapés, les jeunes du système de protection de la jeunesse et les jeunes vivant avec une maladie en phase terminale, et leur famille. Dans l'esprit des témoignages précédents de Franco Carnevale et de Mary Ellen Macdonald, pour assumer nos responsabilités envers les jeunes, il faudrait étudier leurs perspectives et entendre ce qu'ils ont à dire dans le cadre des délibérations sur l'accès élargi à l'aide médicale à mourir.
Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous faire part de mes observations. Je serais heureuse de répondre à vos questions, au meilleur de mes connaissances.
:
Il n'y a pas de problème.
Au Québec, à 14 ans, on peut prendre des décisions au sujet de certains types de soins. Une fois qu'on a établi l'âge pour la capacité décisionnelle et qu'on décide de procéder par étapes, la première étape ne devrait-elle pas consister tout simplement à élargir l'accès à l'aide médicale à mourir aux patients de la voie 1, c'est-à-dire ceux dont la mort est imminente?
Sur le plan de la psychopédiatrie ou de la psychiatrie, le rapport du Groupe d'experts sur l'aide médicale à mourir et la maladie mentale a démontré qu'il faudrait établir la chronicité du problème de santé. Logiquement, dans le cas des mineurs matures, on exclurait donc les adolescents suicidaires. Pour d'autres pathologies dégénératives, il faudrait avoir épuisé tous les traitements et tous les moyens pour soulager le patient. Or, cela ne se fait pas rapidement après un diagnostic.
Si on élargissait par étapes l'accès à l'aide médicale à mourir et qu'on établissait la capacité décisionnelle entre 14 et 17 ans, comme c'est le cas au Québec, tout en l'accordant strictement aux patients dont la mort est imminente, cela enlèverait-il la réserve que vous avez pour nous permettre d'aller de l'avant?
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Merci beaucoup à nos témoins. Je crois que vos brillantes idées sur ce volet ont été très utiles au Comité, alors je vous en remercie.
À l'heure actuelle, l'Association canadienne des évaluateurs et des prestataires de l'AMM met sur pied un programme de formation, qui sera bientôt terminé, sur l'évaluation et la prestation de l'aide médicale à mourir. Elle sera accréditée par le Collège royal, le Collège des médecins de famille du Canada et l'Association des infirmières et infirmiers du Canada.
Connaissez-vous ce programme et savez-vous s'il répond complètement au problème des mineurs matures?
Si vous ne le connaissez pas ou s'il ne répond pas complètement à ce problème, pensez-vous qu'on devrait élaborer une formation de ce type pour les mineurs matures, peut-être sous les auspices du Collège royal et aussi de la Société canadienne de pédiatrie, quelque chose qui ferait en sorte que nous ayons la certitude que les évaluateurs d'AMM et les prestataires d'AMM ayant affaire avec des mineurs matures, sont en conformité avec une norme particulière de compétence professionnelle?
Cette question s'adresse à l'un ou l'autre des témoins.
Je voudrais juste vous remercier. Je ne sais plus qui l'a dit, mais je crois que c'est la déclaration la plus percutante aujourd'hui, à savoir que le retard n'est pas une décision neutre. Cela s'applique à tous les débats que nous avons, depuis des années maintenant, dans ce pays.
Ce que je comprends de cette conversation est que nous essayons de composer avec nos propres inquiétudes. En tant que législateurs et en tant que professionnels médicaux, nous voulons nous assurer de bien faire ce qu'il faut, alors qu'il s'agit en fait ici de mineurs matures, de l'aptitude de l'enfant ou celle du jeune mature, et c'est leur décision.
Ma question porte sur le fait d'écouter leur voix. Quand pour commencer leur nombre est si bas et que nous parlons de financer des projets, de sortir et de donner une voix, j'ai bien peur qu'il s'agisse d'un autre exemple où l'on remet les choses à plus tard alors qu'en fait, le retard n'est pas neutre. Nous avons une forme d'accord ici pour le volet un.
Je vais commencer par vous, madame Davies. Cela vous inquiète-t‑il que nous ne fassions que remettre tout cela à plus tard?
:
Je souhaite la bienvenue au second groupe.
Nous avons un vote à 20 h 30, avec la sonnerie qui retentira à partir de 20 heures. Y a‑t‑il consentement unanime pour continuer pendant 20 minutes après le début de la sonnerie?
Des députés: D'accord.
Le coprésident (L'hon. Marc Garneau): Merci. Très bien.
Nous devons faire preuve de discipline en ce qui concerne le temps.
Cela dit, je voudrais faire quelques commentaires à l'intention de nos nouveaux témoins.
Avant de parler, veuillez attendre que je vous nomme.
Je vous rappelle que tous les commentaires doivent être adressés à l'un ou l'autre des coprésidents.
Lorsque vous avez la parole, veuillez parler lentement et distinctement dans l'intérêt des interprètes.
Vous avez le choix de l'interprétation dans cette vidéoconférence. Vous pouvez sélectionner, au bas de votre écran, le parquet, l'anglais ou le français. Il y aura sans doute des questions en anglais et en français.
Lorsque vous avez fini de parler, veuillez désactiver votre micro.
Cela dit, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos témoins du groupe numéro deux, qui sont là pour nous parler des mineurs matures.
Ils comparaissent à titre personnel.
Nous avons Mme Caroline Marcoux.
[Français]
Nous recevons également le professeur Roderick McCormick.
[Traduction]
Nous accueillons Timothy Ehmann, médecin et pédopsychiatre.
Les trois comparaissent en visio.
Je vous remercie de votre participation.
Pour commencer, vous ferez une déclaration préliminaire, dont la durée sera limitée à cinq minutes.
Nous entendrons successivement Mme Marcoux, M. McCormick, puis le Dr Ehmann.
Madame Marcoux, vous disposez de cinq minutes. Allez‑y.
:
Merci, monsieur le président.
Bonsoir à tous.
Je suis Caroline Marcoux. Je suis la maman du beau Charles, que j'ai avec moi, juste ici.
Le 30 juillet 2019, Charles a reçu un diagnostic d'ostéosarcome, un cancer des os, localisé dans son fémur droit. Charles avait alors 15 ans et 9 mois.
Au cours de l'année qui a suivi, il est passé par toute une série de traitements de chimiothérapie et il a subi une opération importante à la jambe pour y retirer la masse. Charles a toujours été d'une nature joviale, optimiste et souriante, comme on le voit. Il a été un patient exemplaire et très résilient pendant sa maladie.
Quelques mois après la fin des traitements, on lui a annoncé une récidive à ses deux poumons. Il a eu des opérations sur chacun des deux poumons pour retirer les métastases, mais, malgré cela, la maladie est revenue tout de suite après, non seulement à ses deux poumons, mais aussi à son genou. À partir de la double récidive, on savait que la maladie était irrémédiable et qu'il n'y avait plus rien à faire pour la stopper. C'était en janvier 2021.
Comme toujours, Charles a accepté ce qui lui arrivait. Psychologiquement, il se sentait quand même bien, mais son état physique a commencé à se dégrader peu à peu. Il avait de moins en moins d'énergie, de moins en moins d'appétit et de plus en plus de douleur. En fait, à partir de janvier, il avait à peu près une bonne journée sur deux.
Il a quand même vécu avec fierté un épisode important pour la vie d'un jeune de 17 ans, c'est-à-dire qu'il a obtenu son permis de conduire. Il avait alors un poumon en moins, parce que son poumon gauche était plein de liquide et il n'y avait plus rien à faire pour cela. Grâce à son permis de conduire, il a profité de son autonomie à peu près trois ou quatre fois dans la semaine qui a suivi. C'est tout. Par la suite, il n'était plus assez en forme pour quitter le sous-sol de la maison.
À partir de là, et même un peu avant, tous les suivis médicaux, les services d'urgence et les dosages de médicaments étaient assurés par l'équipe des soins palliatifs. Cette équipe faisait de son mieux, dans les limites des possibilités qu'elle avait, mais elle n'arrivait jamais à calmer totalement la douleur. C'est sans parler des effets secondaires: Charles avait tout le temps chaud et il dormait vraiment très mal. Les médicaments ne faisaient pas l'affaire. Il a pris du Dilaudid, de la morphine, du fentanyl, de la méthadone, bref, tout ce qu'il pouvait recevoir pour calmer la douleur. Le nombre de médicaments qu'il prenait augmentait sans cesse, car la douleur et les symptômes augmentaient constamment. Il avait mal aux poumons, il avait mal aux épaules et il avait une toux grasse inquiétante. Son état n'allait pas en s'améliorant.
À partir du début juillet, donc peu de temps après avoir obtenu son permis de conduire, il ne se levait presque plus du lit d'hôpital qu'on lui avait apporté au sous-sol. Surtout, il était tanné: tanné de ne rien faire, tanné d'écouter la télévision, tanné d'avoir mal et tanné de ne plus avoir de qualité de vie. Telle était sa situation, en effet. Il s'est mis à angoisser au sujet de la mort. Il se demandait quand la mort allait arriver, s'il allait être seul à ce moment-là et comment cela allait se passer. Il était de nature calme et posée, mais il a commencé à faire des crises d'anxiété, des crises d'angoisse et des crises de panique. Cela démontre vraiment à quel point il était rendu complètement impuissant et au bout du rouleau.
C'est vers la mi-juillet qu'il a commencé à parler de l'aide médicale à mourir. Il m'en a parlé, il en a parlé à la travailleuse sociale et au médecin. Il voulait savoir s'il y aurait droit. Il n'en pouvait plus d'attendre. Il n'en pouvait plus de souffrir et d'attendre la mort. On savait que la fin était imminente, là n'était pas la question. Il aurait aimé avoir le choix et le contrôle du moment de son décès. Cela l'aurait probablement sécurisé. Ce qu'il disait, c'est qu'il aurait aimé avoir l'emprise sur la maladie au moins sur ce plan, parce qu'il ne l'avait pas eue pendant les deux années précédentes. Il n'avait jamais parlé de la mort avant ce moment. Il avait toujours été positif. Au moment où il a fait cette demande, il était déjà en phase terminale. On savait que la mort était imminente, mais il fallait attendre, parce qu'il avait alors 17 ans et 9 mois.
C'est inhumain pour une mère de se faire dire par son enfant: « Maman, fais quelque chose, je n'en peux plus. » Je l'ai accompagné là-dedans, dans sa souffrance, jusqu'à la fin. J'aurais eu envie de répondre à son souhait et de faire tout ce que je pouvais pour calmer son anxiété et sa douleur. Tout ce que les médecins pouvaient faire, encore une fois, c'était augmenter la médication. Il avait de la difficulté à parler, parce qu'il était très médicamenté. Il ne mangeait plus. Au moins, il pouvait exprimer ses besoins et nous dire ce qu'il voulait.
La seule solution possible, à ce moment-là, était la sédation palliative. Un jour, il l'a demandée. Complètement tanné, il voulait juste dormir et ne plus être conscient de son état. Il est donc entré à l'hôpital en pédiatrie, parce que c'est ce qu'il voulait. Il a été plongé dans un sommeil artificiel. Nous l'avons veillé pendant 24 longues heures, et son sommeil ne semblait pas paisible. Encore une fois, c'était comme si les médicaments ne suffisaient pas à l'apaiser, pas plus qu'ils n'avaient suffi à apaiser sa douleur auparavant. Il n'avait pas l'air d'être dans un état confortable. En tant que mère, j'ai dû le voir dans cet état, sans pouvoir comprendre ses besoins, en attendant qu'il soit complètement inconscient. Cela a été 24 longues heures.
Il est décédé le 30 juillet 2021, exactement deux ans, jour pour jour, après son diagnostic. Il avait donc 17 ans et 9 mois.
J'ai perdu mon garçon, mais je m'accroche à deux promesses que je lui ai faites. D'abord, il y a celle de réaliser le voyage de ses rêves en Angleterre. Ensuite, au moment où il a demandé l'aide médicale à mourir, je lui ai promis que j'allais faire tout ce que je pouvais pour militer, ou à tout le moins pour prendre la parole comme je le fais ce soir, afin que cela devienne accessible aux jeunes comme lui qui aimeraient l'obtenir.
Charles était un jeune adolescent très mature, même avant sa maladie. Il a vécu sa maladie, pendant ses deux dernières années, avec une sérénité qui me donne la force de traverser cette période, celle de sa perte. J'ai pris soin de lui jusqu'à la fin, et je l'aurais fait aussi longtemps qu'il l'aurait fallu. Je ne voulais pas perdre mon garçon, c'est certain, mais je n'en pouvais plus de le voir souffrir, et lui n'en pouvait plus de souffrir non plus. Il avait vraiment atteint ses limites physiques et psychologiques. Je me serais occupée de lui jusqu'à la fin, mais j'espérais ne pas avoir à m'en occuper alors qu'il aurait atteint un stade où il aurait perdu sa dignité. J'espérais ne pas avoir à changer ses couches et à le voir maigrir jusqu'à devenir un cadavre ambulant. Je me serais rendue jusque-là, mais j'espérais que cela n'allait pas être le cas. Heureusement, quand il est décédé, il avait encore ses belles joues dodues, alors nous avons pu éviter cela, mais il était vraiment au bout du rouleau.
Je sais que la décision d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourir aux mineurs matures n'est pas à prendre à la légère. Charles non plus, du haut de ses 17 ans, en fin de vie, ne la prenait pas à la légère. Cela n'aurait peut-être pas devancé sa mort de beaucoup, puisqu'il était déjà en fin de vie. La date qu'il aurait fixée aurait peut-être été à quelques jours près du 30 juillet. Cependant, il était prêt et il méritait ce choix. Cela aurait été sa décision, finalement. C'est lui qui aurait choisi à quel moment partir et qui aurait choisi les gens qui l'auraient accompagné. C'est le seul choix, ou du moins le dernier choix qu'il aurait pu faire dans sa vie.
Je me nomme Rod McCormick. Je suis Mohawk, c'est‑à‑dire Kanien'kehá:ka. Je suis également professeur et titulaire d'une chaire de recherche sur la santé autochtone à l'université des rivières Thompson. Je vis sur la réserve des Tk'emlúps te Secwépemc, la nation de ma partenaire, à Kamloops, en Colombie-Britannique, où je dirige le centre de recherche autochtone All My Relations.
Je remercie le Comité de son invitation à venir témoigner sur le projet de loi . Je suis déjà venu le faire sur les conséquences du projet de loi chez ceux qui souffrent de maladie mentale. Je voudrais élargir ce témoignage à l'aide médicale à mourir aux mineurs matures.
D'après moi, on a agi trop vite en voulant élargir l'admissibilité de l'aide médicale à mourir. L'expérience et la douleur m'ont appris que la meilleure façon d'éviter une chute sur une pente glissante ou sur le flanc d'une colline est d'avancer avec prudence, à petits pas.
Comme je suis un professeur spécialiste de la santé autochtone et titulaire d'une chaire de recherche et que je possède environ 35 années d'expérience comme fournisseur de services en santé mentale aux Autochtones, mon témoignage épousera un point de vue autochtone sur la santé mentale.
D'entrée de jeu, j'avoue que cet élargissement de l'aide médicale à mourir aux mineurs m'inquiète beaucoup. Comme ma partenaire et ses enfants sont Tk'emlúps te Secwépemc et que je vis dans leur communauté, j'ai personnellement éprouvé les conséquences de l'annonce de la découverte des tombes des 215 enfants sur les terrains du pensionnat local. De ma fenêtre, je vois très bien cet édifice et j'aperçois les champs où ils étaient inhumés dans des fosses peu profondes.
Cette tentative pour dissimuler les cadavres symbolise, d'une certaine façon, les nombreuses tentatives historiques du Canada pour, comme Duncan Campbell Scott l'a dit, se débarrasser du problème « indien ». Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, ces tentatives ont consisté à affamer les Autochtones, à les stériliser, à les déplacer de force dans des réserves où les logements étaient dangereux, insalubres et surpeuplés, à les alcooliser, à les mettre en contact avec des couvertures contaminées par la variole, à rassembler leurs enfants de force dans des pensionnats où on a expérimenté la malnutrition, à fermer les yeux sur la contagion de la tuberculose dans ces mêmes établissements, à faire enlever les enfants par les services de protection de l'enfance et à emprisonner en proportion excessive les Autochtones dans le système carcéral. La liste n'est pas close.
Bref, les multiples méthodes essayées par le Canada pour éradiquer les peuples et la culture autochtones font que nous sommes partout surreprésentés dans le réseau de santé, y compris dans les morts prématurées. « Il dramatise », direz-vous, mais faut‑il vraiment un autre boulevard vers la mort?
Mon cynisme découle en partie de décennies de travail avec de jeunes Autochtones pour les aider à acquérir et à conserver une bonne hygiène de vie. Comme je l'ai dit dans mon témoignage antérieur, j'ai travaillé au contact de nombreux jeunes Autochtones endoloris qui ont réussi à se débarrasser de leurs idées suicidaires. Tous, après leur rétablissement, se sont dits soulagés de ne pas avoir choisi une solution permanente à ce qui s'était révélé un problème temporaire. La recette pour survivre, c'est d'obtenir la bonne aide au bon moment.
De nombreux obstacles empêchent l'aide d'arriver, notamment l'absence de diagnostics exacts et de traitements adaptés, un système de santé raciste, la défiance à l'égard d'un système de santé qui n'a pas toujours à cœur nos intérêts, l'ambiguïté du partage des compétences et l'abdication de leurs responsabilités par les divers gouvernements. Le principal facteur est l'éloignement de nos communautés.
Souvent, dans les réserves et les lieux éloignés, des infirmières ou des infirmières praticiennes surmenées et mal préparées fournissent la gamme nécessaire de services de santé. On le voit à l'absence presque absolue de soins palliatifs pour les enfants et les jeunes Autochtones.
Pendant que je préparais cette déclaration, j'ai épluché l'Internet, à la recherche de preuves de la prévisibilité du caractère irrémédiable de la maladie mentale. Je n'ai rien trouvé. Une politique publique aussi importante que celle‑là ne devrait-elle pas se fonder sur des preuves?
Certains prétendent que le refus d'autoriser l'aide médicale à mourir aux jeunes et aux angoissés est discriminatoire. Mais, sans posséder de preuves, n'agissons-nous pas de même contre eux, mais d'une autre façon?
Actuellement, je crois que la loi autorise le mineur à déterminer par lui‑même si diverses méthodes de traitement lui conviennent et à refuser celles qu'il juge inappropriées. D'après mon expérience clinique, la plupart des jeunes ne sont pas au courant des diverses options qu'ils peuvent exercer et n'en possèdent qu'une vague compréhension. J'en conviens, ces jeunes Autochtones pourraient ne même pas y avoir accès dans leur communauté. Mais l'accessibilité des soins de santé ne devrait-elle pas être égale pour tous les Canadiens?
Les adolescents, dont le cerveau n'a pas terminé son développement, peuvent-ils prendre des décisions d'une telle importance?
Évidemment, je ne peux parler pour tous les peuples autochtones, mais je discerne, à la faveur de l'édiction de cette loi et de l'élargissement de sa portée, le signe que le gouvernement du Canada et, par extension, les Canadiens ont abdiqué leurs responsabilités.
Au lieu de faire tout notre possible pour fournir la gamme de services de santé mentale nécessaires aux jeunes Autochtones pour qu'ils surmontent leur douleur, nous leur imposons plutôt la lourde charge de décider de choisir une solution permanente, sanctionnée par l'État, à ce qui pourrait facilement être un problème temporaire. Voilà où les valeurs culturelles canadiennes du plus grand nombre déçoivent nos attentes à nous tous. L'insistance sur les droits et libertés individuels ne fait aucune place à la nécessité d'une responsabilisation collective.
Avant de terminer, je voudrais lire une pensée du psychiatre existentialiste Viktor Frankl.
La liberté, toutefois, ne résume pas tout. Elle n'est qu'une partie d'un tout et elle ne représente que la moitié de la vérité. Elle n'est que l'aspect négatif de tout phénomène dont le côté positif est la responsabilité. En fait, la liberté menace de dégénérer en simple arbitraire, à moins qu'on ne la concrétise dans son vécu par une responsabilisation.
J'incite votre comité à recommander vivement au gouvernement du Canada et aux provinces d'accepter leurs responsabilités collectives de ne pas élargir l'accès de l'aide médicale à mourir aux mineurs mais, plutôt, à améliorer les services de santé mentale offerts aux jeunes Autochtones et à tous les jeunes Canadiens.
Nia:wen. Merci.
:
Je vous remercie de votre invitation.
Je me nomme Timothy Ehmann et j'exerce la pédopsychiatrie depuis 10 ans dans divers cadres, auprès de patients hospitalisés, externes, en milieu universitaire et dans la communauté.
Tout de suite en commençant, je déclare tout net que l'élargissement du régime actuel de l'aide médicale à mourir aux mineurs — matures ou autres —, c'est de la négligence et de l'irresponsabilité.
Le débat qui nous occupe a débuté peu après que j'ai commencé à exercer et il a été comme un nuage noir suspendu au‑dessus de ma carrière qui débutait. J'ai suivi quand le gouvernement du Canada, malgré de nombreux avertissements, est allé de l'avant. J'ajoute ma voix au concert de ceux qui disent qu'il serait sage pour lui de ne pas aller plus loin dans cette voie périlleuse.
Il est faux que la mort soit un traitement légitime contre toute souffrance.
Faux également que les médecins puissent évaluer avec certitude la compétence et la capacité des mineurs de consentir à la mort. Cette affirmation ne s'appuie sur aucune recherche publiée sur la question. Le médecin qui la colporte demande à peine plus que de lui faire confiance parce qu'il est médecin.
Il n'existe aucune évaluation normalisée, digne de confiance et valide pour déterminer cette compétence chez les mineurs. La recherche a montré que les évaluations de cette capacité faites sans aide, même par des médecins aguerris et par ailleurs qualifiés, donnent des résultats incertains. Dans la pratique médicale de tous les jours, les enfants sont souvent mal informés, et la communication entre eux et un médecin adulte est souvent imparfaite.
Plusieurs facteurs systémiques interviennent dans la décision de l'enfant, qui n'est jamais à l'abri d'influences. Voilà qui soulève l'importante question du choix de la méthode pour l'évaluation précise du degré de liberté de l'enfant dans toute décision. Un facteur nouveau d'influence systémique pourrait simplement être le changement culturel que le gouvernement du Canada propage, qui est de diriger de plus en plus notre société vers une culture du désespoir.
Le message de l'État offrant la mort comme solution aux souffrances est une incitation au suicide. Nous connaissons bien les épidémies de suicides chez les jeunes, par exemple dans les réserves; nous savons bien que les messages de désespoir accroissent les taux de suicide.
Difficile, aujourd'hui, d'être un enfant au Canada.
L'aide médicale à mourir n'est pas une pratique médicale fondée sur des données probantes. À ce titre, en obligeant les médecins à l'adopter par des pressions légales, on souille et on sape l'intégrité de leur profession. Les médecins canadiens ont été formés pour exercer une médecine moderne, fondée sur des données probantes appuyées par des faits scientifiques et non une médecine postmoderne, idéologique, sous influence politique.
L'aide médicale à mourir est une pratique expérimentale qui ne s'appuie sur aucune donnée préexistante relative à sa sûreté, qui ne prévoit aucune obligation de divulguer les résultats indésirables ni mesure adéquate de protection et qui ne responsabilise pas ses acteurs. Le gouvernement fédéral doit s'astreindre au même degré de responsabilisation et aux mêmes normes que ceux qu'il imposerait à une société pharmaceutique qui voudrait lancer sur le marché canadien un nouveau médicament ou un nouveau traitement. Il ne faut pas soumettre les enfants à des expériences présentant de hauts risques.
Les mineurs forment une population absolument vulnérable. Les doctrines postmodernes selon lesquelles la négation du droit à la mort des populations vulnérables équivaut à de la discrimination contre elles pèchent par la superficialité et elles sont dangereuses. Les lois qui s'en inspirent sont une menace pour nos enfants.
La conduite du gouvernement canadien et de ses agents avec le régime de l'aide médicale à mourir est paternaliste.
Les organismes qui représentent les groupes défavorisés et vulnérables de notre société et qui sont venus témoigner devant votre comité n'ont pas été pris au sérieux. Ils ont demandé des garde-fous ou l'exclusion à l'admissibilité à l'aide médicale à mourir pour leurs mandants, ce qu'on leur a refusé. Le gouvernement du Canada est parvenu à leur faire croire qu'il savait mieux que ces populations vulnérables ce qui était dans leur intérêt.
Dans une société moderne dotée d'un art médical moderne et profitant des avancées de la science, le besoin de tuer un enfant n'existe pas. Alors, pourquoi le gouvernement canadien fonce‑t‑il à toute allure pour rendre les mineurs admissibles à l'aide médicale à mourir?
Merci.
:
Je suis psychiatre pour enfants et adolescents. Permettez-moi de vous raconter une histoire.
Je me suis occupé d'une adolescente de 17 ans en 2018. Sa mère était morte quand elle avait sept ans. Pendant les trois années suivantes, elle a été agressée sexuellement à répétition par un membre de sa famille. Entre l'âge de 10 et 12 ans, elle a immigré au Canada. Au Canada, après quelques années, à l'âge de 15 ans, elle a été mise à la porte par son père. Elle vivait de façon indépendante, allait à l'école à temps plein en travaillant dans une chaîne de restauration rapide à peu près 40 heures par semaine.
Je l'ai rencontrée aux urgences. Elle était suicidaire. Je l'ai admise à l'hôpital. J'étais la première personne à qui elle confiait avoir vécu des agressions sexuelles. Après m'en avoir parlé, elle s'est effondrée. Elle souffrait du syndrome de stress post-traumatique et de dépression. J'étais assis avec cette enfant, jour après jour, qui me demandait en sanglotant: « Docteur Ehmann, laissez-moi mourir; laissez-moi rentrer chez moi. Je veux mourir. » C'était la pire souffrance psychologique que j'avais jamais vue. Cela m'a profondément ébranlé, personnellement. Elle a passé six mois dans notre unité de patients hospitalisés, par intermittence.
Je peux vous dire que je me suis posé la question de savoir quelle était la bonne chose à faire. Mais en fin de compte, lorsqu'un médecin est confronté à des patients qui souffrent d'un problème médical, d'un problème de santé mentale ou des circonstances de la vie, la règle est toujours de protéger et de préserver la vie — et je crois profondément à cette règle.
Je ne sais pas comment elle va maintenant. Je sais qu'elle a survécu à ces hospitalisations et qu'elle s'est rétablie, en partie grâce aux soins que nous lui avons fournis à l'hôpital. Comme elle y est restée six mois, mes collègues ont tous participé à son rétablissement aussi.