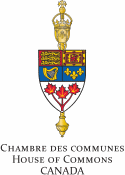:
Bonsoir. J'aimerais déclarer la séance ouverte.
[Français]
Je vous souhaite la bienvenue à la réunion du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir.
Je souhaite donc la bienvenue aux membres du Comité, à notre témoin et aux gens du public qui suivent cette réunion sur le Web.
Je m'appelle Marc Garneau et je suis le coprésident de la Chambre des communes de ce comité. Je suis accompagné de l'honorable Yonah Martin, la coprésidente du Sénat.
[Traduction]
Aujourd'hui, nous poursuivons notre examen prévu par la loi des dispositions du Code criminel concernant l'aide médicale à mourir et leur application.
J'aimerais rappeler aux membres et aux témoins qu'ils doivent garder leur micro en sourdine à moins d'être nommés par l'un des coprésidents. Je vous rappelle que toutes les observations doivent être formulées par l'entremise des coprésidents. Lorsque vous vous exprimez, veuillez parler lentement et clairement. L'interprétation de cette vidéoconférence fonctionnera comme une réunion de comité en personne. Vous pouvez choisir au bas de votre écran le parquet, l'anglais ou le français.
Sur ce, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre témoin pour cette première partie de la réunion, qui est ici pour discuter de l'aide médicale à mourir, l'AMM, lorsqu'un trouble mental est la seule condition médicale sous-jacente.
Bienvenue à Mme Jennifer Chandler, professeure en droit à l'Université d'Ottawa.
Merci de vous joindre à nous.
Nous allons commencer par votre déclaration liminaire, madame Chandler. Vous disposerez de cinq minutes, puis nous procéderons à la période des questions.
Nous vous cédons la parole, madame Chandler.
:
Dans un premier temps, je remercie le Comité de me recevoir aujourd'hui. C'est un honneur de comparaître devant vous, et j'espère que mes déclarations vous seront utiles dans le cadre de votre étude de cet enjeu difficile.
Comme M. Garneau l'a mentionné, je suis Jennifer Chandler. Je suis professeure titulaire en droit à l'Université d'Ottawa, où j'enseigne le droit de la santé et me spécialise en droit en matière de santé mentale, en neuroéthique, dans les questions relatives aux interventions chirurgicales au cerveau et dans la loi.
Je parle à titre personnel, bien entendu, et je ne représente pas l'université ou le groupe consultatif d'experts dont j'étais membre. Je ne représente pas non plus les points de vue du groupe d'experts du Conseil des académies canadiennes, CAC, auquel j'ai également siégé.
Je me demandais ce que je pourrais dire dans ces remarques liminaires qui seraient utiles à ce groupe à la lumière de ce que les autres témoins qui m'ont précédé vous ont présenté, et ils ont fait un excellent travail pour ce faire. J'ai pensé que peut-être, comme je suis avocate, je parlerais d'un point de vue juridique et j'aborderais la question de la discrimination, parce qu'elle est invoquée comme une question centrale lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'il faut faire au sujet de l'admissibilité des personnes atteintes d'un SPMI, lorsqu'un trouble mental est le seul problème médical invoqué.
À l'heure actuelle, comme vous le savez, la loi exclut une catégorie particulière de personnes de l'admissibilité, à savoir les personnes qui souffrent uniquement de troubles mentaux. Cette exclusion est définie en fonction d'une catégorie précise d'invalidités.
Il y a deux arguments, que vous avez entendus, sur la façon dont cela est discriminatoire ou non.
Selon un point de vue, l'exclusion d'un groupe de personnes est discriminatoire lorsqu'elle est fondée sur un handicap mental, parce qu'elle prive ces personnes d'un avantage ou d'une option qui est disponible pour d'autres, ce qui est injustifié lorsqu'elles remplissent tous les autres critères d'admissibilité que les autres remplissent.
Selon l'autre point de vue, le fait d'offrir l'aide médicale à mourir aux personnes handicapées, y compris les personnes qui souffrent de déficiences mentales, est discriminatoire, car cela les expose, et seulement elles, les personnes handicapées, à un risque accru de décès en suggérant peut-être que la mort pourrait être une bonne option dans leur cas ou en leur facilitant l'accès à la mort.
Autrement dit, pour résumer, d'une part, nous avons accès à une option qui est perçue comme étant un avantage, qui est injustement retenu, et d'autre part, nous avons accès à une option, qui est un préjudice, qui est injustement imposé. Comment concilier ces points de vue?
Je pense que nous pouvons avoir la certitude que les personnes qui défendent ces deux points de vue le font de bonne foi et croient fermement qu'il est juste sur le plan de la discrimination.
En fait, comme vous l'avez entendu — j'ai regardé les délibérations de vendredi —, les personnes qui ont vécu une expérience ont ces points de vue opposés également.
Je propose de vous faire part de quelques réflexions d'un point de vue juridique sur la façon dont ces opinions opposées, ce qui est discriminatoire et ce qui est juste ou injuste dans ces circonstances, peuvent être conciliées. Bien entendu, mon point de vue est d'ordre juridique et doit être tempéré par les idées de ceux qui ont une expérience vécue et de ceux qui fournissent des soins, et en reconnaissant que d'autres pourraient ne pas partager ma lecture des cas et mon interprétation de la loi.
Essentiellement, la Cour suprême du Canada a dû se pencher sur ce problème particulier à maintes reprises dans le passé, à savoir si le traitement différentiel d'un groupe de personnes ayant une invalidité est discriminatoire. Dans ces cas, elle a noté le défi de ce qu'elle a appelé le « dilemme de la différence ». Cela signifie essentiellement que dans certains cas, pour atteindre l'égalité, pour promouvoir la dignité, il est nécessaire de traiter les gens différemment, alors que dans d'autres cas, il est nécessaire de les traiter de la même façon.
Pour vous donner un exemple concret d'un cas de ségrégation scolaire pour des enfants souffrant de graves handicaps physiques, la cour a déclaré qu'une filière scolaire distincte ou ségréguée pouvait protéger l'égalité ou la violer, selon les besoins, les capacités et les circonstances de l'enfant en question.
Ce dilemme de la différence signifie qu'il est très difficile d'indiquer le même traitement ou le traitement différentiel pour répondre à la question de savoir ce qui favorise le mieux l'égalité.
Comment pouvons-nous alors trouver une solution?
Si vous examinez l'éventail de questions dont la Cour suprême a été saisie concernant ce type de problème particulier dans toutes sortes d'affaires, qu'il s'agisse de la scolarisation ou de l'accès à des indemnités pour accidents du travail, pour des blessures physiques ou mentales, je pense que la Cour suprême est assez mal à l'aise avec les attributions générales d'un ensemble précis de besoins, de capacités et de circonstances à un groupe dans son ensemble. Elle est beaucoup plus susceptible d'être à l'aise avec un régime, s'il est possible de le faire, qui prévoit des évaluations individualisées pour vérifier que toute présomption est en fait exacte dans des cas individuels.
Nous en arrivons à l'exclusion générale de toutes les personnes souffrant de troubles mentaux. Cela semble être problématique. Il s'agit d'un groupe très hétérogène de personnes qui ont des capacités, des circonstances et des besoins très différents. Je pense que la question que vous devez vous poser est la suivante: les critères du Code criminel, ainsi que les mesures recommandées par le groupe consultatif d'experts, offrent-ils un cadre adéquat pour effectuer ce type d'évaluation individualisée en toute sécurité? Je pense que oui. J'étais membre de ce groupe consultatif d'experts, alors, bien sûr, je pense que nous avons proposé quelque chose qui pourrait fonctionner, avec certaines mises en garde que j'aimerais porter à votre attention.
Cette question du financement adéquat est une garantie essentielle. C'est une question de financement adéquat dans les deux sens. Le financement adéquat des soutiens sociaux est essentiel pour garantir que ceux qui peuvent être aidés, dont la souffrance peut être soulagée, auront la possibilité que cette souffrance soit soulagée. Une société bonne et compatissante s'efforcera de faire de son mieux pour aider ceux qui sont en difficulté. Parallèlement, nous devons souligner qu'il existe des situations où n'importe quel soutien social ne suffira pas pour soulager une souffrance intolérable.
Par ailleurs, le financement adéquat concerne le type de financement mis à la disposition des évaluateurs et de l'infrastructure mise à leur disposition pour effectuer une évaluation minutieuse et approfondie. Le type d'évaluation multidisciplinaire approfondie requise ici comporte un long processus et de nombreuses personnes participant à la coordination d'une série de soutiens potentiels. Il faudra du temps et des ressources pour le faire correctement.
Si ces fonds ne sont pas disponibles, je vois un double risque. D'une part, les gens renonceront à fournir des évaluations à des personnes qui souffrent de façon intolérable, car ils n'auront pas l'impression de pouvoir le faire correctement, ou à l'inverse, certains pourraient faire une évaluation précipitée avec un risque dans l'autre sens.
Je pense qu'il est très important d'examiner et de mettre en place les mesures que nous avons relevées dans notre rapport concernant l'infrastructure, dans la limite de ce qui est raisonnable et possible.
L'autre mesure de protection...
:
Merci, madame la coprésidente.
Bonjour, madame, et merci beaucoup de vous joindre à nous.
Nous sommes limités dans le temps et j'aimerais vous poser quelques questions, si possible. Je vais les lire pour être aussi succinct que possible.
Premièrement, durant ma lecture du rapport du groupe d'experts, il semble qu'il y ait une contradiction que j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre. Je vais paraphraser, mais il fait état que le cadre juridique actuel peut s'appliquer à l'aide médicale à mourir lorsque le trouble mental est la seule condition médicale sous-jacente, sans nouvelles lois ou mesures de protection supplémentaires. Cependant, il dit aussi que le caractère irrémédiable du TM‑SPMI, soit lorsqu'un trouble mental est le seul problème médical invoqué, est difficile, voire impossible, à prédire. Le rapport n'apporte aucune preuve de cette possibilité et ne fournit aucune directive précise sur la manière de le déterminer.
Pour qu'une personne soit admissible à l'AMM, le caractère irrémédiable doit être déterminé. Comment concilier ce défi? Sans une feuille de route clairement définie pour déterminer que les troubles mentaux d'une personne sont irrémédiables, il semblerait que le trouble mental étant le seul problème médical invoqué ne soit pas compatible avec la loi existante.
:
Dans l'état actuel de la loi, si la condition est un trouble mental, la personne ne serait pas du tout admissible. Je dis que dans la loi dans sa forme actuelle, ce n'est pas un obstacle par opposition au fait d'octroyer l'accès au processus.
Permettez-moi de revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez fait référence à quelques affaires entendues par la Cour suprême du Canada portant sur de la discrimination dans des situations où des écoles ou l'accès à des prestations sont en cause. C'est nettement différent du concept de mettre fin à la vie d'une personne, je dirais, alors je ne suis pas certain si ce sont des cas... On ne compare pas des pommes avec des pommes, pour ainsi dire.
Nous nous retrouvons dans une situation où, comme vous l'avez dit, « irrémédiable » est un terme juridique et non pas un terme médical. Ce dont nous parlons, c'est de savoir si un trouble mental est permanent et ne peut être guéri, ce qui permettrait à une personne de bénéficier de l'AMM. C'est essentiellement ce dont nous parlons.
Pour ce faire, vous devez avoir certaines mesures de protection intégrées au système, alors vous devez avoir l'assurance que les médecins qui évaluent une personne souffrant d'un trouble mental sont aptes à faire cette évaluation au même titre que les médecins qui traitent avec une personne atteinte d'un cancer, pour utiliser l'exemple auquel j'ai fait référence plus tôt.
Êtes-vous convaincu, en vous appuyant sur votre expérience au sein du groupe d'experts et d'autres expériences, qu'il y a suffisamment de mesures de protection en place pour que le système fonctionne avec des personnes souffrant uniquement de troubles mentaux?
:
Oui. Le nœud du problème est de savoir si la souffrance peut être atténuée. Trois critères entreront en ligne de compte pour un tel pronostic à l'avenir: l'incurabilité, la présence d'un déclin irréversible et l'allègement de la souffrance dans des conditions acceptables pour la personne.
Les deux premiers critères ne font pas allusion à la présence de conditions acceptables pour la personne, mais le troisième le fait. La question qui se pose alors est la suivante: si un clinicien est au courant d'un traitement qui, selon lui, serait utile et qui, tout bien considéré, n'est pas déraisonnable sur le plan du fardeau par rapport aux avantages possibles, entre autres, mais que le patient refuse, que se passera‑t‑il alors?
Voici comment notre groupe d'experts a tenté d'aborder cette question. L'évaluateur et le demandeur devraient parvenir à une compréhension commune. Le demandeur aurait le droit de refuser tout traitement qu'il ne veut pas recevoir, mais en pareilles circonstances, lorsqu'il existe un traitement raisonnable qui, de l'avis du clinicien, pourrait aider le patient, il serait peut-être impossible pour le clinicien d'arriver à la conclusion que la maladie est incurable ou irréversible.
C'est un point délicat. Vous m'avez demandé comment cela serait interprété dans la loi. Nous avons des propositions sur la façon dont cette loi devrait être interprétée. Selon nous, dans de telles circonstances, le demandeur ne pourra peut-être pas conclure que la maladie est incurable, s'il existe un traitement raisonnable qui n'a pas encore été essayé.
:
C'est une question difficile, mais cruciale.
L'hon. Pierre Dalphond: Vous êtes une spécialiste, toutefois.
Mme Jennifer Chandler: Je pense qu'il s'agit d'une question suffisamment nouvelle au Canada et qui suscite suffisamment de préoccupations au sein de la population pour qu'il soit important de tenter d'harmoniser le plus possible le processus et les mesures de sauvegarde à l'échelle du pays. Dans un État fédéral, ce n'est pas chose facile. Je relisais encore une fois ce qu'on avait dit au sujet de l'interprétation de ces termes juridiques dans le Code criminel, en me demandant s'il serait possible d'ajouter quelque chose dans le code sur leur interprétation. Beaucoup de termes juridiques ont des définitions. Pourrait‑on essayer de définir certains de ces termes plus clairement dans le Code criminel? Ce serait utile, mais terriblement difficile à faire, en particulier au sujet des nuances que nous avons tenté d'expliquer sur le sens des mots « incurable », « irréversible », etc. Je ne pense pas que ce soit facile, mais cela reste une possibilité.
Outre cela, je ne pense pas qu'il soit possible d'ajouter beaucoup de choses dans les règlements, car les pouvoirs relatifs à la surveillance sont délégués dans le code. En élargissant la délégation, on pourrait sans doute ajouter plus de détails dans les règlements pris en vertu du Code criminel. C'est une autre possibilité, mais bien sûr, on se heurte alors au problème de voir le gouvernement fédéral commencer à s'immiscer dans ce qui ressemble de trop près aux soins de santé. Bon nombre des meilleurs constitutionnalistes au pays travaillent pour le gouvernement et peuvent vous conseiller sur sa marge de manœuvre.
Quelles sont les autres solutions? Si on laisse cela aux provinces, elles peuvent manquer de cohérence. Elles peuvent opter pour diverses approches. Je pense qu'on pourrait accomplir beaucoup en demandant aux associations professionnelles, par exemple, des psychiatres, des fournisseurs d'aide médicale à mourir de promulguer des lignes directrices, car elles ont un effet régulateur très important. Même s'il ne s'agit pas de lois, ceux qui ne respectent pas ce qui équivaut clairement à la norme de soins s'exposent à commettre une faute professionnelle, etc.
Il existe diverses façons d'imposer la loi sans que cela soit inscrit dans le Code criminel. La question qu'il faut se poser est la suivante: est‑ce possible de mettre en œuvre tous ces éléments pour qu'ils s'appliquent à l'échelle nationale? Je pense que l'ACEPA, l'Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l'AMM, et d'autres s'y emploient activement en ce moment. Il s'agit là d'une autre façon d'en arriver à la protection nationale qu'il serait souhaitable d'avoir ici.
Tout à l'heure, je disais que les recommandations du rapport étaient des lignes directrices, en quelque sorte. En effet, dans chacune des recommandations, on utilise le verbe « devoir ». Si c'était considéré comme tel, cela pourrait résoudre un certain nombre de problèmes que ce soit considéré comme tel.
Prenons la recommandation 10. Même dans le milieu des experts en psychiatrie, il y a de la résistance. L'Association des psychiatres du Québec dit qu'il faut aller de l'avant, tandis que des psychiatres nous ont dit le contraire. Cela a mené le Québec à décider de ne pas aller de l'avant pour les cas de troubles mentaux.
Dans cette recommandation, on dit qu'il faut absolument que l'évaluateur compétent, qui est un psychiatre, soit « indépendant de l'équipe/prestataire traitant ».
Est-ce réaliste, compte tenu des ressources disponibles, notamment en région? Cela ne devrait-il pas être plus flexible? Si c'était plus flexible, cela diminuerait-il la légitimité ou la rigueur de l'exercice d'évaluation?
:
Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir demandé de vous faire un exposé aujourd'hui.
Je dois mentionner que j'ai pratiqué la médecine de famille dans le Nord de l'Ontario, avant de me qualifier comme psychiatre il y a près de 50 ans. En 2014, j'ai été nommée membre de l'Ordre du Canada. Je suis également membre du groupe de travail sur l'AMM pour la maladie mentale de l'Association des psychiatres du Canada, de la Canadian Association of MAID Assessors and Providers et du Centre for Bioethics de l'Université de Toronto. Comme cela a été mentionné, je suis une scientifique chevronnée à l'Institut de recherche de l'Hôpital général de Toronto où je fais des recherches, notamment sur l'AMM. J'ai évalué plus de 300 demandes de l'AMM. En février 2021, j'ai fait un exposé devant le comité sénatorial de l'AMM. Mes opinions à ce sujet sont éclairées par mes affiliations et mon expérience professionnelle, mais je vous parle aujourd'hui à titre personnel.
En tant que membre du groupe d'experts sur l'AMM et la maladie mentale, j'approuve les 19 recommandations, mais j'aimerais maintenant souligner quelques recommandations particulières en me basant sur mon expérience personnelle de la pratique professionnelle. Les recommandations dont je ne parlerai pas sont tout aussi importantes, mais le temps dont je dispose aujourd'hui est limité.
La première recommandation du groupe d'experts concerne la collaboration entre les autorités. Il est essentiel que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s'efforcent de faciliter la collaboration entre les organismes de réglementation des médecins et des infirmières en ce qui concerne l'élaboration de normes de pratique professionnelle pour l'AMM. Je crois comprendre que les gouvernements et les organismes de réglementation réalisent actuellement un travail considérable portant sur l'AMM pour la maladie mentale et que deux sections du programme d'études sur l'AMM et la CAMAP ont été rédigées, passées en revue, et elles font actuellement l'objet d'une révision. Je sais que d'autres organisations professionnelles offrent des cours sur l'AMM sous diverses formes. Comme cela a été souligné, l'échéance imminente de mars 2023 est une source de motivation très puissante.
En ce qui concerne la deuxième et la troisième recommandation, pour déterminer le caractère incurable et irréversible de la maladie, il est clair que les évaluateurs de l'AMM doivent tenir compte de la gravité et de la durée de la maladie, des tentatives de traitement, de leurs résultats et des autres traitements fondés sur des données probantes qui peuvent améliorer l'état du patient, tout en prenant en considération leurs avantages probables et le fardeau qu'ils imposent. Il s'agira de maladies qui durent depuis plusieurs années et qui ont fait l'objet d'un grand nombre de tentatives d'interventions multiples. Je suis fermement convaincue que, dans le cas d'un trouble mental, cette détermination doit être effectuée par le patient et un psychiatre, et non par le patient seulement. Cela est clairement indiqué dans les normes de pratique professionnelle des Pays-Bas, où l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux est disponible depuis près de 20 ans, et où, en 2020, 95 % des demandes d'aide médicale à mourir pour des troubles psychiatriques ont été rejetées. En fait, les cas clos liés uniquement à des troubles mentaux ne représentaient que 1,3 % de tous les décès découlant de l'aide médicale à mourir aux Pays-Bas.
L'un des exemples cliniques que je peux vous donner concerne un patient qui insistait pour que les médecins n'utilisent que des traitements à base de produits végétaux naturels. J'ai donc estimé que le cas ne répondait pas aux critères d'admissibilité à l'AMM.
En ce qui concerne la quatrième recommandation qui est liée à la souffrance, même si le caractère durable et intolérable de la souffrance est subjectif et déterminé par le patient, il est également important que l'évaluateur ou le prestataire de l'AMM partage l'avis du patient d'un point de vue réaliste. Par exemple, j'ai évalué une femme d'âge moyen qui souffrait d'une arthrose légère et qui affirmait que sa souffrance était intolérable parce qu'elle avait été élevée sous les tropiques et qu'elle avait presque toujours froid au Canada, ce qui aggravait sa souffrance. De toute évidence, j'ai estimé que ce cas ne répondait pas aux critères d'admissibilité à l'AMM.
La sixième et la septième recommandation portent sur les moyens de soulager la souffrance. Il est clair qu'il faut toujours envisager sérieusement d'avoir recours à plusieurs mesures de protection, notamment des services de soutien médical, psychologique et social. J'ai récemment évalué une patiente atteinte de cancer qui était aussi très déprimée. La prise d'antidépresseurs et une orientation vers des soins palliatifs l'ont amenée à retirer sa demande d'AMM.
En ce qui concerne la dixième, la onzième et la douzième recommandation qui portent sur une évaluation indépendante effectuée par un expert ou sur l'implication d'autres professionnels de la santé ou d'êtres chers dans les cas d'AMM TM‑SPMI, l'expert ou l'autre professionnel de la santé devrait être, selon moi, un psychiatre, qui ne fait pas partie de l'équipe soignante, afin d'éviter toute forme de partialité.
En ce qui concerne la seizième recommandation qui traite d'une surveillance éventuelle, je précise encore une fois qu'à mon avis, une telle surveillance est cruciale dans de nombreux cas de la voie 2, dans lesquels beaucoup de patients ont des troubles mentaux comorbides qui ont été mal soignés. Ce processus ne vise pas à porter des jugements sur l'admissibilité à l'AMM, mais plutôt à faire en sorte que les évaluations soient conformes aux normes juridiques et professionnelles. Le processus ne devrait pas entraîner de longs retards, et il devrait apporter une garantie supplémentaire en améliorant la qualité, la sécurité et la rapidité de la rétroaction sur la pratique professionnelle en vue de soutenir les patients et les praticiens.
La dix-neuvième recommandation concerne la recherche. En tant que scientifique chevronnée, je pense qu'il faudrait financer des recherches régulières et ciblées visant à lancer des enquêtes sur les questions relatives à l'AMM. Les recherches menées aux Pays-Bas ont permis de réviser les garanties relatives à l'aide médicale à mourir et ont joué un rôle très important.
Pour conclure, je tiens à souligner que les nombreuses heures de réunion du groupe d'experts, de ses sous-groupes et de ses membres ont donné lieu à des discussions approfondies sur toutes les recommandations et les questions connexes les plus importantes. Divers mécanismes de protection interreliés étaient à notre disposition, et ils sont maintenant à votre disposition à des fins d'examen. Ces mécanismes comprennent des garanties législatives, des normes professionnelles, des lignes directrices et de la formation, et chacun de ces mécanismes joue un rôle unique, interdépendant et essentiel.
Merci beaucoup. Je suis impatiente de répondre à vos questions.
:
Merci, madame la présidente.
Bonsoir à tous. Excusez mon retard; j'ai eu des petits problèmes techniques.
Dans un premier temps, je tiens à saluer les coprésidents, l'honorable Yonah Martin et l'honorable Marc Garneau, ainsi que l'ensemble des membres du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir. Je vous remercie d'avoir invité l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, ou l'AGIDD‑SMQ, à vous faire part de ses réflexions quant à la possibilité d'autoriser l'aide médicale à mourir en raison de problèmes de santé mentale.
D'emblée, je tiens à préciser que l'AGIDD‑SMQ n'utilise jamais les termes « maladie mentale » et « troubles mentaux ». Pour nous, ce sont des personnes vivant un problème de santé mentale. Ce sont donc les termes que je vais utiliser.
Notre association a été fondée en 1990, et sa mission est de lutter pour la reconnaissance et l'exercice des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Ce faisant, elle a acquis une expertise unique dans le domaine. L'AGIDD‑SMQ porte un regard critique sur les pratiques en santé mentale et s'implique dans le renouvellement de celles-ci. La prise de parole collective des personnes vivant un problème de santé mentale est au cœur de nos pratiques, je dirais même qu'elle fait partie de notre ADN.
À la suite du jugement dans l'affaire Truchon et Gladu, en septembre 2019, l'aide médicale à mourir pour raison de problèmes de santé mentale est devenue un sujet de réflexion, et encore plus lorsqu'en janvier 2020, la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec a annoncé qu'à partir du 12 mars 2020, l'aide médicale à mourir serait accessible pour des raisons de santé mentale. Cette annonce a créé toute une onde de choc. Bien sûr, la pandémie est venue mettre un frein brutal à toute démarche de réflexion et de consultation sur le sujet. Vous en savez quelque chose, car ce fut le même scénario au palier fédéral.
Ne s'avouant pas vaincue, à l'automne 2020, l'AGIDD‑SMQ a décidé de lancer une consultation auprès de ses groupes membres, qui sont formés en grande majorité de personnes vivant un problème de santé mentale. Pour l'Association, il était essentiel que les personnes visées par cette question soient les premières à donner leur opinion.
Nous n'avons pas pu, à ce jour, tenir une rencontre en présence de nos membres pour discuter entre quat'z'yeux de cette question, si délicate et pleine d'incertitudes et de questionnements pour plusieurs d'entre eux. Par contre, certains groupes membres ont pu faire une consultation auprès de leurs membres. C'est le fruit de leurs réflexions que nous avons réuni dans le mémoire « Entendre. Écouter. Prendre en compte la parole des personnes vivant un problème de santé mentale. Rien sur nous, sans nous. » Nous avons transmis ce mémoire aux députés du Québec qui formaient la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, au mois d'août 2021, et nous vous l'avons soumis également.
Trois constats sont ressortis de cette consultation. Premièrement, il y a une méconnaissance de ce qu'est la pratique de l'aide médicale à mourir. Ensuite, les gens demandent de l'aide pour vivre dans la dignité et ont besoin d'espoir. Enfin, les personnes qui vivent un problème de santé mentale doivent être consultées — elles veulent l'être — et impliquées en ce qui regarde l'aide médicale à mourir pour des raisons de santé mentale.
Notre association n'a pas de position officielle parce que, comme je viens de le dire, nous n'avons pas pu nous réunir pour en discuter. Par contre, depuis plus de 30 ans, l'AGIDD‑SMQ est aux premiers rangs pour dénoncer des situations abusives ou de discrimination envers les personnes. Depuis le jugement dans l'affaire Truchon et Gladu, nous avons pris la parole pour dénoncer les deux poids, deux mesures entre le sérieux qu'on accorde aux problèmes de santé physique et l'ignorance de la souffrance que vivent les personnes avec un problème de santé mentale.
Les préjugés et le paternalisme entourant les problèmes de santé mentale font en sorte qu'il est difficile de croire qu'une demande d'aide médicale à mourir peut être faite « consciemment » dans ces circonstances. Quand le diagnostic psychiatrique tombe, la personne concernée perd toute crédibilité. D'ailleurs, plusieurs personnes nous ont dit craindre, si elles faisaient une demande d'aide médicale à mourir, de se retrouver hospitalisées contre leur gré, car elles seraient alors jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui.
Qui est mieux placé que la personne qui vit avec des souffrances persistantes et intolérables pour juger du caractère soutenable ou insoutenable de ses souffrances? Décider de mourir dignement est légitime, et l'accepter relève du respect de la personne. Nous pensons que chaque individu devrait avoir le droit de faire ses choix au regard de sa propre vie, plus particulièrement lorsque ces choix touchent de près à la dignité humaine.
Ces cinq minutes sont bien courtes pour parler d'un sujet aussi complexe et important.
Cela me fera plaisir de prendre le temps nécessaire pour échanger sur ce sujet avec vous.
Je vous remercie.
:
Merci beaucoup, chers coprésidents.
Je vous remercie d'être venues nous donner des exposés cet après-midi.
J'aimerais vraiment me concentrer sur un thème qui est revenu tout au long de notre discussion concernant la question de la maladie mentale comme seul problème médical invoqué. D'après tout ce que j'ai entendu dire et les discussions de tous ceux qui nous ont parlé, j'ai retenu deux aspects très importants.
L'un d'entre eux, c'est que ces décisions doivent être prises au cas par cas. On ne peut pas établir des lois générales et des décisions générales pour les gens. En fait, l'ensemble de la décision rendue par la Cour suprême à ce sujet a clairement indiqué qu'il fallait procéder au cas par cas, car nous savons tous — et il se trouve que je suis médecin — que lorsque nous avons affaire à un patient atteint d'une maladie, même physique...
Examinons pendant un instant les maladies physiques. Cinquante personnes atteintes de la même maladie physique ne réagiront pas au traitement de la même manière. Nous devons comprendre la nature de la personne lorsque nous prenons ces décisions.
Le deuxième élément que j'ai retenu de tout cela, c'est qu'il semble y avoir un énorme degré de discrimination à l'encontre des personnes qui invoquent la maladie mentale comme seul problème médical. L'idée que les personnes atteintes de maladies mentales n'ont plus toute leur tête ou la capacité de prendre des décisions ou de déterminer ce qui constitue une souffrance intolérable pour elles, et le fait qu'en travaillant avec un médecin, elles seraient en mesure de prendre une décision raisonnable pour elles...
Nous ne cessons de parler de décisions générales et de la nécessité de prendre une décision générique à propos de tel ou tel sujet. J'aimerais connaître votre position concernant cette situation. Devrions-nous prendre des décisions générales, législatives ou autres, ou devrions-nous traiter la question au cas par cas? Devrions-nous tenter de ne pas faire de distinction entre la maladie mentale et la maladie physique?
J'aimerais que la Dre Stewart réponde à la question en premier. Ensuite, Mme Provencher pourrait peut-être y répondre.
:
Je vous remercie beaucoup, madame la coprésidente.
Je veux remercier nos deux témoins de contribuer à orienter notre comité dans le cadre de son étude.
Madame Provencher, j'aimerais commencer par vous.
Vous avez parlé du travail de défense des droits de la personne qu'accomplit votre organisation. Notre témoin précédente a traité de la Charte des droits et libertés et de la manière dont elle s'applique, parlant notamment de l'article 7, qui stipule que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et de l'article 15, qui indique que tout le monde est égal au regard de la loi.
Vous savez plus que quiconque au sein du Comité qu'il existe, dans notre société, énormément de préjugés à l'égard des personnes atteintes de maladie mentale, comme vous aimez le dire. Votre organisation ne prend position ni dans un sens ni dans l'autre. Peut-être pouvez-vous inscrire votre réponse dans le contexte des droits enchâssés dans la Charte, au cas par cas, en expliquant à quel point il importe de lutter contre ces préjugés et de comprendre que les personnes vivant avec la maladie mentale ont ce droit et cette capacité.
Y a‑t‑il autre chose que vous voudriez ajouter à cette conversation pour que non seulement le Comité, mais aussi la population canadienne qui écoute nos délibérations comprennent la question?
Je ne sais pas si je peux aller jusque-là. Comme vous le dites, dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés, il y a les articles que vous avez nommés et la question de la discrimination. C'est le jugement rendu dans l'affaire Truchon et Gladu qui viendrait vraiment appuyer principalement ces deux articles de la Charte.
Vous savez, ce n'est pas parce que j'ai un problème de santé mentale que je perds mon aptitude à consentir. Je suis apte à consentir jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, il faudrait, comme société, considérer les personnes vivant avec un problème de santé mentale comme des personnes aptes à prendre des décisions, même de graves décisions, comme celle de présenter une demande d'aide médicale à mourir. Or il faudra un travail de très longue haleine pour y arriver.
À l'Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, ou AGIDD-SMQ, nous pensons que la meilleure façon d'y arriver serait que les personnes vivant avec un problème de santé mentale soient présentes sur les tribunes et prennent la parole. Personnellement, je travaille depuis 30 ans avec des personnes qui vivent un problème de santé mentale, et je peux vous garantir qu'elles sont comme vous et moi. Ce sont des personnes qui vivent des émotions et des difficultés. Qui n’en a pas? Ce regard que l'on pose sur les personnes vivant un problème de santé mentale est à la base discriminatoire, parce qu'on les considère comme incapables de décider.
Comment changer ce regard sur les personnes ayant un problème de santé mentale?
Cela fait 30 ans que nous y travaillons. Le fait d'accorder à ces personnes une place dans le cadre d'une loi comme celle-là, de les situer sur le même plan que tous les citoyens et toutes les citoyennes du Canada ayant des droits serait déjà, à mon avis, un pas dans la bonne direction.
:
Merci, monsieur le président.
Je remercie également les témoins.
Ma question s'adresse à Mme Provencher.
Madame Provencher, j'ai lu avec grand intérêt le mémoire que vous avez déposé à l'Assemblée nationale du Québec, dans lequel vous présentez la position de votre groupe. J'ai devant moi les recommandations. L'une de vos conclusions était la suivante: ne pas exclure les personnes qui souffrent de maladie mentale de l'accès à l'aide médicale à mourir, car il s'agit de discrimination et de stigmatisation.
Dans votre mémoire, vous recommandez la mise en place de normes, de formations et de mesures sociales, en plus de bien définir les balises. D'ailleurs, à la page 40 de votre rapport, vous parlez des critères et des balises.
Estimez-vous, après avoir pris connaissance du rapport du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, que les balises proposées sont suffisantes?