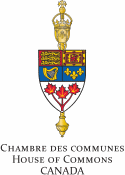Bienvenue à la 21e réunion du Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise, créé conformément à l'ordre de la Chambre du 2 mars 2022 et à celui du Sénat du 3 mars 2022.
La séance d'aujourd'hui se déroulera selon une formule hybride, conformément aux ordres de la Chambre et du Sénat.
Si des problèmes techniques surviennent, veuillez m'en informer, car il faudra peut-être alors suspendre la séance pendant quelques minutes afin de nous assurer que tous les membres sont en mesure de participer pleinement.
J'informe les témoins que des services d'interprétation sont disponibles et qu'ils n'ont qu'à cliquer sur l'icône du globe au bas de leur écran pour y avoir accès.
Je tiens à informer le Comité que la vérification technique du matériel utilisé par le professeur Roach a été effectuée. Les deux témoins aussi ont été informés de leur devoir de répondre aux questions.
J'aime toujours y aller d'un petit préambule à l'intention des témoins pour qu'ils sachent qu'il peut arriver, vu la nature du Comité, qu'un membre intervienne pour reprendre la parole. Je vous prie de ne pas vous offusquer si on vous interrompt; il ne s'agit aucunement d'un affront qu'on vous fait. Les membres ont une longue liste de questions et très peu de temps pour les poser. Veuillez croire, si un sénateur ou un député intervient, que ce n'est pas par manque de respect à votre endroit.
Dans notre premier groupe de témoins, nous accueillons ce soir, par vidéoconférence, Kent Roach, professeur à la faculté de droit de l'Université de Toronto, et, présente dans la salle, Leah West, professeure adjointe à la Norman Paterson School of International Affairs de l'Université Carleton.
Vous aurez chacun cinq minutes pour votre déclaration liminaire. Nous allons commencer par notre témoin qui est en ligne.
Monsieur Roach, vous avez la parole.
:
Merci beaucoup de m'avoir invité à contribuer aux importants travaux du comité mixte.
Bien que je sois membre du conseil de recherche de la Commission sur l'état d'urgence, je tiens à souligner que je ne parle qu'à titre personnel et que je ne suis pas au courant des délibérations internes qui ont lieu à la Commission en vue de la préparation de son rapport.
J'ai traité des événements qui ont mené à la déclaration de l'état d'urgence, d'abord dans mon ouvrage intitulé Canadian Policing: Why and How it Must Change, puis dans un article paru dans un numéro spécial du Criminal Law Quarterly, volume 70, numéro 2, où la professeure West a aussi publié un article.
Dans ces deux écrits, je soutiens que le recours aux pouvoirs d'urgence était lié à des défaillances des services de police et de la gouvernance. Ce point a son importance, même dans les cas où la Loi sur les mesures d'urgence est invoquée, puisque l'article 20 de cette loi préserve les cloisonnements existants et, je dirais, fragmentés et dysfonctionnels de gouvernance entre les services de police locaux, provinciaux et nationaux.
Permettez-moi de faire valoir trois points. Premièrement, si vous comparez les interventions policières à Ottawa et à Toronto, vous verrez que celles à Toronto ont été plus efficaces et qu'elles reflètent les leçons du rapport Morden, selon lequel il ne devrait pas y avoir de cloisonnement étanche entre les politiques et les opérations, cloisonnement qualifié plus d'une fois, et bien maladroitement, d'analogue à la « séparation entre l'Église et l'État » par la Commission sur l'état d'urgence,
Cette leçon aurait dû être apprise depuis longtemps, du moins depuis la Commission McDonald de 1981 qui, tout comme la Cour suprême dans son arrêt dans l'affaire Campbell et Shirose en 1999, affirme que l'autonomie de la police se limite à la capacité de chaque agent de police de prendre des décisions d'application de la loi au sujet des personnes qu'il arrêtera et sur lesquelles il enquêtera. Tout le reste, à mon avis, relève des autorités gouvernementales compétentes, des autorités démocratiquement responsables. Dans une démocratie, la police ne saurait être autonome.
Mon deuxième point concerne le projet de loi , actuellement devant le Parlement. C'est une bonne chose, en ce sens que ce texte prévoit que le ministre responsable pourra orienter les politiques de la GRC au moyen de directives publiques. Ce texte pourrait permettre de préciser la gouvernance de la police. Malheureusement, il continue de définir trop largement l'autonomie de la police en excluant les décisions opérationnelles de la GRC, y compris les opérations courantes, des directives ministérielles. Le terme « opérationnel » ne figure que dans les lois sur les services de police de l'Ontario et du Manitoba et il est, de fait, à l'origine de beaucoup de confusion et de ce genre de gouvernance lacunaire qui a fait que la Commission de services policiers d'Ottawa n'avait aucune politique publique concernant le contrôle de la manifestation avant l'arrivée du convoi sur la rue Wellington. Elle avait des politiques sur les manifestations syndicales et les manifestations autochtones, mais aucune politique publique applicable aux manifestations sur la rue Wellington.
Le dernier point que je ferai valoir, c'est que de telles politiques sont nécessaires. Nous devons y penser de façon créative, notamment pour ce qui est de la façon d'installer des barrières en respectant à la fois le droit de manifester pacifiquement et l'obligation d'assurer la sécurité des gens.
J'exhorte le Comité à faire preuve de créativité et à examiner les propositions de l'ancien sénateur Vernon White concernant la reconfiguration de la rue Wellington. Je vous exhorte également à envisager de donner à la GRC un rôle clair de direction des opérations policières dans la Cité parlementaire et aux postes frontaliers, mais seulement si ses politiques en matière de gouvernance et de ressources sont révisées.
Le projet de loi pourrait être un élément de cette réforme, mais seulement si sa définition trop large de l'autonomie opérationnelle de la police fait l'objet d'un amendement la limitant. L'autonomie de la police devrait également être définie de manière à ne pas nuire à la capacité des chefs de police de contrôler et de gérer leurs services. Encore une fois, cela peut se faire si nous la limitons au pouvoir discrétionnaire exercé dans l'application d la loi.
Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. J'ai des préoccupations particulières, dont je fais état dans mon article du Criminal Law Quarterly, au sujet de certains aspects des événements entourant le recours à la Loi sur les mesures d'urgence.
Merci beaucoup de votre attention.
:
Merci beaucoup, monsieur le président, de m'avoir invitée.
Dans le peu de temps dont je dispose aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur deux questions d'interprétation des lois qui, à mon avis, revêtent une extrême importance pour les travaux du Comité.
La première se rapporte à la Loi sur le SCRS et à la définition de l'« état d'urgence ». La deuxième, que, je l'avoue, je n'aurai peut-être pas le temps d'aborder, c'est le critère « sous le régime des lois du Canada » qui figure dans la définition de « crise nationale ».
Avant d'entrer dans les détails, je pense qu'il importe de préparer le terrain en rappelant le principe moderne de l'interprétation des lois et quelques règles de base.
Le précédent bien établi de la Cour suprême sur l'interprétation des lois vient de Rizzo…
:
Le premier point que je veux aborder se rapporte à la Loi sur le SCRS et à la définition de l'« état d'urgence » et le deuxième, que j'espère pouvoir aborder — sinon, ce sera pendant la période de questions — est le sens de l'expression « sous le régime des lois du Canada » et les critères de la définition de « crise nationale ».
Statuant sur la question dans l'affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. en 1998, la Cour suprême a établi le principe de l'interprétation des lois, ou le principe moderne que nous appliquons aujourd'hui, qui est vraiment devenu un mantra. Voici le passage pertinent:
Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'économie de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.
Quelques postulats sous-tendent l'interprétation des lois suivant ce principe. L'un d'eux est la présomption contre la tautologie, ce qui signifie qu'il faut donner un sens à chaque mot du texte de loi. Chaque élément est délibérément choisi pour remplir une fonction, et il n'y a pas de mots inutiles ou vides de sens. Le législateur ne se répète pas.
Une deuxième présomption est celle de la cohérence interne. Il est présumé que le législateur utilise les mots et les modes d'expression de façon cohérente. Lorsqu'il a adopté une façon particulière d'exprimer quelque chose, il évite les variantes et préfère exprimer le même sens de la même façon.
Bien sûr, tout cela repose sur la notion de la primauté du droit, qui signifie, en partie, que la loi, telle qu'elle est écrite, signifie nécessairement quelque chose de concret, d'explicable et de compréhensible pour ceux qui la lisent et qui y sont assujettis, ainsi que pour ceux qui sont chargés de l'interpréter de manière à empêcher ceux qui exercent un pouvoir conféré par la loi de le faire de façon arbitraire, abusive ou dommageable.
Cela m'amène à la définition de l'état d'urgence. L'article 16 définit l'état d'urgence comme suit: « Situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada d'une gravité telle qu'elle constitue une situation de crise nationale ». L'expression « menaces envers la sécurité du Canada » est ensuite définie pour les besoins de cette partie de la Loi sur les mesures d'urgence. En effet, l'article 16 précise que cette expression « s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité », la Loi sur le SCRS.
À la simple lecture de cette disposition, il est évident que la Loi sur les mesures d'urgence incorpore non seulement les termes de l'article 2 de la Loi sur le SCRS, mais également le sens qui leur est attribué dans cette loi. Comme nous le savons, comme je viens de le dire, chaque mot employé dans une disposition a un sens et son emploi est délibéré.
Cette compréhension est conforme à l'intention manifeste du législateur. Au cours des débats précédant son adoption, la Loi sur les mesures d'urgence a suscité beaucoup de préoccupations quant à la possibilité qu'elle soit invoquée pour déclarer l'état d'urgence afin de réprimer la dissidence publique. De plus, nous savons que, pendant la crise du FLQ, la Loi sur les mesures de guerre avait été invoquée pour réprimer un terrorisme ayant des motifs politiques. Il n'est donc pas étonnant que cette partie de la loi ait tant retenu l'attention.
En réponse à ces préoccupations, il a été dit clairement que seule une manifestation ou une violence répondant à la définition de « menace envers la sécurité du Canada » qui figure dans la Loi sur le SCRS et seules les menaces répondant également à la définition de « crise nationale » pouvaient justifier la déclaration de l'état d'urgence. C'est ce que le parrain du projet de loi, Perrin Beatty, a appelé un « double critère ». Il a également rappelé aux députés qui s'inquiétaient de la portée large et vague de la définition figurant dans la Loi sur le SCRS que cette définition avait fait l'objet d'un examen approfondi par le Parlement.
Nous savons donc, à la simple lecture du texte et à la lumière de l'intention manifeste du législateur, que la signification de « menace envers la sécurité du Canada » est celle de la Loi sur le SCRS et que la portée de cette définition — passablement large, à mon avis — est limitée par la définition de « crise nationale ».
Je tiens également à faire remarquer qu'il n'y a rien dans les autres éléments ou dispositions de la Loi sur les mesures d'urgence qui soit incompatible avec cette interprétation ou qui la remette en question.
De plus, l'incorporation par renvoi de l'article 2 de la Loi sur le SCRS n'est pas le propre de la Loi sur les mesures d'urgence. Il en va de même de la Loi sur les infractions en matière de sécurité, de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour chacune de ces lois, les critères d'interprétation des seuils critiques ne sont pas nécessairement prévus dans la Loi sur le SCRS. Par exemple, dans le cas de la Loi sur les infractions en matière de sécurité, c'est le procureur général qui décide dans quels cas il exercera des pouvoirs appartenant normalement aux provinces.
Enfin, je tiens à répéter qu'il faut obligatoirement que la crise nationale résulte d'une menace définie à l'article 2. Il s'agit d'une exigence causale, ce qui signifie que, pour constituer une crise nationale, la situation doit résulter d'un concours de circonstances critiques à caractère d'urgence et de nature temporaire, échappant à la capacité d'intervention des provinces, et qu'elle doit découler de menaces de violence graves ayant des motifs politiques, en d'autres mots que les préjudices financiers ou les atteintes à la réputation et toutes sortes d'autres torts, comme ceux que nous avons certainement pu constater dans le sillage de la crise à Ottawa et dans l'ensemble du pays, doivent avoir pour cause des menaces graves de violence, au sens de la Loi sur le SCRS.
Je sais que mon temps est écoulé. Avec un peu de chance, je pourrai, au cours de la période de questions, expliquer ce qu'il faut entendre de l'expression « sous le régime des lois du Canada ».
Merci de votre attention.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je vous remercie, madame West, monsieur Roach, de votre comparution.
Comme vous n'avez pas eu le temps de terminer votre déclaration liminaire, auriez-vous l'obligeance d'en remettre le texte au Comité à la fin de la journée pour que nous puissions en prendre connaissance. Je vous remercie à l'avance.
Madame West, vous avez affirmé publiquement qu'une crise nationale est un état d'urgence qui ne peut pas résulter uniquement de l'incompétence d'une municipalité ou d'une province. Elle doit résulter d'une menace à la sécurité du Canada, ce qui signifie habituellement le terrorisme ou l'extrémisme violent, pour atteindre le seuil critique permettant d'invoquer la Loi.
Avez-vous vu des documents ou obtenu d'autres renseignements depuis que la Loi a été invoquée indiquant que ce seuil a été atteint?
Je remercie les deux témoins de leurs témoignages. Mes questions s'adressent à M. Roach.
Tout d'abord, je suis heureux de vous voir, monsieur Roach. Drôle de coïncidence, nous avons deux anciens de la Faculté de droit de l'Université de Toronto qui siègent ici, au moins deux.
J'ai trois questions pour vous.
Vous avez mentionné certains sujets sur lesquels vous avez écrit. J'ai lu quelques-uns de vos écrits. Je vais citer certains passages d'un article intitulé « The Dilemma of Mild Emergencies that are Accepted as Consistent with Human Rights », paru dans une revue allemande. Vous en avez dit quelque chose dans votre déclaration liminaire. Je veux vous y ramener.
Vous y traitez de domaines susceptibles d'amélioration et de la responsabilité plurigouvernementale pour les services de police, en particulier dans une fédération comme le Canada. Voici ce que vous avez écrit:
L'une des limites des enquêtes ouvertes [...] en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence, c'est qu'elles ne portent que sur l'action du gouvernement fédéral, alors que les causes de l'occupation d'Ottawa et du blocus de Windsor tiennent à des défaillances des services de police locaux, notamment au chapitre de la planification de leur intervention au cours de manifestations. Rien n'oblige l'Ontario, qui a la compétence ultime sur la police locale d'Ottawa et de Windsor, à demander une enquête semblable. C'est une omission, étant donné que l'état d'urgence est défini comme une situation dépassant la capacité d'intervention de la province.
Je sais que vous connaissez très bien l'enquête menée par le juge Rouleau, dans laquelle nous avons pu voir un vain effort pour obtenir la comparution du premier ministre de l'Ontario qui, ne voulant pas comparaître et ayant contesté la convocation devant les tribunaux, a eu gain de cause.
Pouvez-vous nous dire ce que, de votre point de vue, nous devrions faire en tant que comité pour tenter de corriger cette situation, compte tenu des paramètres constitutionnels ou du partage des pouvoirs dans notre régime politique? Comment entrevoyez-vous des enquêtes futures auxquelles les trois ordres de gouvernement devront nécessairement participer si un état d'urgence comme celui que nous avons connu récemment devait survenir?
Je vous cède la parole, monsieur Roach.
Vous avez tout à fait raison de dire que le premier ministre et le solliciteur général n'ont pas témoigné, ayant fait valoir avec succès le privilège parlementaire. À l'évidence, cela posera un problème dans l'avenir. Cependant, j'ai été surpris du niveau de participation provinciale et municipale à la Commission Rouleau.
Il me semble que la seule façon pour le gouvernement fédéral d'exercer un certain contrôle sur la situation serait d'assumer lui-même, et le faire exercer par la police fédérale, le premier rôle dans ces domaines, qu'il s'agisse de la Cité parlementaire ou des zones frontalières. Je pense que c'est vraiment la seule façon dont le Parlement fédéral peut composer avec cette situation de nature intergouvernementale.
La professeure West a mentionné la Loi sur les infractions en matière de sécurité, qui n'est pas assez connue, mais qui constitue effectivement un précédent pour la prépondérance de la responsabilité fédérale sur les compétences provinciales en matière de sécurité nationale. C'est peut-être une formule à explorer pour assurer une complète reddition de comptes en cas de crises qui, à l'avenir, pourraient toucher ces mêmes domaines d'intérêt fédéral.
:
Permettez-moi d'explorer la question avec vous. Il me reste environ une minute et demie, je crois.
Dans votre article, vous parlez aussi d'échecs sur le plan du renseignement et du maintien de l'ordre et vous faites le lien entre les deux. Il y est question de la sous-estimation de l'extrémisme de droite au détriment de... et de la surestimation de mouvements comme Al‑Qaïda et Daech par exemple, et des échecs policiers qui peuvent en résulter, car en bout de ligne c'est toujours du travail policier qu'il s'agit.
Que recommandez-vous relativement aux défaillances des services de police? Je remarque que vous parlez également dans votre article de la façon dont les manifestants autochtones ou racisés sont parfois traités, en comparaison avec les camionneurs qui ont occupé Ottawa pendant trois semaines, et un peu aussi de certains des préjugés qui pourraient jouer. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet?
:
Oui, la gestion opérationnelle de la PPO a en fait suscité beaucoup d'éloges. Je ne vais pas me joindre à ce concert. Ce qui me préoccupe, c'est que les opérations de renseignement ont d'abord ciblé les occupations autochtones. De plus, certains des produits que nous avons vus utilisent des expressions comme « le mouvement patriote », qui ne me semblent pas vraiment menaçants au point de les réprimer.
Bien que la GRC et le SCRS soient soumis à un examen assez rigoureux par l'OSSNR, ce n'est pas le cas de la PPO et des services policiers municipaux qui, pour leurs activités de renseignement, ne font l'objet que d'un contrôle très limité, et seulement par le directeur indépendant de la surveillance des services policiers de l'Ontario, dans la mesure où il a suffisamment de ressources pour effectuer des examens systémiques. Je crois comprendre que ce n'est pas le cas.
Encore une fois, c'est peut-être une autre raison pour que les organismes fédéraux exercent le principal rôle de direction, puisque nous ne pouvons pas assurer un niveau approprié de reddition de comptes au niveau provincial.
:
Merci, monsieur le président.
Madame West, je vous salue et je vous remercie d'être ici aujourd'hui.
J'ai entendu les réponses que vous avez données aux questions de mon collègue M. Motz quant à la justification de la déclaration des mesures d'urgence. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas en mesure de déterminer si c'était justifiable ou non, compte tenu du fait que vous n'aviez pas toute la preuve en main.
Madame West, des gens ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une situation d'urgence justifiant la proclamation en fonction d'un avis juridique qui aurait été émis. Est-ce qu'il vous apparaît essentiel de lire l'avis juridique? Est-ce que la seule connaissance que vous avez des événements est suffisante pour déterminer s'il s'agissait d'une menace à la sécurité du Canada ou pas?
:
Voilà une question fort intéressante.
Je pense que la définition, dans sa forme actuelle, est déjà assez large. Je crois qu'elle reflète les préoccupations exprimées par des députés de l'opposition, l'Association canadienne des libertés civiles et de l'Association du Barreau canadien à l'époque de l'étude du projet de loi.
La définition de « menaces envers la sécurité du Canada » est intentionnellement large et quelque peu vague, parce que le SCRS est un organisme qui doit être en mesure d'interpréter les menaces possibles, des choses qui ne se sont pas encore tout à fait concrétisées et qui sont difficiles à discerner. Le fait d'avoir des limites très nettes quant à ce qui peut faire ou non l'objet d'une enquête, comme dans le cas d'une enquête criminelle, est une situation qu'on évite de créer en utilisant une formulation plus large et plus vague, comme le fait la Loi sur le SCRS. Elle n'est pas vague au point de ne rien dire, mais elle est néanmoins passablement vague.
Quant à savoir si on peut l'interpréter de façon large... J'ai du mal à accepter qu'on élargisse la définition, surtout lorsqu'il s'agit de l'alinéa c) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » à l'article 2. Il est question ici de terrorisme et d'extrémisme violent. Il est déjà assez difficile d'en déterminer le contour, de comprendre ce qu'est ou n'est pas l'extrémisme violent, par exemple. Dire que nous pourrions, selon notre compréhension actuelle de la disposition, l'interpréter dans un sens plus large, équivaudrait à dire, à ce que je vois, qu'il n'y a pas vraiment de limite. Je pense qu'il faut s'en tenir au texte.
Ce qui est discrétionnaire, c'est de soupeser les facteurs pour déterminer si la définition s'applique ou non. Ce n'est pas de soupeser les mots eux-mêmes pour décider de leur sens.
:
Je vous dirais que le Parlement a un tel pouvoir, que le secret du Cabinet n'est qu'une convention et que nous sommes, à tout prendre, les grands inquisiteurs de l'État.
Ce que je veux faire valoir concerne davantage l'avis juridique. C'est un défi, même pour le Comité, qui a des privilèges parlementaires. Il s'agit pour nous de connaître le raisonnement juridique justifiant la décision qui a été prise afin que notre propre processus puisse suivre son cours et mener à une analyse valable.
Je vous pose la question, mais en vous priant d'y répondre brièvement.
Madame West, auriez-vous avantage à ce que les avis juridiques internes du gouvernement soient rendus publics pour examen par des spécialistes du domaine, comme vous, et par le public?
:
Oui, l'expression « sous le régime des lois du Canada » s'entend de toute autre loi fédérale. Elle ne signifie pas littéralement toutes les autres lois du Canada. Ainsi en a décidé la Cour suprême dans l'arrêt Roberts, en 1989. Cette affaire portait sur l'interprétation de l'article 101 de la Constitution. L'expression comprend les lois fédérales ou la common law fédérale.
Ordinairement, dans les lois fédérales, on précise « lois du Canada » ou « lois d'une province », ou encore, pour indiquer une application plus large, « toute autre loi ». L'interprétation de « sous le régime des lois du Canada » est plus logique si vous regardez également les alinéas 3a) et 3b) de la définition. L'alinéa 3a) deviendrait redondant, puisqu'il dit déjà que la situation doit échapper à la capacité ou aux pouvoirs d'intervention des provinces. L'alinéa 3b) n'a rien à voir avec la compétence provinciale.
D'un point de vue réaliste, une fois que l'exécutif a décidé que les critères énoncés aux alinéas 3a) et 3b) sont respectés, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est déterminer s'il y a ou non d'autres lois fédérales qui s'appliquent avant d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence.
:
Je comprends. Merci beaucoup. Cela m'aide beaucoup à analyser tout cela.
Sénatrice Boniface, vous avez cinq minutes. Oh, vous me chronométrez aussi.
Soit dit en passant, ce comité a d'excellents coprésidents.
Merci beaucoup et merci de m'avoir accordé un peu plus de temps. J'ai remarqué cela.
Sénatrice Boniface, vous avez cinq minutes. J'ai repris le fauteuil, et vous avez la parole.
:
Je vous remercie de votre question.
[Traduction]
N'importe qui peut dire que des actes sont conformes à la Charte. J'ai très souvent écrit que la Charte ne fixe que des normes minimales. À mon avis, de nombreux aspects du décret d'urgence — pas seulement les aspects financiers — pourraient être contestés en vertu de la Charte. L'autorisation de saisir ou de geler des biens sans aucune application régulière de la loi est plutôt faible. La deuxième partie du Règlement mentionne le concept de « violation de la paix », mais on n'en parle pas comme d'une infraction, c'est très vague. Je ne soutiendrais donc pas la légitimité des mesures prises face aux aspects financiers et à la protestation en me basant sur la Charte.
De même, la définition de l'entrave au commerce est extrêmement vague. Je pense qu'il est important que nous appliquions les normes de la Charte. Toutefois, personne ne le fera devant un tribunal, et le simple fait que le gouvernement affirme qu'une chose est conforme à la Charte ne signifie pas qu'elle le soit vraiment.
:
En effet. Techniquement, il est vrai que la Charte ne lie que l'État. Toutefois, certaines décisions rendues en vertu de l'article 8 de la Charte, comme le fait que l'infirmière et non le policier ait obtenu un prélèvement de sang, n'immunisent personne contre l'application de la Charte.
D'un autre côté, dans le domaine des sanctions financières, le recours à des institutions financières sous la direction de l'État pourrait fort bien, à mon avis, faire l'objet d'un examen en vertu de la Charte. Je pense que les tribunaux seront sensibles au fait qu'en soutenant le contraire, ils créeraient un écart de responsabilité assez important, parce qu'en matière de sanctions financières ou de surveillance, l'État dirige maintenant le secteur privé.
Je pense que nos tribunaux en sont conscients et qu'ils interprètent la Charte de façon très générale. Ils ne veulent pas offrir au gouvernement une occasion de dire, essentiellement: « Cet individu n'est pas assujetti à la Charte, alors à vous de faire le sale boulot! »
:
Je vous remercie, sénateur Harder, pour cette question.
Je pense que le Service canadien du renseignement de sécurité, ou SCRS, a mis beaucoup de temps avant de reconnaître que l'extrémisme violent, surtout celui de l'extrême droite, tue beaucoup plus de gens que le terrorisme inspiré par Al‑Qaïda ou Daech. De nouveau, en évaluant la décision du SCRS selon laquelle la sécurité du Canada n'était pas menacée, il faut reconnaître qu'elle est arrivée assez tard. Je ne dis pas que les agents du SCRS avaient raison ou tort, mais je pense que cette observation est pertinente.
Depuis lors, il y a eu... Encore une fois, dans l'opération Hendon, on perçoit, dans les références au « mouvement patriotique », l'idée que l'extrême droite du Canada est très semblable à celle des États-Unis. On y décèle certainement des dimensions transnationales que nous avons malheureusement aussi constatées en Nouvelle-Zélande, à Buffalo et ailleurs. Toutefois, je crois que nous devrions approfondir considérablement notre compréhension de l'extrémisme idéologique.
Je m'attendrais à ce que cela vienne du SCRS plutôt que de la police. D'après les leçons tirées de la Commission McDonald, les policiers ne reçoivent pas la formation politique nécessaire pour faire du renseignement, et surtout pour déterminer quand l'extrémisme, qui ne devrait pas nous préoccuper énormément, se transforme en extrémisme violent. Je ne m'attends pas à ce que la police soit bien placée pour déterminer cela. Je préférerais que le SCRS prenne cette décision sous la direction du ministre et sous la surveillance de ceux qui l'entourent.
Avons-nous besoin d'autres outils juridiques? Cela reste à voir. Je ne pense pas... Je conviens avec Mme West que dans le milieu de la sécurité au gouvernement fédéral, beaucoup de gens désirent étendre l'article 2 de la Loi sur le SCRS. Mais il fallait le faire avant et non en interprétant les faits. Mme West a raison, c'est une chose assez fondamentale dans un État de droit, mais je ne pense pas que nous puissions le faire à la hâte. C'est une chose extrêmement grave, surtout compte tenu des nouveaux pouvoirs que nous avons conférés au SCRS pour réduire la menace. Peut-être devrions-nous revenir en arrière et vraiment repenser la répartition des agents du SCRS et de la police.
Nous savons également, grâce au rapport institutionnel que la GRC a présenté à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, qu'elle comporte quatre sections sur le renseignement, dont une se penche sur l'extrémisme idéologique. La Commission ne pourra pas suivre tout cela, d'autant plus qu'elle doit aussi s'occuper de l'Agence des services frontaliers du Canada. J'espère que l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement se penchent sérieusement sur la question du point de vue des droits, afin qu'ils ne considèrent pas l'extrémisme comme un mouvement à faire surveiller par les services de renseignement, mais aussi du point de vue de l'efficacité, pour que nous le fassions avec les ressources et les compétences qui conviennent.
Veuillez excuser la longueur de cette réponse.
:
Merci, monsieur le président.
J'aimerais remercier les deux professeurs d'être venus aujourd'hui.
Madame West, lorsqu'il a formé le gouvernement, le a promis aux Canadiens qu'il dirigerait un gouvernement ouvert et transparent. Il a accepté de collaborer pleinement avec le juge Rouleau lorsqu'on lui a demandé de témoigner, mais son Cabinet et lui se sont cachés derrière le principe du secret professionnel en ne divulguant pas les conseils juridiques qu'ils avaient reçus.
Les Canadiens n'acceptent pas de se faire répondre « faites-nous confiance ». Sans avoir été au courant de cette réponse, vous avez émis l'opinion suivante dans un article juridique — dont vous êtes coauteure avec Michael Nesbitt et Jake Norris — publié dans le Criminal Law Quarterly:
pour justifier adéquatement la déclaration d'une urgence d'ordre public, le gouvernement devait fonder son invocation sur trois façons inédites, non conventionnelles et auparavant imprévues d'interpréter ce palier juridique
Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? Ma deuxième question porte sur la façon dont cet article a été rédigé avant que l'on ait entendu tous les témoignages. Cette opinion tient-elle toujours? Sinon, en quoi a‑t‑elle changé?
Vous avez été interviewée à plusieurs reprises à l'émission Power & Politics de la CBC pendant la Commission Rouleau, et l'on vous a demandé, à vous et à un autre professeur, ce que nous avons appris du témoignage du .
J'ai également regardé votre fil Twitter, et dans un gazouillis à peu près au même moment — c'était probablement le jour ou le lendemain du témoignage du —, vous avez dit que M. Trudeau, le premier ministre, présentait un argument convaincant pour qui n'est pas avocat. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet?
Tout au long du processus — j'essayais de comprendre les faits pour les appliquer à la loi —, j'ai entendu des faits appliqués à différents éléments des définitions, mais jamais nécessairement dans le bon ordre. On ne franchissait pas le premier obstacle avant de passer au suivant. Tous les faits étaient appliqués comme si la loi n'était pas structurée. On se retrouve alors avec des faits reliés à un élément de la définition, puis avec des faits reliés à un autre élément. Cependant, on ne les présente pas vraiment en cherchant à atteindre un premier palier, puis le suivant et ainsi de suite.
Alors je crois que les gens qui lisent simplement la loi sans vraiment chercher à l'interpréter se disent que tous les faits présentés correspondent à des éléments de la loi, donc que tout est logique. Toutefois, la loi n'est pas structurée de cette façon. Il y a une série de paliers à respecter, et chaque mot compte. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé son argument convaincant, mais pas si vous l'examinez du point de vue de quelqu'un qui s'intéresse à l'interprétation de la loi.
:
Merci, monsieur le président.
Je vais poursuivre dans la même veine, madame West.
Plus tôt dans votre témoignage, vous avez dit que vous n'aviez évidemment pas tous les faits puisque vous n'avez pas accès à certains renseignements des services de sécurité et de renseignement, entre autres choses. Vous venez de dire que vous appliquez les faits à la loi, mais vous conviendrez que vous n'avez pas tous les faits.
Mme Leah West: C'est vrai.
Mme Rachel Bendayan: J'ai également consulté votre compte Twitter. Il semble que nous ayons consulté le même article que vous, celui du 30 novembre, de la semaine dernière. Radio-Canada/CBC y donnait plus de détails sur le complot de meurtre à Coutts, en Alberta. La GRC y avait saisi des bombes-tuyaux et plus de 36 000 cartouches.
Dans ce reportage, il a été question de mandats de perquisition non scellés comprenant des messages textes entre les personnes accusées et « les patrons », qui disaient aux hommes accusés que l'objectif réel des manifestations était de modifier les systèmes politique, judiciaire et médical du Canada.
Vous avez publié un gazouillis au sujet de ce reportage. Vous y avez écrit que vous étiez curieuse de savoir pourquoi ces hommes n'avaient pas été accusés d'infraction de terrorisme. Pourriez-vous nous donner une idée de ce à quoi vous faisiez allusion et, en particulier, du danger que pose l'extrémisme violent à caractère idéologique?
Je vais maintenant m'adresser à M. Roach.
Vous avez publié deux articles à ce sujet — parmi de nombreux autres, j'en suis sûre —, professeur. J'aimerais me reporter à votre article du 12 mai, dans lequel vous soulignez qu'il faudrait vérifier si le SCRS avait omis de recueillir ou de fournir des renseignements indiquant qu'il existait des liens entre les manifestations et l'extrémisme violent d'extrême droite. Vous ajoutez que les services de renseignement du Canada ont tardé à considérer le terrorisme d'extrême droite comme une menace à la sécurité. Je me demande si, à partir de cet article et de cette affirmation, vous pourriez nous recommander une façon de faire. Vous pourriez peut-être fournir votre réponse par écrit, parce que mon temps est très limité.
Je vous renvoie également à votre article du 14 février 2022, publié au plus fort de l'occupation. Vous y soulignez que la GRC, dans son rôle de police fédérale, n'avait compétence que sur les biens fédéraux, ajoutant que la police locale qui était responsable de la sécurité de la rue publique qui passe devant l'édifice du Parlement et de la route principale de Windsor qui mène au pont Ambassador. Vous suggérez fortement que l'on réexamine ces ententes.
Pour éclairer les recommandations que notre comité devra présenter, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de ces affirmations ainsi que de celle — si je comprends bien votre témoignage d’aujourd’hui — qui semble indiquer que tout cela suggère un échec des services policiers?
Je ne sais pas si vous voudriez ajouter quelque chose pendant le peu de temps qu'il me reste. De nouveau, si vous pouviez fournir vos réflexions par écrit au Comité, nous vous en serions très reconnaissants.
:
Merci, monsieur le président.
Madame West, je vais continuer où j'en étais sur la question de l'interprétation.
Je ne veux pas critiquer ou appuyer l'opinion juridique que certains interlocuteurs ont vue, puisque nous ne l'avons pas vue. En fait, elle n'existe pas pour nous. Compte tenu de votre présence et de celle du professeur Roach, j'aimerais vérifier un principe d'interprétation.
Dans ma compréhension des choses, lorsqu'un texte législatif est attributif de droits, on va lui donner une interprétation plus libérale et plus large, et, lorsqu'un texte législatif est plutôt privatif de droits, on va lui donner une interprétation plus restrictive et plus restreinte.
Ai-je raison de penser cela, madame West, ou suis-je dans l'erreur?
Vous m'avez peut-être entendu parler, au cours de cette réunion et d'autres études, de l'échec pratique des services de police. Cela ne fait pas partie de notre mandat, mais il n'y a pas eu de commission royale sur les services de police depuis 1962.
Monsieur Roach, je sais que vous avez publié des articles sur l'inégalité des services de police. Je pense que l'on peut dire qu'en regardant la situation de l'extérieur, il semble que l'on a appliqué deux poids, deux mesures à ce groupe de policiers. Pensez-vous comme moi que nous devrions mettre sur pied une commission royale d'enquête sur les services de police afin d'analyser les responsabilités de la police?
:
Merci, monsieur le président.
Ma question s'adresse à la professeure West et elle porte sur le caractère territorial et la différence entre une situation d'urgence localisée et une situation d'urgence qui touche le Canada en entier.
Je lisais des discours de Perrin Beatty et, le 16 novembre 1987, il a dit ceci: « L'état d'urgence doit menacer le Canada tout entier ou être d'une telle ampleur qu'il dépasse la capacité des pouvoirs d'intervention des provinces ».
Selon ces propos, une crise localisée ou une situation localisée ne respecterait pas la définition d'une crise nationale qui mène à la déclaration sur les mesures d'urgence.
Pouvez-vous préciser votre pensée à ce sujet?
:
Eh bien, oui, dans une certaine mesure. Nous savons aussi, cependant, qu'Ottawa savait ce qui s'en venait, que ce soit par l'opération Hendon ou par les rapports du CIET.
Par conséquent, je ne pense pas qu'on puisse dire simplement « aurait bénéficié ». Je pense que Toronto a bénéficié des critiques qu'elle a reçues pour ce qu'elle a fait au G20 et qu'elle a su faire le ménage dans sa cour. Elle avait une commission des services policiers et un service de police qui travaillaient ensemble de façon fonctionnelle. Elle avait un maire qui prenait la peine de siéger à la commission des services policiers et qui n'allait pas s'amuser à négocier avec des manifestants.
Je pense que l'expérience de Toronto peut nous apprendre beaucoup de choses. J'ai formulé des critiques au sujet de la police — vous le savez, sénatrice Boniface —, mais je crois aussi qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a deux endroits où regarder pour voir ce qui s'est bien passé: d'abord, l'enceinte du Parlement, qui n'a pas été franchie — comme en 2014, par exemple — et ensuite Toronto. Je pense que ce sont deux réussites importantes.
Votre comité devrait faire la part des choses et tirer des leçons autant des échecs que de ce qui a bien fonctionné.
Voilà qui met fin au deuxième tour. Nous sommes capables d'en faire un troisième.
Une voix: Est‑ce que le sénateur [inaudible]?
Le coprésident (M. Matthew Green): Non, c'était pour le sénateur Carignan. Il y avait deux sénateurs dans ce tour.
Nous envisageons un troisième tour complet, à raison de cinq minutes pour chacun, et je veux que le Comité en décide. Je crois savoir que certaines personnes souhaitent partager leur temps de parole. Je demande donc l'avis du Comité sur l'idée d'un tour à cinq minutes chacun. Comme le sénateur Patterson n'est pas ici, nous avons ce temps‑là en réserve.
Je sais que les témoins sont avec nous depuis un certain temps, en personne ou en ligne, alors j'aimerais que le Comité me dise s'il y aurait lieu de faire une pause de cinq minutes. Voulez-vous continuer jusqu'à la fin?
:
Nous pourrions prendre moins de temps, si vous voulez en récupérer une partie. Nous pourrions accorder quatre minutes au lieu de cinq. C'est à vous de voir.
Vous voulez quatre minutes. C'est parfait. Je vous remercie de votre collaboration.
Nous allons nous en tenir à quatre minutes chacun et nous allons reconnaître les temps de parole partagés. Les partis qui veulent partager leur temps, voulez-vous une interruption ferme à deux minutes? Voulez-vous que j'intervienne, ou que je laisse cela à votre discrétion?
Je laisse cela à votre discrétion.
D'accord, merci de nous permettre de régler cette question d'ordre administratif.
Allons‑y maintenant pour le troisième tour de questions, à raison de quatre minutes chacun, en commençant par M. Motz.
Monsieur Motz, vous disposez de quatre minutes.
:
Merci. Je vais partager mon temps avec M. Brock.
Madame West, vous avez déclaré: « Nous ne qualifions pas de terroristes des mouvements entiers de protestation parce que certains parmi les manifestants cherchent à s'en servir pour éventuellement créer de la violence. » Vous avez déclaré aussi: « Nous n'avons jamais accolé l'étiquette de terrorisme aux barrages routiers et autres moyens non violents, mais illégaux, d'obstruer une infrastructure essentielle. Ces gestes‑là ne sont pas visés par l'alinéa 2c) de la Loi sur le SCRS, peu importe l'interprétation qu'on en fait, si large soit-elle. »
Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet, s'il vous plaît, pour la minute et demie qui suit?
Un de vos collègues de la faculté de droit de l'Université Queen's, un professeur du nom de Bruce Pardy, a écrit un article paru aujourd'hui dans le Toronto Sun. Le titre dit qu'il était nettement exagéré d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence, après quoi M. Pardy donne des exemples pour expliquer son opinion. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, l'un ou l'autre, de lire cet article, même si ce n'est pas vraiment utile pour répondre à ma question.
Ma question s'adresse aux deux témoins, mais je commence par vous, madame West. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Sinon, expliquez-nous pourquoi.
:
Oui. C'est un point sur lequel j'ai peut-être changé d'avis en raison de certains témoignages entendus depuis le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, où j'aurais dû faire autre chose que d'écrire un texte.
Quoi qu'il en soit, je pense que les meilleures leçons à retenir des événements d'Ipperwash et du G20 sont que la police devrait avoir un plan pour parler aux manifestants, pour leur donner l'occasion de s'autodiscipliner, tout en sachant que s'ils ne le font pas et qu'ils n'obéissent pas à la loi, alors la police devra intervenir. Je pense que la police doit aussi préserver sa neutralité. Les différents corps policiers qui prennent maintenant des mesures disciplinaires à l'endroit des agents qui ont exprimé leurs opinions politiques au sujet de la manifestation, je pense que cela démontre un souci de préserver la neutralité.
Si nous avions un plan avancé qui disait à tout le monde que nous allons parler aux manifestants jusqu'à un point x, et si nous avions aussi des directives politiques claires à l'intention de la police, cela réglerait une partie des préoccupations au sujet de l'inégalité.
:
Merci, monsieur le président.
Madame West, on sait que la Loi sur les mesures d'urgence est une loi d'exception. Je l'ai souvent qualifiée d'artillerie lourde de l'arsenal juridique du gouvernement parce qu'elle existe depuis déjà une trentaine d'années et n'a jamais été proclamée. L'ancêtre de la Loi sur les mesures d'urgence est la Loi sur les mesures de guerre, qui, elle, a été proclamée pour la dernière fois en octobre 1970 au Québec dans les circonstances qu'on connaît. C'est donc une loi qu'on n'utilise pas souvent et qu'on va uniquement proclamer dans des cas extrêmes, des cas d'exception.
Dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire la situation qui s'est produite en février dernier, les événements qui sont survenus n'avaient à mon avis pas lieu d'être. On s'entend sur le fait que cela n'avait pas de sens de bloquer la rue Wellington à Ottawa. Le siège devait être levé, j'en conviens. Toutefois, la situation était quand même localisée à Ottawa. Il y a aussi eu des événements localisés au pont Ambassador, à Coutts, et ainsi de suite. Il s'agissait vraiment de situations locales. On a proclamé la Loi sur les mesures d'urgence pour répondre à des manifestations, des situations qui sont tout à fait gérables en temps normal et qui surviennent si rarement dans ces endroits précis. À mon avis, ce n'était pas justifié. Je peux me tromper. C'est mon opinion.
Ma question est la suivante. À votre avis, quand on proclame la Loi sur les mesures d'urgence dans des situations qui ne le justifient pas, quelles en sont les conséquences?
On s'entend sur le fait que c'est extrême. On n'avait pas proclamé la Loi sur les mesures d'urgence depuis 30 ans. La dernière fois qu'on a vu cela, c'était en octobre 1970 alors que c'était encore la Loi sur les mesures de guerre. Quel est l'effet de cette proclamation si elle est non justifiée, comme je le propose?
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Ma question s'adresse aux deux témoins, si vous voulez intervenir. J'essaie de formuler une recommandation qui traite, peut-être, de la participation obligatoire des provinces, ou quelque chose qui dit qu'elles ne peuvent pas se tenir en retrait, éviter de répondre ou d'assister aux réunions lorsqu'on essaie de trouver une solution ensemble.
Y a‑t‑il moyen, en modifiant la Loi ou en la récrivant, comme je pense qu'elle devrait l'être, d'en faire une obligation?
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Encore une fois, merci aux témoins, surtout d'être restés plus longtemps que prévu.
Monsieur Roach, j'aimerais revenir sur la question dont vous avez parlé à plusieurs reprises ce soir, à savoir la fragmentation de la police au Canada, que nous avons pu constater lors des événements de février dernier. Vous avez parlé de Toronto à quelques reprises, et la sénatrice Boniface essayait d'intervenir à ce sujet aussi.
Je ne dis pas que Toronto a profité de l'expérience d'Ottawa seulement, mais c'était séquentiel. Je comprends ce que vous dites au sujet du maire, des attitudes différentes des maires et des services de police municipaux. Il y avait certainement une différence aussi dans la participation de la Police provinciale de l'Ontario: elle était intégrée dans la stratégie adoptée à Toronto tandis qu'elle était réticente à s'en mêler à Ottawa. Êtes-vous d'accord avec cette analyse?
:
J'ai posé la question au sénateur Harder, puisqu'il s'agit de sa motion. Personnellement, je crois qu'il s'agit de sujets différents.
La motion suggère que le Comité n'invite aucun autre témoin, et je suis d'accord pour qu'on y ajoute une date. M. Motz proposait que l'on réévalue cela après le dépôt du rapport Rouleau, et je suis aussi d'accord sur cela.
Ensuite, la motion donne aux analystes l'instruction de préparer un projet de rapport. Or il s'agit d'un autre sujet.
Enfin, la motion suggère que nous devons déposer notre rapport avant le 31 mars. L'idée de nous imposer nous-mêmes une date limite peut être bonne ou mauvaise, mais c'est assurément autre chose.
Je pense vraiment qu'il s'agit de quatre sujets différents. Si je devais voter sur la motion maintenant, je serais malheureux de voter contre celle-ci, parce que je suis d'accord sur certaines des propositions. Si l'on garde tous ces éléments ensemble, nous n'arriverons peut-être pas à nous entendre, alors que nous pourrions sûrement nous entendre sur au moins deux ou trois d'entre eux.
:
Je souhaite simplement dire que, selon moi, il y a consensus autour de la table sur le fait que nous devons attendre le rapport de la commission Rouleau. Nous verrons ce qu'en retirent les analystes dans leur rapport. Comme M. Harder l’a indiqué, nous devons demander aux analystes de préparer un rapport pour notre comité. Nous pourrons ensuite commencer à délibérer et à formuler des recommandations.
Au vu du nombre de semaines de séances qu'il nous restera après la fin des travaux de la commission Rouleau, il nous sera raisonnablement impossible de tenir une échéance au 31 mars. Même si nous ne convoquions plus personne, il nous serait pratiquement impossible d’examiner les témoignages et d'analyser le rapport Rouleau pour pouvoir formuler des recommandations sur la base de ce rapport d’ici le 31 mars.
Évidemment, le 23 juin sera la dernière journée avant l’ajournement pour l’été, si je ne me trompe pas. Si c’est plus tôt, nous aurons encore moins de séances et nous devrons terminer plus tôt. Je pense que c’est raisonnable.
Cette formule nous permettra d’avoir un rapport complet. Nous avons entendu d’excellentes recommandations sur divers aspects: des services de police à l’interprétation de la loi, etc. Je pense que cela nous aidera à nous donner une certaine latitude, ce qui est conforme à notre rôle.
:
En ce qui concerne ce que M. Brock vient de dire, je pense qu’il s’agit d’une hypothèse quant à la façon dont nous devrions traiter cette motion, en fonction des motions futures qui pourraient ou non être adoptées.
Deuxièmement, le 31 mars nous mettrait à cinq semaines après le dépôt du rapport de la commission Rouleau au Parlement. Rien ne nous oblige à ne siéger qu'une fois par semaine, de sorte que, s’il y a une préoccupation au sujet du calendrier des séances, nous pourrions siéger plus d’une fois par semaine. Le Comité est maître de sa propre destinée à cet égard.
Je dirais également que nous ne devrions pas confondre ce qu’on a demandé au juge Rouleau et ce qu’on nous a demandé. Notre mandat et la motion adoptés à la Chambre et au Sénat sont techniquement différents. Il est important de ne pas le perdre de vue, car je pense qu’on a donné l’impression qu'on s'attend à ce que nous répondions à ce qui pourrait être un rapport de 300 ou 400 pages du juge Rouleau.
Merci.
:
Sénatrice Boniface, veuillez me remplacer durant mon intervention.
Je crois avoir dit que je m’intéresse vivement à la question, que je suis prêt à accepter les conclusions de la Commission Rouleau, quelles qu’elles soient, et qu'il est à espérer que nous en tiendrons compte dans notre examen du rapport. Je sais que le temps presse. Je prends acte de la solution proposée pour nous permettre d’utiliser éventuellement les semaines de travail dans les circonscriptions ou de demander plus de temps. Le texte actuel prévoit trois réunions après le rapport final, mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Je pense que, sur le plan logistique, nous pourrions envisager de passer plus de temps sur le rapport si nous le voulions.
Cela dit, je respecte également l’idée que, si nous disposions de nouveaux renseignements, nous pourrions les examiner dans le cadre d’une tribune ouverte à la faveur d'une réunion portant sur les travaux du Comité. Je parle de documents que nous pourrions recevoir ou de quoi que ce soit d’autre.
À ce stade‑ci, je pense que cette motion fait l'affaire, et j’espère que nous allons pouvoir affiner la voie à suivre. Toutefois, dans l’état actuel des choses, je suis en faveur de cette motion, conscient du fait que nous pourrions décider d'accroître la fréquence de nos réunions pour travailler sur notre rapport et organiser une tribune ouverte où l’information pourra être étudiée en public.
J'admets que, chaque fois que nous siégeons à huis clos, après l'adoption d'une motion pour ce faire, rien ne nous empêche de décider de repasser en réunion publique. L’un n’empêche pas l’autre, du moins d’après ce que je comprends.
Pour ce qui est des rapports provisoires, jedirais que je ne suis pas en faveur de motions de fins de travaux, venant de quelque parti que ce soit au Comité, qui pourraient donner lieu à des heures de palabres dans le cadre d’une obstruction systématique, dans le cadre d’une étude très publique et partisane. J’espère que tous les rapports qui seront présentés le seront d’une manière qui respecte le précédent établi par nos autres comités, que nous rédigerons le rapport ensemble et que nous le présenterons en tant que comité.
Voilà ce que j’avais à dire.
Sénatrice Boniface, je vais reprendre la présidence et donner la parole au sénateur Harder.
:
J'écoute nos débats et je comprends les préoccupations de tous les participants. Je ne sais pas si je devrais le proposer maintenant ou plus tard, mais ne pourrait-on pas s'entendre plutôt que de tout rejeter en bloc?
Entre le 31 mars et le 23 juin, nous pourrions nous rencontrer, par exemple, le 15 mai ou le 30 mai. Nous avons effectivement déjà examiné la possibilité de siéger plus souvent, comme nous le suggère notre collègue M. Virani, mais nous nous sommes rendu compte que ce n'était pas possible, faute de greffiers, d'interprètes et de salles disponibles.
Vous vous souviendrez que, au début de l'automne, nous avions demandé de siéger deux jours par semaine. On nous avait alors répondu que ce n'était plus possible et qu'il fallait s'en ternir à une journée par semaine.
Il ne faut pas non plus s'imaginer qu'un miracle va se produire et que nous allons siéger deux ou trois jours par semaine. Nous devrons composer avec une journée par semaine. Par contre, il est vrai que, le 31 mars, c'est un peu court comme échéance. Je pense que le sénateur Harder va convenir avec moi que cette échéance ne nous laisse pas beaucoup de temps pour discuter.
Sans attendre au 23 juin, y a-t-il moyen de s'entendre sur le 15 ou le 30 mai? Je veux bien que nous votions, mais, si nous pouvions conclure un accord informel sur une date, cela pourrait peut-être faciliter les choses.
:
Avec tout le respect que je dois à ma collègue libérale, je dirais qu'elle suppose mal. Ce que nous essayons de faire... J’ai écouté très attentivement le plaidoyer du sénateur Harder à l'appui de sa motion, et je l’ai entendu dire très clairement que cela n'empêcherait pas d’entendre d’autres témoins. Cependant, cela n’est pas clairement énoncé dans la motion elle-même.
Je ne veux pas manquer de respect envers le sénateur Harder, mais à moins que tel soit le cas, que nous votions et que nous nous entendions là‑dessus, il se peut que nous n’arrivions pas à un consensus pour convoquer d’autres témoins. En définitive... Je suis très étonné que ma collègue du Parti libéral s’oppose à cela, parce que nous essayons, au contraire, d’accélérer le processus. Nous étions tous d’accord pour dire que la liste que nous avions dans notre plan de travail était tout à fait ingérable dans la situation actuelle, près d’un an après le début de ce processus.
Nous essayons d’accélérer l’audition des témoins les moins controversés en leur permettant de le faire par écrit. D’autres universitaires continuent de travailler sur ce plan de travail. Ces universitaires auront certainement préparé une déclaration écrite ou sont en mesure d'en préparer une.
C’est une question d’efficacité. Il ne s’agit pas de compliquer les choses. Cela vient éclairer la proposition du sénateur Harder, sur laquelle nous n’avons pas encore voté.
:
À propos de l’efficacité du processus, je dirais simplement que nous avons été particulièrement efficaces il y a quelques mois quand nous avons décidé tout de go — je pense que c’est l'expression qui convient — de prendre toute la preuve disponible avant l’enquête Rouleau pour l’intégrer dans nos travaux. Cela nous a conféré un degré d’efficacité énorme.
Je remarque que la grande majorité, sinon la totalité de ces preuves a été vérifiée par voie de contre-interrogatoire. Comme nous l’avons vu, le a été interrogé par quelque neuf avocats lors de sa comparution du vendredi, il y a quelques semaines.
Selon moi, ce concept du contre-interrogatoire n’a jamais été aussi déterminant que lorsque nous avons dû réinviter un témoin ici et qu'il s'est fort heureusement présenté. C’est ce que je pense personnellement, mais le témoignage du représentant de GiveSendGo, ses réponses aux questions posées, a clairement démontré qu'il n'était pas crédible. Voilà, selon moi, qui a été riche d'enseignements pour tous les membres du Comité quant à la façon dont nous délibérons et quant au genre de recommandations que nous formulons.
Le contre-interrogatoire est fondamentalement utile. Le seul élément que nous incorporons sous la forme d'un renvoi a déjà fait l’objet d’un contre-interrogatoire devant le juge Rouleau, ce qui me fait dire que Mme Bendayan a bien fait valoir son point de vue.
:
Je cède la présidence à la sénatrice Boniface.
J'estime qu'en notre capacité de parlementaires, nous devons faire preuve d’une plus grande prudence dans le cadre de cet examen et du processus de consultation publique. En fait, je suis en faveur de l’adoption de cette motion. Je crois le sénateur Harder sur parole quand il dit que, si une bombe explosait ou s'il se creusait un écart important, nous serions alors tenus à nous livrer à un examen plus poussé ou à exiger un contre-interrogatoire lors de séances d’information controversées. Il faut que ce soit clair. Du point de vue de la procédure, les séances d’information sont à égalité avec les témoignages en ce qui concerne les notes des analystes.
C’est pour ces raisons que j’appuierai cette motion. Je suppose de bonne foi que si nous avions mené à terme notre plan de travail, sur lequel nous nous étions entendus à un moment donné, nous aurions invariablement vu ces témoins.
Je vais tester la bonne volonté du Comité. Si cette motion est adoptée, je me tournerai vers les conservateurs pour qu’ils nous appuient globalement — bien qu'il me soit arrivé de voir des comités où cela ne se fait pas — dans le but de faire avancer les choses. Pour ces raisons, j’appuierai l’amendement visant à ce qu'on envisage la tenue de séances d’information.
Je tiens aussi à dire officiellement que, si des écarts importants se creusent par rapport à la position consensuelle du Comité au sujet du rapport, j’appuierai également la convocation de tout témoin ayant donné une séance d’information pour qui il serait justifié de mener un nouveau contre-interrogatoire et un examen plus poussé.
Je vais reprendre le fauteuil et donner ensuite la parole à la sénatrice Boniface.
:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Il y a quelques jours, nous avons fait circuler une motion concernant les documents que le Comité essaie d’obtenir. Cette motion est très semblable à celle déposée en mai, qui tenait compte des même préoccupations soulevées par certains membres du Comité et demandait la participation des légistes. Là aussi, comme vous le verrez dans la motion, des dates y étaient mentionnées.
Nous avons entendu maintes fois des témoins, de même que le commissaire Rouleau et les avocats de la commission dire qu’il est malheureux que nous fonctionnions un peu en vase clos, sans avoir la totalité des documents. Il faut veiller à ce que ce comité reçoive les documents en question et à ce qu'il soit remis à la Commission sur l'état d'urgence.
:
Je vous crois sur parole. Je n’ai aucune raison de penser que vous ne citez pas le protocole approprié.
Nous avons une motion qui a été dûment présentée. Voulons-nous mettre la question aux voix?
Nous allons la mettre aux voix.
M. Glen Motz: Avant d’en arriver là, monsieur le président, puis‑je poser une question?
Le coprésident (M. Matthew Green): Est‑ce une question de procédure?
M. Glen Motz: Je recherche le consensus. Y a‑t‑il consensus sur le fait que nous voulons ces documents? Voulons-nous des documents? Si nous devons modifier le libellé...
Un député: Je crois que la présidence a déjà demandé le vote.
Le coprésident (M. Matthew Green): J’ai demandé le vote dans le respect de la procédure. Nous avons eu amplement l’occasion de débattre. J’ai mis l'amendement aux voix.
Nous allons voter.
(La motion est rejetée par 5 voix contre 5. [Voir le Procès-verbal])
Le coprésident (M. Matthew Green): La procédure prévoit qu'en cas d’égalité, la motion est rejetée.
Voilà qui met fin à l'examen des motions ayant été présentées. À moins qu’il y ait d’autres questions... Je tiens à souligner que nous devons nous arrêter à 21 h 42.
Cela dit, le Comité souhaite-t-il que la séance soit levée?
La séance est levée.