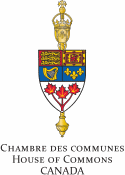:
Merci, monsieur le président.
Je m'appelle Cindy Forbes, et je suis la présidente de l'Association médicale canadienne, l'AMC. Je suis également médecin de famille en Nouvelle-Écosse. Je suis accompagnée par le Dr Jeff Blackmer, vice-président du professionnalisme médical à l'AMC. C'est lui qui a dirigé le travail de notre organisme sur l'aide médicale à mourir.
J'aimerais commencer l'exposé en faisant un bref retour sur les consultations que l'AMC a menées auprès du public et des médecins concernant les soins de fin de vie. Je ferai ensuite un survol de notre rapport, intitulé Approche fondée sur des principes pour encadrer l’aide à mourir au Canada.
Mais avant tout, j'aimerais porter deux enjeux d'importance névralgiques à l'attention du Comité, des enjeux qui seront cruciaux pour garantir un accès efficace aux patients.
Premièrement, comment pouvons-nous assurer que les cadres législatif et réglementaire permettront de faire un équilibre approprié entre la capacité des médecins de suivre leur conscience et celle des patients d'obtenir de l'aide médicale à mourir? Deuxièmement, comment pouvons-nous garantir l'établissement d'un cadre uniforme à l'échelle du pays?
Nous aborderons ces enjeux dans nos commentaires, et vos questions seront les bienvenues. Nous souhaitons mettre en relief le rôle potentiel que les lois fédérales peuvent jouer pour traiter ces enjeux avec efficience et efficacité.
Tout d'abord, un peu d'histoire. En tant qu'association professionnelle représentant les médecins du Canada, l'AMC reconnaît depuis longtemps l'importance des soins de fin de vie. Nous avons joué un rôle de premier plan au cours des deux dernières années, notamment en menant la discussion nationale sur les soins de fin de vie, dont l'aide médicale à mourir. En 2014, l'AMC a entrepris la plus vaste consultation que le Canada ait vue ces dernières années. Nous avons organisé des assemblées publiques partout au pays — en plus d'échanges en ligne — afin de savoir ce que le public et les médecins pensent des questions relatives aux soins de fin de vie. Cette consultation nous a permis d'étayer notre position en la matière et de préciser l'attention que nous souhaitons accorder à ces questions.
Durant l'affaire Carter, l'AMC s'est présentée en Cour suprême à titre d'intervenant, d'ami du tribunal, avec l'objectif de rendre compte du point de vue des médecins. Dans sa décision, la Cour a fait référence à la position de l'AMC. À la suite de la décision historique rendue par la Cour suprême en février dernier, l'AMC a entrepris de mettre au point des recommandations afin de baliser la mise en oeuvre de l'aide médicale à mourir. L'élaboration de ces recommandations s'est appuyée sur des consultations et des réflexions poussées menées auprès du comité d'éthique de l'AMC, des médecins canadiens et des principales parties concernées en santé et en médecine.
De plus, au cours de l'automne, l'AMC a rencontré de nombreux ministres de la Santé provinciaux et territoriaux afin de discuter de ces recommandations. Or, l'élaboration de nos recommandations est désormais terminée, et nous les avons rendues publiques la semaine dernière. Les membres du Comité ont reçu une copie du document où elles sont présentées, Approche fondée sur des principes pour encadrer l’aide à mourir au Canada. Orientées par une série de 10 principes fondamentaux, les recommandations formulées portent sur les quatre domaines suivants: l'admissibilité du patient à une évaluation concernant l’aide à mourir; les mesures de protection procédurales pour assurer que les critères d'admissibilité sont satisfaits; les rôles et responsabilités du médecin traitant et du médecin consultant; comment trouver le juste équilibre entre l'objection de conscience et la demande d'aide médicale à mourir d'un patient.
En raison des préoccupations particulières qu'elle suscite, cette dernière question, l'objection de conscience, en est une dont nous aimerions parler plus longuement.
Pour ce faire, je laisse la parole à mon collègue, le Dr Jeff Blackmer.
:
Merci, docteure Forbes, et merci aux membres du Comité.
La garantie d'une offre d'accès concrète aux patients dans l'ensemble du pays dépend en partie de notre façon d'approcher la question. Je tiens à souligner qu'une des préoccupations clés de l'AMC a été de faire en sorte que les médecins comme les patients soient pris en compte dans la réponse réglementaire et législative globale à l'arrêt Carter. Comme il s'agit d'une question de société, l'aide à mourir est un sujet délicat et controversé pour la profession médicale. Il faut admettre qu'il s'agit là d'un changement en profondeur pour les médecins du Canada, et comme organisme représentant ces professionnels, nous ne saurions trop insister sur la signification et l'importance de ce changement.
Comme nous l'avons dit, l'AMC a abondamment consulté les médecins en amont et en aval de la décision Carter. Nos enquêtes et nos consultations indiquent qu'environ 30 % des médecins sont disposés à offrir de l'aide médicale à mourir. Il est important de noter que la majorité des médecins qui choisiront de ne pas offrir cette aide de façon directe ne voient par ailleurs aucun problème à recommander un autre médecin à un patient, et ne considèrent pas cela comme une violation de leur conscience ou de leur code moral.
Pour d'autres cependant, il serait catégoriquement et moralement inacceptable de faire cette sorte de recommandation. Pour ces médecins, un tel geste est synonyme d'une participation procédurale forcée susceptible de les relier — voire de les en rendre complices — à ce qu'ils jugent comme étant un acte odieux sur le plan moral. Autrement dit, la recommandation d'un tiers pour offrir de l'aide médicale à mourir ne pose pas de problème de conscience à certains médecins, mais à d'autres, oui.
Une partie de l'obligation du gouvernement et des parties prenantes est d'assurer un accès efficace pour les patients en mettant en place les ressources et les systèmes nécessaires. Le cadre de l'AMC rend compte des différences de conscience en recommandant la création de ressources visant à faciliter cet accès. Il est essentiel que nous rendions les choses claires pour les médecins et leurs patients, et que nous élaborions une approche uniforme pour l'ensemble des administrations.
L'AMC est très consciente de ce qui risque de se produire si elle ne fait rien en ce sens: nous assisterons sans doute à la multiplication d'approches diverses et potentiellement conflictuelles, ce qui ne serait utile pour personne — docteurs ou patients. Or, je peux vous dire comme une confidence — et avec une certaine gravité — que c'est le risque que nous courons à l'heure actuelle. Un certain nombre d'organismes de réglementation provinciaux ont récemment publié des lignes directrices provisoires ou définitives à ce sujet. Pour un certain nombre d'aspects importants, les vues exprimées dans ces lignes directrices divergent légèrement ou considérablement entre elles. Il ne s'agit plus d'une question théorique. Nous nous retrouvons concrètement avec une mosaïque d'approches.
Nous nous tournons vers le Parlement pour qu'il nous montre la voie et appuie l'élaboration d'une approche pancanadienne. Le cadre de l'AMC fournit une orientation névralgique à l'intention de ceux qui prendront des décisions à ce sujet. Je le répète, l'élaboration de ces recommandations par l'AMC a demandé une réflexion délicate et approfondie qui s'est étalée sur les deux dernières années. Ce sont peut-être les consultations les plus rigoureuses que nous ayons menées jusqu'ici. À chaque étape, nous avons consulté nos membres, le public et d'autres intervenants des soins de santé. Nos recommandations sont fondées cette importante consultation et sur l'examen réalisé par nos experts au sujet des cadres existants à l'étranger.
Je suis ravi que les médecins du Canada se soient dits prêts à travailler avec vous afin d'assurer que vous soyez en mesure de fournir une réponse dans quatre mois. À l'heure actuelle, le pays n'a pas de système en place pour nous épauler, mais je peux vous dire avec une certaine fierté que le cadre de l'AMC est prêt pour que vous l'adoptiez.
La Dre Forbes et moi serons heureux d'écouter tous vos commentaires et de répondre à toutes vos questions.
Merci.
:
Bonjour. Je m'appelle Anne Sutherland Boal. Je suis la directrice générale de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, l'AIIC.
L'AIIC est la voix professionnelle nationale des infirmières et infirmiers du Canada. Elle représente 135 000 membres à l'échelle du pays — des infirmières praticiennes et des infirmières autorisées —, et elle est représentée dans toutes les provinces et tous les territoires. Je suis accompagnée par Josette Roussel, une infirmière-conseil principale de notre organisme.
La fonction fondamentale de notre association nationale est de défendre le personnel infirmier, les Canadiens et une meilleure santé pour tous. Merci d'avoir invité l'AIIC à cette 6e séance du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir. Nous espérons que le comité mixte tiendra compte des connaissances et du savoir-faire spécialisés des infirmières et des infirmiers au sujet de l'aide médicale à mourir. Nous formulerons également certains commentaires sur le sujet plus général des soins de fin de vie.
Les infirmières praticiennes et les infirmières autorisées forment le groupe de soignants le plus nombreux au Canada. Notre taille seule — plus de 350 000 infirmières et infirmiers — et les situations innombrables dans lesquelles nous travaillons font de nous les intervenants en santé qui ont l'interaction la plus systématique et la plus directe avec les patients et les familles qui ont besoin de soins de santé. Les infirmières et les infirmiers s'occupent des gens 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ils nouent des liens de confiance avec leurs patients, les familles et les soignants. Les infirmières praticiennes et les infirmières autorisées vont là où sont les Canadiens: à la maison, dans la collectivité et dans les hôpitaux. Dans les commentaires qui suivent, le terme « infirmières » désigne les infirmières et infirmiers praticiens, et les infirmières et infirmiers autorisés.
Les infirmières canadiennes ont surveillé de près la question de l'aide médicale à mourir. En octobre 2015, nous avons fait part de notre point de vue sur la question au Comité externe sur les options de réponse législative à Carter c. Canada. Nous avons aussi discuté des conséquences que cette question aurait sur la pratique des soins infirmiers, et ce, bien avant la décision rendue par la Cour suprême du Canada en février 2015 et la décision prononcée par la Cour d'appel du Québec, en décembre 2015. C'est une question dont les infirmières discutent couramment. Hier encore, à l'occasion d'un webinaire de l'AIIC sur les soins de fin de vie, plus de 350 infirmières se sont penchées sur les enjeux éthiques et les soins infirmiers liés à l'aide médicale à mourir.
Les Canadiens savent qu'il n'est jamais facile de voir un être cher ressentir de la douleur et de la détresse, et les infirmières canadiennes le savent aussi. Nous faisons face à ces situations en parlant en faveur des patients et en nous appuyant les uns les autres en tant que fournisseurs de soins afin que les souhaits des patients soient respectés. Les infirmières aident depuis longtemps les patients et les familles en ce qui a trait aux soins de fin de vie, à la planification et aux discussions entourant ce passage. Nous militons verbalement pour une amélioration des soins palliatifs dans l'ensemble du Canada. Nous estimons que le travail de votre comité, mais aussi les efforts des décideurs et des fournisseurs doivent se poursuivre afin d'améliorer l'offre des services et des ressources en soins palliatifs pour tous les Canadiens.
La pratique des soins infirmiers au Canada est fondée sur notre code de déontologie, le Code de déontologie des infirmières et infirmiers. Ma collègue Josette Roussel va maintenant vous parler de ce code et de l'importance que cette question revêt pour les infirmières du Canada.
Cela dit, permettez-moi de vous présenter Josette.
[Français]
Je suis infirmière et j'ai soigné des patients en fin de vie pendant de nombreuses années au cours de ma carrière.
Je vais continuer ma présentation en anglais.
[Traduction]
Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers est un document fondamental pour les infirmières au Canada. Pour m'aider à expliquer pourquoi il est important et comment il aide le personnel infirmier, je vais vous demander de vous représenter le scénario suivant. Un homme de 85 ans se retrouve à l'hôpital après avoir subi une grave hémorragie cérébrale. Il dit à sa fille qu'il a peur. Il reste éveillé toute la nuit dans son lit à réfléchir à ce qui l'attend. Vais-je mourir? Quand vais-je mourir? Vais-je avoir beaucoup de douleur? Ce sont les grandes questions que tout le monde se pose. Or, lorsqu'il est là, à 3 heures du matin, dans son lit d'hôpital, entouré d'étrangers, l'une des seules personnes à qui il peut parler est l'infirmière.
Notre Code de déontologie des infirmières et infirmiers et les ressources que fournit l'AIIC servent à préparer les infirmières à ces discussions qui ont lieu à 3 heures du matin. Le code est là pour aider les infirmières à exercer leur profession avec compétence, compassion, sens des responsabilités et éthique. Il fournit une orientation sur les droits des personnes à refuser ou à supprimer le consentement. Il met aussi l'accent sur l'importance de reconnaître les différences entre le pouvoir des fournisseurs de soins et celui du malade, et sur ce qu'il convient de faire lorsque les soins entrent en conflit avec la conscience. Le code fournit des renseignements pratiques sur la formation de l'objection de conscience: avant l'emploi, anticipation et planification d'un conflit et la situation où quelqu'un est engagé dans un soin infirmier qui crée un conflit.
Bien que les infirmières aient leur code pour les orienter dans leur travail, elles ont aussi besoin de lois, de règlements, de politiques et de procédures. Ce sont ces structures qui nous permettent d'assurer, en tant que fournisseurs de soins, que les Canadiens ont accès aux soins qu'ils méritent.
Les infirmiers et infirmières savent pertinemment que l'aide médicale à mourir est un enjeu des plus complexe qui peut mettre en contradiction les valeurs professionnelles, les valeurs personnelles et les règles de pratique en santé. Quoi qu'il en soit, dans la foulée de la décision rendue par la Cour suprême, l'AIIC doit s'employer en priorité à aider le personnel infirmier à offrir à tous les patients les meilleurs soins qui soient dans le respect des règles d'éthique.
J'aimerais maintenant vous entretenir des mesures à privilégier aux yeux de notre association.
Nous avons d'abord besoin de mesures de protection permettant à chaque patient de prendre les décisions qui le concernent. De telles mesures sont nécessaires pour s'assurer que l'aide médicale à mourir est fournie de façon consciencieuse et compétente, dans le plus grand respect des règles d'éthique. Nous recommandons la mise en place de mécanismes permettant à chaque patient de discuter de sa situation avec ses proches, les pourvoyeurs de soins et l'équipe interprofessionnelle; de politiques et de procédures pour déterminer si le patient est toujours capable de prendre des décisions à toutes les étapes de son cheminement; de processus permettant au patient de reconsidérer sa décision; de mécanismes de protection pour les patients les plus vulnérables; de mécanismes permettant au personnel infirmier de contribuer à la prise de décisions et à l'évaluation des mesures de soutien requises pour le patient; de lignes directrices à l'intention de l'équipe interprofessionnelle pour la consignation des discussions tenues et des plans établis.
En deuxième lieu, il faut offrir un accès équitable et rapide à l'information au sujet des options de fin de vie, y compris les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Tous les Canadiens doivent bénéficier du même accès à l'aide médicale à mourir, quel que soit leur code postal ou le milieu où ils se trouvent, soit à l'hôpital ou à la maison. Les considérations relatives à la culture, au sexe, aux inégalités et aux disparités doivent également être prises en compte.
Les Canadiens et les fournisseurs de soins doivent avoir accès aux ressources et à l'information nécessaire au sujet de toutes les options de fin de vie. Selon nous, la planification des processus d'aide médicale à mourir devrait se faire parallèlement à celle des soins palliatifs dans le cadre d'une approche pancanadienne. Nous recommandons que les infirmiers et infirmières aient accès dans tous leurs contextes de travail à l'information, aux ressources et aux outils nécessaires pour répondre aux questions posées par les patients, leur famille et les autres fournisseurs de soins. Les professionnels de la santé devraient en outre recevoir une formation leur permettant de mieux guider les patients dans leurs choix touchant les soins palliatifs et les soins de fin de vie.
Troisièmement, nous souhaiterions l'adoption d'une approche axée sur la personne pour aider le patient à mieux faire ses choix. Il faut considérer que le désir de mourir dans la dignité en étant soulagé de ses souffrances est toujours au coeur de la demande d'un patient. Quel que soit le plan établi, la dignité en sera donc l'un des éléments clés. En offrant des soins axés sur la personne, on respecte les valeurs du patient et ses volontés en matière de soins de santé en favorisant son autonomie, sa liberté de choix, sa capacité de contrôle ainsi que la prise conjointe de décisions. Nous recommandons la mise en place de politiques et de procédures guidant l'équipe interprofessionnelle dans ses communications avec le patient, sa famille et les pourvoyeurs de soins. Nous préconisons en outre une orientation assurant une discussion ouverte et une écoute attentionnée tenant compte des différences culturelles ainsi que de l'autonomie et de la spiritualité de chacun.
Quatrièmement, il nous faut des mécanismes assurant la qualité et la sécurité. Il faut absolument mettre en place un processus rigoureux pour évaluer l'état des patients et en arriver à une décision. Le processus doit être bien défini et documenté de façon à être compris de la même manière partout au Canada. Nous recommandons la création de mécanismes systématiques, y compris des systèmes, des politiques et des procédures normalisées permettant la cueillette de données exactes et la publication de rapports à l'échelle nationale. Il conviendrait également d'établir un cadre harmonisé, piloté par des organismes de réglementation, pour normaliser la formation et l'évaluation des compétences des professionnels de la santé.
:
Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureuse d'être ici. J'ai l'intention d'apporter ma contribution en vous aidant à mieux comprendre le travail d'un médecin en soins palliatifs, ce que je suis moi-même.
À Toronto, je visite mes patients à leur domicile. Je suis ici pour vous présenter les points de vue de la Société canadienne des médecins de soins palliatifs. En reconnaissance du fait que vous avez déjà reçu de grandes quantités d'information, je vais concentrer mon intervention sur quatre grandes priorités.
Passons tout de suite à la première de ces priorités. Parallèlement aux mesures législatives qui sont prises pour régir la mort provoquée, nous devons améliorer l'accès aux soins palliatifs. Il y a trois raisons pour cela. Il faut d'abord savoir qu'il y a moins de 3 % de Canadiens qui risquent de se prévaloir de l'aide médicale à mourir, alors que les soins palliatifs peuvent bénéficier à tous et chacun d'entre nous. Nous savons par ailleurs que les soins palliatifs actuellement offerts sont insuffisants et que 65 % des patients meurent à l'hôpital, contrairement à leur volonté. Troisièmement, il faut comprendre que c'est davantage une question personnelle qu'un enjeu politique. Nous avons tous vu mourir des proches. Pour certains, la mort a été plutôt douce; pour d'autres, elle a été beaucoup plus difficile. Si nous voulons vraiment respecter la liberté de choix, il faut qu'il y ait une option et que l'on offre l'accès à des soins palliatifs de qualité.
La création d'un secrétariat national serait d'après nous l'une des façons de mieux répondre aux besoins en matière de soins palliatifs. De nombreuses organisations, comme la Société canadienne du cancer et l'Association médicale canadienne, ont déjà préparé le terrain pour l'établissement d'une stratégie nationale touchant les soins palliatifs. Différentes pistes de réflexion ont ainsi pu être proposées.
Si l'on souhaite une approche nationale, c'est que les Canadiens sont soucieux de l'équité et qu'il y a un grand manque d'uniformité dans le régime en place. C'est l'endroit où vous vivez qui détermine les services auxquels vous avez accès.
Il faut que cette initiative soit menée à l'échelle nationale ou fédérale pour permettre l'établissement de normes, le suivi de leur application et la cueillette de données, ce qui nous manque actuellement. On pourra ainsi mieux savoir à quoi s'en tenir quant aux moyens à prendre pour opérer la transition des soins de courte durée en milieu hospitalier, qui accaparent actuellement 95 % du budget, vers les services communautaires, qui doivent se contenter de 5 % des fonds. Nous avons besoin d'une stratégie d'orientation qui doit émaner d'une réflexion pancanadienne. Comment mener une campagne de sensibilisation du public pour dissiper certaines des craintes face à la mort?
Notre deuxième priorité doit être de réduire les risques de décès prématuré. Tous les médecins en soins palliatifs ont eu des patients qui ont demandé qu'on les aide à mourir pour changer d'avis par la suite et nous dire à quel point ils étaient heureux que nous n'ayons pas pu acquiescer à leur requête. Je ne veux pas laisser entendre par là que tous les patients vont changer d'avis, mais il faut mettre en place les mesures de protection nécessaires, en prévoyant notamment une période d'attente proportionnelle au pronostic de vie du patient.
À titre d'exemple, lorsqu'une telle requête est formulée par une patiente souffrant d'un cancer du sein à laquelle il ne reste peut-être que quatre semaines à vivre, nous devrions pouvoir réagir plus rapidement que dans le cas d'un jeune homme de 21 ans souffrant d'une lésion de la moelle épinière qui n'arrive pas à envisager sa vie dans un fauteuil roulant. Comme nous savons que les gens peuvent finir par s'adapter à leur nouvelle réalité, une période d'attente uniforme ne serait pas appropriée.
Nous devons aussi nous assurer que les gens qui examinent une demande de mort provoquée possèdent les compétences nécessaires. Si le jeune homme en question avait parlé à un médecin qui ne connaissait pas les différentes options disponibles, il aurait très bien pu se faire dire que sa situation était sans espoir et que l'aide médicale à mourir était bien sûr la solution dans son cas. Dans notre rôle de médecins en soins palliatifs, nous savons que la plupart de ces demandes sont des expressions de désespoir, et que nous pouvons faire partie de la solution dans certains cas. Je vous dis cela en toute humilité, car je sais très bien que nous ne pouvons pas aider tout le monde.
Il est en outre important que nous ayons accès à des conseillers en toxicomanie, à des psychiatres et à des professionnels en soutien spirituel de telle sorte que le patient obtienne toute l'aide dont il a vraiment besoin. Vous trouverez dans notre mémoire quelques observations au sujet de la mise en oeuvre progressive et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions à ce sujet.
Notre troisième priorité réside dans la mise en place d'un organisme de supervision national qui permettrait de s'assurer que ce service est disponible partout au pays. Cela ne devrait pas se limiter à ce seul aspect, car si nous n'éprouvons pas actuellement de difficulté, comme l'indiquait le Dr Blackmer, à trouver des médecins consentants, il n'est pas chose facile d'établir la connexion entre ces médecins et les patients, un fardeau qui ne devrait pas reposer sur les épaules des médecins canadiens.
Le rôle de cet organisme de supervision national ne se limiterait pas à la cueillette de données, à l'analyse des tendances et à l'établissement de normes canadiennes. Il pourrait également offrir des services d'enregistrement des fournisseurs de soins consentants, de l'information et de l'aiguillage. Les professionnels de la santé dont l'aide est sollicitée n'ont pas nécessairement accès aux ressources requises pour fournir toute l'information pertinente.
En plus du soutien apporté aux établissements et aux régimes en manque de ressources, cet organisme de supervision pourrait permettre d'établir une distinction véritable entre la mort provoquée par un médecin et les soins palliatifs. C'est une distinction qui nous préoccupe tout particulièrement, car nous n'avons pas ménagé nos efforts pour que les soins palliatifs deviennent une option valable pour les patients. Si, dans leur esprit, l'aide à mourir — celle que je dispense tous les jours à mes patients à titre de médecin en soins palliatifs — est la même chose que la mort provoquée, il y a certains d'entre eux qui n'auront tout simplement plus recours aux soins palliatifs.
Comme dernière priorité, nous devons créer un système durable. Il faut que le Code criminel offre des mesures de protection pour tous nos professionnels de la santé — et pas uniquement pour les médecins. Nous devons en outre envisager des mesures législatives pour protéger le droit à la liberté de conscience, car un système durable ne peut pas s'appuyer sur la détresse morale. Je crois d'ailleurs que le Dr Blackmer a déjà abordé ce point avec vous. Nous devons faire en sorte que le choix de certains établissements de ne pas offrir de tels services ne se traduise pas par une surcharge de travail pour d'autres établissements. Comme Anne le soulignait, les professionnels qui offrent ce service doivent obtenir du soutien psychologique et spirituel de manière à éviter tout débordement.
Pour qu'un système soit vraiment durable, il convient, comme je le disais précédemment, de s'assurer qu'il y a une distinction nette entre soins palliatifs et mort anticipée. J'espère vous avoir proposé quelques pistes de solutions intéressantes à cet égard.
Merci.
:
Je tiens à vous remercier, coprésidents du Comité et honorables députés et sénateurs, de nous donner cette occasion de comparaître devant vous aujourd'hui.
Je m'appelle Carlo Berardi. Je suis pharmacien à Sudbury, mais je comparais aujourd'hui à titre de président du conseil d'administration de l'Association des pharmaciens du Canada.
L'APC est le porte-parole national des pharmaciens au Canada. L'association a pour but d'améliorer la santé et le bien-être des Canadiens grâce à l'excellence des soins pharmaceutiques. Nous regroupons 10 associations provinciales et nous représentons plus de 20 000 pharmaciens et étudiants en pharmacie partout au Canada.
Je suis aujourd'hui accompagné de mon collègue, Phil Emberley, qui est également pharmacien, et aussi le directeur des affaires professionnelles à l'APC. Nous reconnaissons l'ampleur de la tâche à accomplir, qui nécessite de concilier les opinions de divers intervenants, du public, mais surtout, des patients. Nous sommes venus vous parler aujourd'hui du rôle des pharmaciens dans l'aide médicale à mourir et de l'incidence que pourrait avoir cette intervention sur les pharmaciens.
Depuis que la Cour suprême a rendu son jugement il y a près d'un an, une grande partie du débat public a porté sur le rôle que jouent les médecins dans la pratique de l'aide médicale à mourir, et avec raison. Toutefois, les médecins ne travaillent pas seuls. Ils font partie d'un vaste système composé d'infirmières et d'infirmiers, de pharmaciens, de travailleurs sociaux et d'autres fournisseurs de soins de santé ayant chacun leur expertise et leurs responsabilités. Alors que l'arrêt Carter s'articulait principalement autour du rôle des médecins dans la prestation des soins de fin de vie, nous avons eu l'occasion de réfléchir au rôle important des pharmaciens, tant dans le contexte des soins de fin de vie que dans celui de l'aide médicale à mourir.
D'autres témoins vous ont parlé de la portée de l'arrêt Carter et de la place que devraient occuper les autres professionnels de la santé dans l'aide médicale à mourir. Selon nous, quelle que soit la façon dont l'aide médicale à mourir sera réglementée au Canada, les pharmaciens auront un rôle à jouer.
Les pharmaciens sont parmi les professionnels en qui les Canadiens ont le plus confiance. Leur accessibilité et leur visibilité au sein de leurs communautés font souvent d'eux le premier point de contact pour les patients qui veulent obtenir rapidement des renseignements fondés en matière de santé.
À titre de pharmacien, je sais à quel point le public dépend des pharmaciens pour obtenir de l'information sur diverses questions de santé, alors il est très probable que des gens leur demandent de l'information sur l'aide médicale à mourir en vue de prendre une décision éclairée.
Au cours des derniers mois, l'APC a mené de vastes consultations auprès de ses membres et d'experts du domaine afin d'élaborer une position de principe et un cadre en vue d'aider les gouvernements qui se penchent sur cette question. Dans le cadre de nos consultations, nous avons réalisé un sondage national auprès des pharmaciens et des intervenants du milieu pharmaceutique auquel nous avons reçu près de 1 000 réponses. Le nombre de réponses montre tout l'intérêt que nos membres portent à cette question.
Nous avons également passé en revue les études existantes sur le sujet et regardé ce qui se faisait dans les autres pays ayant légalisé l'aide médicale à mourir afin de mieux vous conseiller.
Bien que nous n'ayons pas encore finalisé nos recommandations ou notre cadre relativement au rôle des pharmaciens dans l'aide médicale à mourir, nous aimerions souligner certaines des questions qui sont constamment soulevées.
En tant que fournisseurs de soins primaires, nous ne sommes pas étonnés de voir que l'aide médicale à mourir suscite divers points de vue au sein de la profession, comme vous avez pu le constater à la lumière des témoignages de nos collègues médecins et infirmiers. On entend souvent que les pharmaciens se soucient avant tout de la santé et du bien-être de leurs patients et veulent s'assurer qu'ils ont accès aux meilleurs soins possible en fin de vie. Ils doivent avoir accès à des soins palliatifs de qualité, à des mesures efficaces de gestion de la douleur et à l'aide médicale à mourir.
Cependant, nos consultations ont également révélé des préoccupations plus pratiques dont nous aimerions vous faire part aujourd'hui. Même si bon nombre de nos préoccupations ressemblent à celles d'autres fournisseurs de soins de santé, y compris nos collègues de l'AMC et de l'AIIC, il y en a quelques-unes qui ne concernent que les pharmaciens.
Quel que soit le cadre législatif qui sera mis en place ou la façon dont la pratique sera réglementée à l'échelle fédérale ou provinciale, ce qui compte par-dessus tout, c'est que nous ayons accès à des médicaments adéquats. Il n'existe pas qu'un seul médicament pour mettre fin à la vie de quelqu'un, alors comme pour tout autre médicament, nous estimons que le gouvernement fédéral devrait s’assurer que les prescripteurs et les pharmaciens ont accès aux médicaments les plus appropriés, y compris les médicaments utilisés dans l'aide médicale à mourir, afin de fournir aux Canadiens les meilleurs soins possible.
De plus, nous reconnaissons aussi la diversité des méthodes employées ailleurs pour légaliser l'aide à mourir, chacune ayant des conséquences différentes sur les modalités concrètes de cette aide. Nous n'avons pas terminé l'élaboration de notre politique ni celle des documents qui vont encadrer le rôle des pharmaciens dans l'aide à mourir, mais nous tenons à éclairer l'impact de certains modèles sur les soins aux patients et sur le rôle et les responsabilités des pharmaciens.
Au Québec, par exemple, l'aide à mourir se borne à une aide médicale qui exige l'administration directe de l'injection mortelle par le médecin. La dose précise et la composition du mélange mortel sont fixées dans le cadre provincial, et, même si le mélange est préparé par une pharmacie hospitalière, il est ensuite administré par le médecin, à l'hôpital.
Cependant, dans certains pays d'Europe et en Oregon, des variantes existent et autorisent l'ingestion des médicaments dans des lieux divers, notamment à la maison ou dans la collectivité. Dans ces cas, le rôle du médecin resterait important sur le plan de la prescription, mais celui des pharmaciens s'amplifierait sensiblement.
À part ces questions qui nous paraissent particulièrement intéressantes pour les pharmaciens, nous avons aussi les réactions de la profession, qui correspondent à celles des autres fournisseurs de soins. L'immense majorité des pharmaciens appuie l'inclusion, dans la loi, d'une disposition protégeant la liberté de conscience. Comme les membres d'autres professions, ils tiennent à ne pas être obligés de participer à l'aide à mourir en dépit de leurs convictions morales ou religieuses. Dans sa décision, la Cour suprême a clairement dit que rien, dans la déclaration, ne devait contraindre les médecins à fournir l'aide à mourir ou à y participer, et nous croyons que cette protection doit s'étendre aussi aux pharmaciens.
Tout en croyant aussi que le patient a le droit d'être objectivement informé sur l'aide à mourir et l'accès aux soins de fin de vie, les pharmaciens, comme les autres professionnels de la santé, sont divisés sur l'obligation de diriger le patient vers un autre pharmacien qui remplirait volontiers une ordonnance pour l'aide à mourir. Notre priorité reste l'assurance d'un accès au patient. Nous encourageons donc le gouvernement à examiner des options pour diriger les patients facilement, tout en protégeant le droit des pharmaciens à l'objection de conscience. De plus, pour les pharmaciens qui souhaiteraient y participer, nous préconisons vivement des dispositions limitant la responsabilité des professionnels de la santé.
Quel que soit le cadre législatif retenu, nous tenons à ce que les pharmaciens membres d'équipes interdisciplinaires de prestation de soins aux patients qui délivrent aussi les doses mortelles de médicaments soient tout à fait en mesure de fournir les soins nécessaires à leurs patients. Il faut donc assurer une collaboration efficace entre les médecins prescripteurs et les pharmaciens et l'accès des pharmaciens à des renseignements, à un appui et à des ressources appropriés, s'ils choisissaient de participer à l'aide à mourir.
L'information sur le diagnostic du patient et le but de la prescription, de même que la confirmation du consentement du patient et du respect, par ce même patient, de tous les critères d'admissibilité sont essentielles à la délivrance appropriée du médicament et elles amélioreront les soins donnés au patient à tous ses points de contact dans le système. Nous croyons que cela pourrait aider à limiter la responsabilité de tous les fournisseurs de soins de santé en cause.
Nous reconnaissons le très petit nombre de précédents pour guider le gouvernement dans la résolution de cette question importante. Quant aux pharmaciens, ils entrent dans une ère nouvelle. Néanmoins, la profession possède les compétences nécessaires en pharmacothérapie, dans la prestation de conseils aux patients sur les médicaments et dans la distribution des médicaments pour jouer un rôle qui fait partie intégrante des soins de fin de vie de qualité.
En guise de conclusion, je dirai, au sujet de cette pratique nouvelle et en évolution, que nous croyons indispensable de surveiller et d'examiner l'application des lois fédérales et provinciales dans les années à venir. Nous proposons que le mécanisme en soit une commission consultative nationale interdisciplinaire de professionnels de la santé, qui compterait des pharmaciens dans ses rangs.
Dans les semaines à venir, nous mettrons en forme finale notre politique et le cadre que nous proposons et nous serons heureux de les communiquer au Comité.
Nous vous remercions de votre temps et nous sommes prêts à répondre à vos questions.
:
Merci, monsieur le président. Je serai le premier à parler.
Au nom de l'Association des psychiatres du Canada, nous remercions les coprésidents et les membres du comité de nous offrir l'occasion de vous parler de cette question importante.
Je me nomme Karandeep Sonu Gaind, et je suis le président de l'APC, la voix nationale des 4 700 psychiatres du Canada et de plus de 900 résidents psychiatres. Fondée en 1951, l'Association est vouée à la promotion d'un environnement qui favorise l'excellence dans les soins cliniques, l'instruction et la recherche.
Mes remarques d'aujourd'hui se concentreront sur des questions précises touchant la maladie mentale, dont il faut tenir compte dans toute relation d'aide médicale à mourir. L'Association a commencé à élaborer une position complète sur la question avec une gamme de recommandations précises. Mes observations visent à soulever des questions importantes pour que le Comité en tienne compte dans ses délibérations, mais il ne faudrait pas les considérer comme la position finale de l'Association sur la question. La position qu'elle adoptera est en voie d'élaboration.
Commençons par les questions centrales dont il faut tenir compte quand on discute de notions comme « irrémédiable », « souffrances intolérables et persistantes » et « capacité » dans le contexte de la santé mentale.
L'évaluation de ce qui constitue des souffrances intolérables et persistantes causées par les symptômes d'une maladie dépend de la gravité de ces symptômes, du dysfonctionnement qu'ils causent et de la perception, par le patient, de ce qu'il vit. L'évaluation subjective de ce qui est intolérable et l'évaluation prédictive de ce qui est persistant peuvent dans les deux cas être spécialement affectées par la santé mentale.
La maladie mentale peut modifier la cognition du patient et diminuer son jugement et la compréhension de son état de santé. Les symptômes de distortion cognitive communs avec la dépression clinique comprennent des attentes négatives face à l'avenir; le désespoir; la perte de l'espoir d'une amélioration, même si cet espoir est réaliste; une plus grande rigidité cognitive; une pensée qui n'est plus dirigée vers l'avenir; des ruminations sélectives centrées sur le négatif et réduisant au minimum le positif ou n'en tenant pas compte. Souvent, le patient souffre de distorsions de son propre sentiment d'identité et de son rôle dans le monde, y compris de sentiments de culpabilité ou d'inutilité excessive ou de celui d'être un boulet pour autrui.
Les personnes en dépression clinique sont également moins résilientes sur le plan émotif et moins capables d'affronter les facteurs courants de stress de la vie. Des niveaux modérés de stress peuvent même leur paraître intolérables ou excessifs. Même si nous ne pouvons pas encore leur trouver d'applications cliniques, de plus en plus de constats de la recherche portent à croire que des parties dysfonctionnelles du cerveau en période de dépression grave correspondent à ces changements cognitifs.
En ce qui concerne l'irrémédiable, il faut en déterminer soigneusement la signification dans le contexte de la maladie mentale. Bien sûr, irrémédiable ne peut pas simplement signifier incurable. Beaucoup d'états sont considérés, par la psychiatrie et la médecine, comme chroniques et incurables, mais cela n'empêche pas d'agir pour remédier à la situation ou l'améliorer. Il existe des possibilités multiples de traitement, généralement pour les cas même les plus graves de maladie mentale, qui permettent de traiter et d'atténuer les symptômes et la souffrance, quand ce n'est pas de les guérir.
Il est aussi important et essentiel de se rappeler que la personne ne se réduit pas à sa maladie. Des facteurs psychosociaux jouent un rôle important dans l'expérience de la maladie d'une personne, particulièrement dans beaucoup de maladies mentales. Par exemple, l'adoption d'un point de vue étriqué pour l'évaluation de l'irrémédiable, en se limitant à l'amélioration possible des symptômes d'une dépression grave par des traitements biomédicaux, risque de négliger des facteurs importants comme l'isolement social ou la pauvreté.
Parlons maintenant de « capacité ».
Les médecins tiennent compte de quatre éléments importants pour l'évaluer: de la capacité de choisir, de celle de comprendre l'information utile, de celle de comprendre la situation et les conséquences de ses décisions et de celle de manipuler rationnellement l'information. Même chez le patient souffrant de maladie mentale qui est capable de choisir, de comprendre et de se rappeler l'information, son appréciation de la situation, ses attentes actuelles et futures et sa capacité de manipuler rationnellement l'information, tout cela peut être altéré par les distorsions cognitives dont j'ai parlé.
Je tiens à souligner que rien de ce que je viens de dire ne vise à faire croire que la maladie mentale réduit à elle seule le jugement et la cognition du patient, mais, dans la discussion sur l'aide médicale à mourir, nous parlons, par définition, des situations les plus graves, et, dans les cas de maladies mentales graves, le risque d'une telle distorsion cognitive est, bien sûr, plus élevé. Nous pensons avec le cerveau et non avec le coeur ou les membres.
Toutes ces questions s'adressent directement à la crainte du tribunal qu'on n'amène le patient à s'enlever la vie dans un moment de faiblesse. Si on excepte les souffrances effectivement causées par les symptômes, les distorsions cognitives présentes risquent de faire dérailler le processus de décision du patient. Dans l'examen, par la Cour, des facteurs de coercition ou de contrainte, ce serait comme si la maladie mentale détruisait l'autonomie du patient qui lui permettrait de prendre une décision à l'abri de l'influence de ces distorsions. La difficulté provient de cet effet récursif des symptômes sur le processus d'évaluation, par lequel les symptômes mêmes de la maladie mentale peuvent gêner l'évaluation de sa propre maladie mentale par le patient et son évaluation des répercussions actuelles et à venir.
Enfin, il faut tenir compte d'un autre fait. Dans le contexte de la constatation, par le tribunal, de la perte de liberté qu'entraîne le choix de mettre fin prématurément à ses jours, de crainte de ne pouvoir le faire soi-même à cause de souffrances ou d'une incapacité physique progressive croissante, les maladies mentales à elles seules conduisent très rarement sinon jamais à une telle incapacité physique progressive et grave.
Compte tenu de ce contexte général et aussi, je le souligne, de la position encore provisoire de l'Association, nous pouvons proposer pour le moment quelques principes directeurs.
D'abord, quand la maladie mentale sévit, pour bien évaluer dans leurs nuances les problèmes qui pourraient influer sur la prise de décision et pour donner au temps la possibilité de remédier aux symptômes ou aux facteurs psychosociaux, il faudrait confier les évaluations étalées dans le temps à de multiples évaluateurs possédant les compétences appropriées. Notre position définitive tiendra compte d'un plus grand nombre de particularités, et il pourra se trouver divers mécanismes selon les besoins et les ressources publiques, mais ces nombreux évaluateurs compétents sensibilisés aux effets potentiels des maladies mentales sur la cognition, la capacité, etc., et, aussi, ces évaluations successives sont des garde-fous nécessaires.
Ensuite, les notions d'« irrémédiable » et de « souffrances intolérables et persistantes » ne devraient pas se focaliser exclusivement sur l'état biomédical, mais tenir compte de tout l'état du patient, y compris l'éventuel effet d'interventions psychosociales contre la souffrance et les symptômes.
Ensuite encore, des psychiatres peuvent choisir de ne pas participer au processus de l'aide médicale à mourir, à l'instar d'autres professionnels qui vous l'ont fait savoir. Dans ce cas, les patients demandant cette aide devraient pouvoir accéder à des renseignements sur les ressources disponibles à cette fin ainsi qu'aux processus permettant de les diriger, y compris vers des ressources psychiatriques, le cas échéant.
Enfin, il importe de reconnaître que les expressions « dépression résistant au traitement » ou « maladie mentale résistant au traitement » ne définissent généralement pas une maladie sans remède. Dans ce contexte, « résistant au traitement » sert généralement à orienter ultérieurement le déroulement des options de traitement, en se fondant sur les faits. Tout cadre de l'aide médicale à mourir devrait l'expliciter, pour éviter une assimilation des termes « résistant au traitement » et « irrémédiable ».
Pour terminer, je remercie encore une fois le Comité d'avoir bien voulu réfléchir à ces questions. Je serai heureux de répondre à ses questions.
:
Je vous remercie, monsieur le président.
Je remercie nos témoins d'être ici ce soir.
J'ai trouvé particulièrement encourageant de vous entendre parler ouvertement, en tant que professionnels, de vos préoccupations concernant la subjectivité des termes employés — « irrémédiable », « intolérable », « persistant ». Je crois que cela fait ressortir pour les membres du comité la gravité du sujet dont nous traitons et l'importance de l'étudier avec sérieux et de faire preuve d'une très grande prudence.
Au cours des dernières années, j'ai consacré une bonne part de mon temps aux questions qui touchent la santé mentale ainsi qu'à la prévention du suicide. Je sais que, depuis 1991, on a présenté au Parlement pas moins de 15 mesures législatives visant à autoriser le suicide médicalement assisté. Elles ont toutes été rejetées. Par contre, ces deux dernières années, le Parlement a fortement appuyé certaines mesures sur la prévention du suicide. L'Agence de la santé publique du Canada est actuellement en train d'élaborer un cadre fédéral de prévention du suicide en raison de l'adoption du projet de loi . En outre, aujourd'hui, l'initiative Bell Cause pour la cause est très populaire sur le réseau Twitter. J'ignore combien de milliers ou de millions de gazouillis ont été envoyés.
La société est préoccupée par la poursuite des efforts concertés en vue de prévenir le suicide. À mon sens, c'est paradoxal que des initiatives de prévention du suicide soient mises en place un peu partout au pays et par notre agence de la santé publique et que pourtant nous soyons en train d'examiner des façons de faciliter l'accès au suicide.
Il est très clair que le suicide médicalement assisté est un geste irréversible. Certaines des études sur la santé mentale illustrent bien que l'humeur des gens varie et qu'ils changent d'avis au fil du temps. Nous savons également que la dépression peut généralement être traitée et, comme vous l'avez souligné dans votre allocution, docteur Gaind, les taux de succès sont variables.
Pour ce qui est de donner l'accès aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ou de dépression, quelles protections supplémentaires le comité devrait envisager d'ajouter pour s'assurer qu'il protège certaines des personnes les plus vulnérables durant les moments les plus difficiles de leur vie?
:
Merci, monsieur le président.
Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à votre Parlement canadien.
On ne peut qu'apprécier la richesse et la densité de vos propos. Le débat est très relevé et nous en sommes tous gagnants. Cela démontre jusqu'à quel point ce dont on parle aujourd'hui et la raison pour laquelle nous réunis touche à un sujet qui est délicat. Il faut toujours garder à l'esprit que notre travail de législateurs est d'abord et avant tout de protéger les personnes les plus vulnérables. Nous ne sommes pas ici pour protéger ceux qui sont capables de se protéger tout seuls. Il faut garder à l'esprit que nous devons protéger les plus vulnérables.
Pourquoi est-on ici? Ce n'est pas pour savoir si l'aide médicale à mourir est bonne ou non. Ce n'est pas le débat. Le débat est de savoir comment adapter cette réalité au Code criminel canadien car la Cour suprême nous ordonne de le faire. Nous allons donc obéir à l'ordre des très honorables juges de la Cour suprême.
Dans cet esprit, il faut savoir que les soins de santé au Canada sont de compétence provinciale alors que le Code criminel relève du fédéral. Le gouvernement et la Chambre, en votant pour ou contre cette loi qui va lui être présentée, devront réaliser cet arrimage entre le pouvoir provincial et le Code criminel.
Je pose la question au deux groupes. Selon vous, ce que le gouvernement devra proposer devrait-il contenir des éléments très directifs s'adressant aux provinces ou, au contraire, le gouvernement devrait-il uniquement se concentrer sur le Code criminel?