PDAM Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
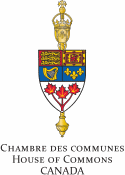
Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le jeudi 4 février 2016
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
Je déclare ouverte la 12e séance du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir. Il est bon de voir les membres du Comité. Je crois que nous avons le quorum.
Je remercie les témoins de s'être joints à nous aujourd'hui pour nous faire profiter de leurs conseils avisés et de leur expertise.
Nous avons quatre invités qui comparaissent aujourd'hui, dont deux qui proviennent du même organisme. Je propose que nous entendions d'abord ceux qui témoignent par vidéoconférence et Mme Somerville ensuite. Je propose que nous commencions en Alberta en souhaitant la bienvenue à Carmela Hutchison, la présidente du Réseau d'action des femmes handicapées du Canada.
Bienvenue, madame Hutchison. Vous disposez de 10 minutes. Nous nous rendrons ensuite à Vancouver et nous finirons par Mme Somerville.
Merci.
J'aimerais souligner que vous êtes réunis sur les terres ancestrales des peuples algonquins et que je m'adresse à vous depuis les terres ancestrales des Premières Nations du traité numéro 7. Comme cette séance est télévisée, je souhaite également saluer toutes les autres Premières Nations, les Inuits et les Métis de partout au Canada.
Je veux également exprimer ma reconnaissance aux employés du Centre Peter Lougheed, sans lesquels je n'aurais pas pu comparaître aujourd'hui, mais je veux surtout les remercier de m'avoir sauvé la vie.
En tant qu'intervenant, DAWN-RAFH Canada a défendu les intérêts des femmes handicapées et des femmes sourdes devant la Cour suprême du Canada dans plus de 12 affaires. DAWN-RAFH Canada a présenté des arguments juridiques au nom de femmes handicapées en s'appuyant sur les articles 7 et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne, ce qui a permis d'exposer le point de vue et de promouvoir les droits des femmes et des gens handicapés.
La mission du Réseau d'action des femmes handicapées du Canada est de mettre fin à la pauvreté, à l'isolation, à la discrimination et à la violence que vivent les femmes handicapées et les femmes sourdes. DAWN-RAFH Canada est une organisation qui travaille à l'avancement et à l'inclusion des femmes et des filles handicapées ou sourdes au Canada.
Pendant sa première année à DAWN-RAFH Canada, notre directrice exécutive nationale, Bonnie Brayton, et moi avons été alarmées par les propos de trois femmes qui nous avaient abordées parce qu'elles craignaient que des ordonnances de non-réanimation aient été prescrites de façon non appropriée pour des membres de leurs familles. Je suis à l'hôpital depuis le 18 décembre 2015 et je me suis fait approcher trois autres fois, en privé, par des femmes ayant des préoccupations semblables, y compris deux fois en l'espace de cinq minutes.
Le 23 décembre 2015, une amie qui me visitait aux soins intensifs a reçu un appel lui apprenant que son oncle, qui vivait dans un foyer et dont elle était la tutrice, était admis à l'hôpital. Lorsqu'elle s'y est rendue, les médecins lui ont dit qu'elle ne devrait pas envisager de traitement. Ils l'ont comparé à une vieille voiture dans laquelle il ne vaut pas la peine d'investir. Elle a insisté pour qu'il soit examiné, et il ne s'agissait que d'une simple infection des voies urinaires nécessitant une réhydratation et des antibiotiques.
Hier, une amie a raconté que son mari a été renvoyé chez lui plus d'une fois après s'être rendu à l'urgence alors qu'il subissait un accident vasculaire cérébral. Il a finalement été admis dans un hôpital où il a été traité pour une insuffisance cardiaque causée par un déséquilibre des liquides. Pourtant, les médecins ont fait pression sur son mari et elle pour qu'il ne soit pas traité. Après avoir convoqué le cardiologue, le déséquilibre de ses liquides a été corrigé, et il allait bien en moins de quatre jours.
Cinq minutes plus tard, on m'a fait parvenir le message d'une femme de la communauté qui a entendu parler d'un homme dont la femme souffrait d'un cancer du sein en phase terminale. Voici le courriel qu'il m'a demandé de vous lire: « Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé d'aider ma femme, Sylvia, parce qu'elle était trop pesante selon eux pour que les travailleurs de la santé puissent la soulever. Elle ne peut pas se servir de sa jambe et de son bras gauche. L'infirmier responsable est venu la voir pour lui expliquer la situation. Elle était fâchée et en pleurs quand je l'ai rejointe, et elle avait également peur. »
Les centres de soins palliatifs doivent fournir un soutien aux membres de la famille et aux aidants naturels, car on ne peut qu'imaginer les conséquences sur leur santé mentale.
Je suis chef de file nationale et provinciale dans le mouvement des femmes handicapées. J'ai également de l'expérience dans le mouvement pour la santé mentale et dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées. J'ai tout de même été traitée comme la prophétesse Cassandre, dont les prédictions se réalisaient, mais que personne ne croyait. En tant que femme ayant de multiples déficiences qui m'empêchent de suivre la plupart des programmes de traitement, et en tant que survivante de graves abus subis pendant l'enfance, ma peur de l'aide médicale à mourir est viscérale. Tous les membres du conseil de DAWN-RAFH Canada ressentent cette peur, comme beaucoup de nos collègues du secteur de l'aide aux personnes handicapées.
Lorsque le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, nous étions tous emballés et, pour la première fois, nous avons pensé que les choses s'amélioreraient pour nos gens, notamment grâce à l'article 6 qui met l'accent sur les désavantages auxquels font face les femmes et les filles handicapées. Vous pouvez imaginer notre surprise lorsque le Canada n'a pas ratifié le protocole facultatif. Ce n'était que le commencement.
Le Canada a ensuite effectué d'importantes compressions touchant tous les aspects des organisations et des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux au service des femmes. Puis, sans renforcer les ressources visant à réduire la violence, la disparité économique, la pauvreté accablante et les inégalités en matière d'éducation, ainsi que le manque de moyens de transport adaptés, de soins à domicile, de soins palliatifs, de soins de fin de vie, de logements adaptés et de soins de santé mentale, la Cour suprême du Canada, au nom des droits de la personne, nous donne la possibilité de mourir aux mains des mêmes médecins à qui nous sommes censés faire confiance lorsque nous avons besoin d'aide.
Nous n'avons pas la peine capitale dans notre pays et nous n'extradons pas les délinquants vers des pays qui imposent une telle peine, car nous craignons qu'une personne innocente soit exécutée par erreur et nous n'arrivons pas à concevoir de mécanismes adéquats pour éviter que cela se produise. Je trouve donc alarmant que, au nom des droits individuels, la Cour suprême croie que c'est possible.
L'affaire Carter c. Canada a donné lieu à une décision précipitée, ce qui a contraint les gouvernements et l'ensemble de la société canadienne à se prononcer rapidement sur des questions que les Canadiens n'ont pas eu le temps de comprendre ou de considérer pleinement. Le gouvernement du Canada doit recourir à la disposition de dérogation pour mettre un frein à l'aide médicale à mourir, car nous allons trop vite. Il n'y a pas suffisamment de procédures et de mesures de protection, ni de ressources offertes comme solutions de rechange. Aucune sphère de la société n'a eu l'occasion de vraiment réfléchir à ce qu'elle fait. Le Canada doit revoir son orientation.
Compte tenu des contraintes de temps, je vais commencer à présenter mes recommandations. Un mémoire a été soumis aux greffières et vous sera remis lorsqu'il aura été traduit.
Les soins à domicile et les soins palliatifs doivent faire partie de nos services de santé et être semblables partout au pays. Il faut éviter de diviser les gens en régions. Nous avons besoin de normes nationales. Tous les citoyens de notre pays doivent avoir accès à des soins de santé mentale avant qu'un seul dollar ne soit dépensé en vue de créer des comités d'examen pour l'aide médicale à mourir. Nous n'avons pas assez d'argent pour sauver les milliers de personnes qui se suicident chaque année et nous ne devrions donc pas dépenser un cent pour une industrie qui cherche à tuer nos gens. Les soins de santé mentale doivent être prodigués par des professionnels ayant une formation polyvalente qui porte sur la traumatologie, les dépendances et les handicaps. Nous devons être sensibles aux besoins des autres cultures en allant au-delà du point de vue occidental. Au sein de la communauté autochtone, la vie est considérée comme sacrée, et les enseignements soulignent ce caractère sacré. Pour de nombreux habitants de l'île de la Tortue, mettre prématurément fin à la vie revient à ne pas rendre hommage à l'expérience de la vie de la bonne façon. Il est essentiel d'examiner attentivement ces points de vue d'autres personnes.
Pour ce qui est des critères d'admissibilité, un système de réglementation national exhaustif est nécessaire pour protéger les personnes susceptibles de devenir victimes d'abus en recourant au suicide dans un moment de faiblesse. Les femmes handicapées doivent avoir consulté des groupes de soutien avant d'être admissibles à l'aide médicale à mourir. Les femmes sont particulièrement vulnérables compte tenu de situations sociales et économiques qui affaiblissent leur résilience.
Les femmes handicapées risquent encore plus d'être vulnérables étant donné que l'accent est mis sur la conformité pour ce qui est des aidants naturels ou des personnes dans une position d'autorité semblable. C'est particulièrement vrai en ce qui a trait à la déficience intellectuelle, pour les femmes qui ont éprouvé des problèmes de santé mentale et les survivants de traumatismes. De plus, les femmes handicapées sont plus à risque à cause de la violence et de la coercition. Elles craignent également davantage de devenir un fardeau pour les autres. Pour les femmes handicapées faisant partie d'organisations représentatives, les enjeux de la mise en place d'un système conçu pour éviter que les personnes vulnérables soient amenées à demander de l'aide médicale à mourir sont grands. Les adultes capables qui sont atteints d'une affection grave et irrémédiable à l'origine de souffrances persistantes et intolérables devraient être les seuls à pouvoir y recourir, et seulement dans les provinces qui offrent des soins palliatifs de qualité, des soins gratuits et toujours disponibles pour ceux qui y habitent. Les handicaps ne représentent pas en soi une affection grave et irrémédiable.
Les demandes d'aide médicale à mourir doivent être examinées et acceptées par un comité d'examen indépendant qui a suffisamment d'information pour déterminer si les critères nécessaires sont satisfaits. Les femmes handicapées constatent avec horreur que l'aide médicale à mourir est considérée comme une option. En ce qui a trait aux personnes âgées de moins de 18 ans, c'est très préoccupant à la suite de l'assassinat de Tracy Latimer.
Le gouvernement du Canada doit recourir à la disposition de dérogation pour mettre un frein à l'aide médicale à mourir. Nous allons trop vite; il n'y a pas suffisamment de procédures et de mesures de protection, ni de ressources offertes comme solutions de rechange. Aucune sphère de la société canadienne n'a eu l'occasion de vraiment réfléchir à ce qu'elle fait. Le Canada doit revoir son orientation.
Le Canada doit ratifier le protocole facultatif de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La convention doit être respectée, notamment les articles 4, 6, 10, 19, 25, 26, 28, 32 et 33. Chaque recours à l'aide médicale à mourir doit être conforme à ces articles. De plus, le Canada doit respecter la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il doit également examiner les complications et les avantages possibles.
Les gens doivent réfléchir à ce qui se passera si une personne se réveille après avoir reçu une dose mortelle de médicament. Qu’arrivera-t-il si la dose est administrée et qu’il est trop tard lorsque la personne change d’idée? Que se passera-t-il si une personne survit à une tentative d’aide médicale à mourir, mais devient encore plus handicapée qu’avant? Quelqu’un a-t-il réfléchi aux politiques et aux procédures qui pourraient être nécessaires si la première tentative échoue? Combien de tentatives devraient être effectuées avant d’établir un accès intraveineux, et que sera la marche à suivre si ce n’est pas possible?
Oui.
ll ne faut jamais recourir à l’aide médicale à mourir lorsque les valeurs de médecins sont imposées à un patient et à sa famille, comme dans l’affaire Golubchuk. Le Code criminel devrait être modifié de manière à ce que conseiller à une personne de se suicider, ou l’aider à se suicider, demeure une infraction au Code criminel, à l’exception de l’aide médicale à mourir lorsque la demande est acceptée.
Nous devons également savoir que les femmes handicapées n’ont souvent pas de médecins de première ligne. Lorsqu’elles reçoivent des soins actifs, il arrive souvent qu’elles ne soient pas vues régulièrement par le même médecin; il s’agit donc d’un autre point sur lequel se pencher.
Nous vous demandons de rester, car je suis certain que nous aurons des questions pour vous.
Rendons-nous à Vancouver, où se trouvent Margaret Birrell et Angus Gunn, qui sont respectivement présidente et avocat de l’Alliance of People with Disabilities Who Are Supportive of Legal Assisted Dying Society.
Distingués sénateurs et députés, nous vous remercions de nous offrir l’occasion de témoigner devant vous cet après-midi.
Je suis accompagné de Margaret Birrell, la présidente de l’Alliance of People with Disabilities Who Are Supportive of Legal Assisted Dying Society. Je m’appelle Angus Gunn, et je travaille comme avocat plaidant pour l’alliance depuis 2011. On m’a demandé de lire cet après-midi la déclaration qui a été préparée, et Mme Birrell sera heureuse de répondre aux questions des membres du Comité.
Les membres de l’alliance que je représente sont de grands défenseurs des droits des personnes handicapées au Canada et ailleurs. L’alliance a demandé et obtenu le statut d’intervenant auprès des trois niveaux d’instances judiciaires concernés dans l’affaire Carter pour défendre le droit qui a finalement été reconnu à la Cour suprême du Canada. Nous souhaitons aborder aujourd’hui cinq thèmes dans la déclaration que nous avons préparée, et dont une copie écrite sera remise aux greffières en temps opportun.
Le premier thème se rapporte à la question du mandat du Comité. L'alliance exhorte le Comité, lorsqu'il recommandera un cadre pour la réponse du gouvernement fédéral sur la question de l'aide médicale à mourir, à donner la priorité aux valeurs d'autonomie et de dignité des patients qui ont été décrites dans l’affaire Carter comme étant sous-jacentes à l’article 7 de la Charte des droits et libertés et à la sécurité de la personne.
L’alliance préconise également un engagement envers un fédéralisme coopératif, dans le cadre duquel les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada prennent des mesures législatives et non législatives pour formuler une réponse à l’affaire Carter centrée sur les patients et, dans la mesure du possible, uniforme.
L’alliance considère que la meilleure façon d’atteindre ces objectifs est d’offrir par étapes l’aide médicale à mourir au Canada. L’affaire Carter a souvent été décrite à votre Comité comme un plancher et pas comme un plafond. D’un point de vue pratique, la déclaration faite dans l’affaire Carter entrera en vigueur le 6 juin de cette année. Le plancher doit être en vigueur d’ici cette date, et une loi sera nécessaire d’ici quelques semaines.
L’alliance préconise de faire tout ce qui est nécessaire pour donner suite à la décision rendue dans l’affaire Carter, et elle préconise également un solide engagement à long terme en vue de déterminer où se situe le plafond —une question encore plus complexe qui ne fait l’objet d’aucun délai fixé par les tribunaux et qui mérite que l’on s’y attarde davantage avec le temps en préparant un livre blanc adéquat.
Le deuxième thème est celui du partage des compétences. Pour donner suite de manière coordonnée à l’affaire Carter, l’alliance estime que la structure idéale est un régime législatif fédéral minimaliste jumelé à des régimes provinciaux et territoriaux uniformes et exhaustifs. Dans le cadre de ce modèle, les modifications au Code criminel devraient être limitées de manière à ce qu’une aide médicale à mourir qui correspondrait autrement à la définition d’un crime ne soit pas assortie d’une responsabilité criminelle, dans la mesure où elle est conforme aux dispositions législatives de la province ou du territoire concerné. L’alliance favorise ce modèle parce qu’il n’est pas souhaitable que ces questions soient réglées à l’aide du droit pénal, qu’il s’agisse du Code criminel ou d’une loi distincte reposant sur le pouvoir fédéral en matière de droit pénal.
Dans l’affaire Carter, le droit à l’aide médicale à mourir est expressément conceptualisé en tant qu’aspect de l’autonomie d’un patient dans les décisions relatives aux soins médicaux. Les soins palliatifs et l’aide médicale à mourir devraient tous les deux être considérés comme faisant partie des pratiques exemplaires en matière de soins de fin de vie. Il s’agit donc de questions dont l’essence favorise l’initiative des assemblées législatives provinciales et territoriales.
L’alliance reconnaît les défis que présente l’atteinte de cet idéal, et elle craint elle aussi que cela donne lieu à des régimes disparates d’un bout à l’autre du pays. Cette préoccupation ne l’emporte toutefois pas sur les contraintes constitutionnelles avec lesquelles nous devons composer.
Un cadre global créé dans le cadre d'une loi criminelle fédérale traiterait ce qui constitue essentiellement une question relative aux soins santé comme une question de droit pénal et, à notre avis, il s'exposerait à des contestations constitutionnelles.
Si aucune loi ne s'applique dans la province ou le territoire dans lequel les mesures ont été prises, il faut combler ce vide, mais la création d'un régime fédéral global n'est peut-être pas la seule option. Il se peut que dans le domaine médical, des normes s'appliquant actuellement à d'autres décisions de fin de vie fournissent les orientations nécessaires. La plupart des collèges ont adopté de telles orientations ou sont en train de le faire. Autrement, des règlements du Code criminel pourraient peut-être désigner un cadre provincial ou territorial qui s'appliquerait s'il n'en existe pas dans la province ou le territoire dans lequel les mesures ont été prises.
Que ce soit un régime global fédéral ou provincial, notre organisation plaide pour le recours à des dispositions législatives secondaires en bonne partie, de sorte que le régime puisse évoluer plutôt qu'être codifié.
Les trois derniers sujets concernent des questions d'admissibilité et de processus, et ils s'appliquent, peu importe lequel des ordres de gouvernement met le régime global en place.
Pour ce qui est du troisième thème, il ne doit pas y avoir d'examen préalable d'un groupe d'experts. L'une des idées centrales de l'arrêt Carter, c'est le lien entre la dignité et l'autonomie, d'une part, et l'accès rapide à l'aide médicale à mourir, d'autre part. L'adoption d'un processus d'examen préalable d'un groupe d'experts pour l'accès à l'aide médical à mourir créerait des barrières et imposerait un fardeau. De plus, elle compromettrait, voire anéantirait, les droits reconnus dans l'arrêt Carter. Aller encore plus loin et exiger une ordonnance de la cour judiciariserait à tort ce que l'arrêt Carter a reconnu comme une décision éminemment personnelle dans le contexte d'une relation patient-médecin.
Ces risques prennent forme, par exemple, dans l'avis de pratique qu'a publié la Cour supérieure de justice de l'Ontario il y a six jours. Entre autres, on y indique que les deux procureurs généraux, fédéral et provincial, doivent être avisés d'une requête qui est déposée en vue d'obtenir une exemption, et il y est aussi question de signifier un avis à des membres de la famille également.
Ces acteurs ont-ils tous qualité pour s'opposer à la demande? Si c'est le cas, pourquoi? Des preuves par affidavit doivent être fournies non seulement par le requérant et son médecin traitant, mais aussi par un psychiatre et le médecin proposé pour l'aide médicale à mourir, s'il ne s'agit pas du médecin traitant.
Après combien de semaines la demande sera-t-elle entendue? Combien de temps faudra-t-il au tribunal pour se prononcer? Pourra-t-on faire appel de l'ordonnance du tribunal? Qui paiera pour les services des psychiatres et des avocats? Ces obstacles sont lourds, déraisonnables et contraires à l'arrêt Carter. La loi ne devrait pas obliger les gens qui ne souhaitent qu'éviter les souffrances causées par des problèmes de santé graves et irrémédiables à passer leurs derniers jours devant les tribunaux.
Concernant le quatrième thème, les directives préalables devraient être respectées. L'arrêt Carter reconnaît que les dispositions contestées du Code criminel privent les gens de leurs droits garantis par l'article 7, en partie en les forçant à choisir entre mourir prématurément ou souffrir jusqu'à ce qu'ils meurent de causes naturelles.
Notre organisation est d'avis que dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions concernant le plancher établi dans la décision Carter, il est essentiel de donner suite à des directives préalables si l'on veut éviter le spectre de la mort prématurée. Les demandes préalables à l'aide médicale à mourir devraient être valides lorsqu'elles sont présentées par un patient qui, au moment de présenter la demande, était apte et avait reçu un diagnostic d'affection qui était ou qui pouvait devenir grave et irrémédiable, incluant la démence.
Le cinquième et dernier thème, c'est l'objection de conscience. Selon l'arrêt Carter, rien dans la déclaration n'obligerait les médecins à dispenser une aide médicale à mourir. L'alliance soutient qu'un cadre global devrait permettre aux médecins de refuser de le faire, mais seulement d'une façon qui n'impose aucun fardeau sur les soins aux patients et qui assure la prestation de soins continus.
La protection du droit du médecin à l'objection de conscience ne doit pas empêcher un patient admissible à l'aide médicale à mourir d'y avoir accès. Inversement, si un médecin est disposé à fournir cette forme de soins de santé, aucun établissement de soins de santé ne devrait pouvoir l'en empêcher que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ses murs.
Encore une fois, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de vous présenter notre déclaration préliminaire et de participer aux travaux importants de votre Comité.
Je vous remercie de m'avoir invitée à comparaître devant votre Comité. Je tiens à préciser que, comme vous le savez peut-être, je crois que l’euthanasie et le suicide assisté par un médecin — ce que la Cour suprême appelle l’aide médicale à la mort ou l'aide médicale à mourir — sont foncièrement mauvais et devraient demeurer interdits par le droit criminel. Cela dit, je suis prête à fournir certaines recommandations visant à limiter les torts et les risques que pose la légalisation de l'euthanasie. Il est à noter que j'emploie le mot euthanasie pour désigner aussi bien l’euthanasie que le suicide assisté par un médecin.
La Cour suprême a reconnu que les valeurs que sont le respect de l’autonomie individuelle et le caractère sacré de la vie, surtout la protection des personnes vulnérables, étaient des prétentions opposées, et que toutes deux devaient être prises en compte. La Cour affirme que « [d]’une part, il y a l’autonomie et la dignité d’un adulte capable qui cherche dans la mort un remède à des problèmes de santé graves et irrémédiables [et que] [d']autre part, il y a le caractère sacré de la vie et la nécessité de protéger les personnes vulnérables ».
Autrefois, dans bien des sociétés, y compris au Canada, la religion était la principale institution chargée de faire respecter cette valeur qu'est le respect de la vie à l’échelle sociétale. Il est préférable de parler de respect de la vie plutôt que du caractère sacré de la vie parce que le respect de la vie n’est pas une valeur exclusivement religieuse. En effet, il s’agit d’une des valeurs fondamentales de toute société au sein de laquelle voudraient vivre les gens raisonnables. Cette valeur doit être respectée sur deux plans: d’une part, sur le plan de la vie de chaque personne prise individuellement et, d’autre part, au sein de la société en général.
Dans les démocraties occidentales laïques du XXIe siècle, comme le Canada, la médecine et le droit sont devenus les principales institutions porteuses de la valeur qu’est le respect de la vie pour la société prise dans son ensemble. La mort assistée par un médecin interpelle à la fois la médecine et le droit, et elle portera atteinte à la capacité de l’une et de l’autre à porter cette valeur qu’est le respect de la vie. Il en va de l’intérêt de tous les Canadiens que cette atteinte soit la moindre possible. Ainsi, j'ajouterais quelque chose à la question à laquelle vous m’avez demandé de répondre. Je vais lire votre question. « Quel cadre une réponse fédérale sur l’aide médicale à mourir devrait-elle avoir […] afin de respecter la Constitution, la Charte des droits et libertés et les priorités des Canadiens? » Voici ce que j’ajouterais à votre question « et causerait le moins de tort à la valeur qu’est le respect de la vie, aux professionnels de la santé et aux établissements de santé et présenterait le moins de risques pour les personnes vulnérables, aussi bien maintenant qu’à l’avenir ».
C'est avec cette question élargie en tête que j'ai formulé les propositions que j'exposerai maintenant à grands traits. Comme la Cour l’a clairement affirmé dans l’arrêt Carter, l’accès à la mort assistée par un médecin — l'euthanasie — à certaines conditions est une exception aux interdictions criminelles de l’homicide coupable et du suicide assisté. En dehors de cette exception très limitée, ces crimes demeurent interdits par la loi criminelle. Pour éviter la normalisation de l’euthanasie à l’avenir — comme cela s’est produit aux Pays-Bas et en Belgique, ce qui aurait des conséquences très graves pour les générations futures de Canadiens —, les dispositions législatives que vous adopterez devront indiquer très clairement que l’euthanasie est une exception et qu’elle ne devrait servir qu’en dernier recours, et rarement.
Si les décès par euthanasie représentaient le même pourcentage du total des décès au Canada que ce qu’ils représentent actuellement aux Pays-Bas et en Belgique — soit respectivement environ 4 et 4,6 % —, nous aurions chaque année entre 11 000 et 12 000 décès par euthanasie au pays. Je ne pouvais presque pas y croire lorsque j'ai fait ces calculs, et j'ai recommencé pour m'assurer que les données étaient bonnes, mais je crois que c'est le cas.
Pour contribuer à établir la clarté nécessaire concernant l'idée que l'euthanasie ne devrait servir que rarement, je suggère que la loi s’intitule « loi modifiant le Code criminel de manière à permettre une exception aux déclarations de culpabilité pour homicide coupable et suicide assisté ». Cela signifie, d’une part, que les gens qui ne se conformeront pas à la loi permettant l’euthanasie seront passibles de poursuites au criminel et, d’autre part, que la personne qui demandera l’euthanasie devra démontrer qu’elle remplit les conditions pour y avoir accès, c’est-à-dire que le fardeau de la preuve lui incombera. Cela concorderait avec l'objet législatif que la juge de première instance et la Cour suprême ont toutes deux préconisé, soit respectivement un « régime assorti d'exceptions, rigoureusement circonscrit et surveillé attentivement » et un « régime soigneusement conçu qui impose des limites strictes scrupuleusement surveillées et appliquées ».
Votre comité ne devrait avoir aucune hésitation à recommander exactement ce que la juge de première instance et la Cour suprême ont estimé nécessaire. En bref, l’euthanasie doit être traitée comme une intervention exceptionnelle très soigneusement encadrée à laquelle on a rarement recours. Toujours à l’appui de cette démarche, je vous rappellerais qu’entre 1991 et 2010, le Parlement a rejeté des motions et des projets de loi favorables au suicide assisté ou à l’euthanasie à au moins 12 occasions, de sorte que la légalisation de l’euthanasie est un changement d’idée sans précédent de la part du Parlement.
Vous m’avez demandé mon avis sur trois catégories de considérations: critères d’admissibilité, processus et procédures et réglementation des professionnels de la santé.
Concernant l’admissibilité, la première exigence, c’est que la personne qui demande l’euthanasie doit s’être vue offrir des soins palliatifs de grande qualité, notamment une gestion de la douleur parfaitement adéquate. Entre autres justifications, qu’il suffise de dire que ce critère correspond à une des exigences de la loi pour pouvoir obtenir un consentement éclairé à l’euthanasie. La personne doit être mentalement capable, et elle doit donner un consentement éclairé, et ce, jusqu’au moment où l’euthanasie est administrée. Cette exigence vise à protéger les personnes inaptes vulnérables, comme celles qui sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, et elle exclut la possibilité que le consentement soit donné par des décideurs de substitution. L’accès à l’euthanasie devrait être réservé aux personnes qui, d’une part, sont en phase terminale — et je dirais, dont l’espérance de vie ne dépasse pas quatre semaines — à cause d’une affection, d’une maladie ou d’un handicap et, d’autre part, éprouvent des souffrances physiques extrêmes. L’euthanasie ne devrait pas être permise pour les enfants qui sont incapables d’exprimer un consentement pour eux-mêmes. Quant à savoir si l’euthanasie devrait être accessible aux mineurs matures, il s’agit là d’une question distincte.
Pour ce qui est des processus et des procédures, deux médecins, dont l’un d’entre eux est un spécialiste du type de maladie dont la personne souffre, doivent chacun confirmer par écrit que la personne remplit les conditions nécessaires pour avoir accès à l’euthanasie et qu’on lui a offert toutes les autres interventions raisonnablement envisageables, y compris des soins palliatifs et une gestion de la douleur de grande qualité. Une consultation psychiatrique est requise pour exclure notamment les cas de dépression, de coercition, d’influence indue de la part d’autrui ou de contrainte, à tout le moins lorsqu’il y a la moindre possibilité que ces facteurs influent sur la demande d’euthanasie ou sur le consentement à celle-ci ou s’il y a le moindre doute quant à la capacité de la personne. Un juge de la Cour supérieure devrait certifier que toutes les exigences légales applicables à l’accès à l’euthanasie sont respectées. D’ailleurs, la juge en chef McLachlin préconisait justement cette exigence comme mesure de protection dans ses motifs dissidents dans l’arrêt Rodriguez, et bien sûr les cinq juges de la Cour suprême l’ont fait, il y a environ 10 jours, lorsqu’ils ont accordé au Parlement une prorogation.
L’euthanasie ne doit pas être administrée moins de 15 jours après qu’elle a été demandée. Un organisme national de recherche et de surveillance devrait être établi avec comme mission de recueillir des dossiers sur tous les cas d’euthanasie, d’enquêter sur les cas où il a pu y avoir non-conformité à la loi et d’établir un rapport, au moins une fois par année. J’ai beaucoup d’autres conditions, mais je vais les laisser de côté pour l’instant.
En ce qui a trait aux rôles et à la réglementation, depuis près de 2 500 ans, les médecins et la profession médicale reconnaissent que le suicide assisté et l’euthanasie ne sont pas des traitements médicaux. Cette position devrait être maintenue et ces interventions devraient demeurer en dehors de la médecine. Mon collègue, le Dr Donald Boudreau, et moi-même avons publié un article évalué par les pairs à cet égard. Je peux vous en donner la référence.
Par conséquent, une nouvelle profession devrait être créée pour la pratique de l’euthanasie. Les praticiens de l’euthanasie ne devraient pas être des professionnels de la santé, ou, s’ils le sont, il devrait s’agir uniquement de professionnels de la santé qui ne pratiquent plus du tout. Ces praticiens devraient être spécialement formés et agréés et devraient disposer des fonds nécessaires pour payer leurs dépenses liées aux déplacements afin d’assurer à tous, partout au Canada, l’égalité d’accès à l’euthanasie. Si cette démarche n’est pas adoptée, il y aurait lieu d’établir deux listes distinctes de médecins et d’établissements qui seraient accessibles au public: une liste des médecins et des établissements qui pratiquent l’euthanasie et une liste de ceux que ne le font pas.
Cela constitue un compromis raisonnable entre les Canadiens qui approuvent l’euthanasie et ceux qui s’y opposent ou qui la craignent. La Cour suprême a souligné que le droit à la sécurité de la personne garanti par la Charte comprend le droit d’être libre de toute crainte quant à ce qui pourrait nous arriver lorsque nous mourrons, chose qui semble souvent être oubliée en ce qui a trait aux gens qui craignent l’euthanasie.
Cette démarche réglera aussi la plupart des questions liées à la liberté de conscience. Il ne faut pas forcer les professionnels de la santé à pratiquer l’euthanasie ni à aiguiller des patients pour qu’ils reçoivent cette intervention si cela leur pose des problèmes d’ordre éthique ou de conscience.
Pour terminer, je veux vous dire que vous ne légiférez pas seulement pour le présent, vous légiférez pour des générations futures de Canadiens sur la façon dont ils mourront. Que nous approuvions ou non la mort assistée par un médecin, la légalisation du suicide assisté par un médecin et de l’euthanasie constitue un changement sismique dans nos valeurs les plus fondamentales en tant qu’individus et dans les valeurs les plus fondamentales de notre société.
Je crois que les générations futures considéreront en rétrospective la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie comme la décision la plus importante du XXIe siècle concernant les valeurs sociales, éthiques et juridiques. Les décisions que prendra le Parlement au sujet des dispositions législatives et réglementaires qui régiront ces interventions font partie intégrante de cette décision.
Merci.
Merci, monsieur le président.
Ma question s'adresse à Me Gunn.
On a souvent entendu divers intervenants dire que l'arrêt dans l'affaire Carter était une décision plancher, c'est-à-dire que l'aide médicale à mourir pouvait aller encore plus loin que dans l'affaire Carter. J'imagine que cet argument tient au fait que la Cour suprême a indiqué que les faits en l'espèce étaient les seuls faits analysés par la Cour pour rendre sa décision dans l'affaire Carter.
Selon vous, avec d'autres faits que ceux étudiés dans l'affaire Carter, comment feriez-vous pour déterminer l'âge d'un enfant mineur dit capable ou compétent?
[Traduction]
Je vous remercie de la question. Je vais répondre en anglais, si vous me le permettez.
Je vais répondre brièvement à la question et j'inviterai Mme Birrell à intervenir par la suite.
Tout d’abord, je crois que le député a bien cerné pourquoi l’arrêt Carter établit un plancher. La Cour suprême ne peut prendre de décision que sur la cause dont elle est saisie. Elle a pris sa décision dans le contexte de faits concrets très bien définis, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur d’autres causes que celles dont elle était saisie. La question qui se pose, comme je l’ai dit dans ma déclaration préliminaire, c’est de déterminer jusqu’où le principe de Carter s’applique. Pour les raisons que j’ai mentionnées, c’est une question incroyablement complexe — et le Comité le sait bien — et les choses devraient évoluer au fil du temps. Il n’est pas nécessaire de précipiter quoi que ce soit. La question n’est pas assujettie à l'échéance prescrite par la Cour, et elle mérite qu’on y accorde toute l’attention qu'un long processus permettrait d’y accorder.
Je peux vous dire que l'alliance est d'avis que l’accès à l’aide médicale à mourir devrait être réglementé en fonction de la capacité, et non de l’âge. Évidemment, à un certain âge, une personne n’est pas apte à consentir à recevoir l'aide médicale à mourir, mais notre organisation ne pense pas qu’il faut fixer un âge à cet égard. Encore une fois, au bout du compte, cela repose sur le jugement des professionnels de la santé traitants; c'est à leur discrétion.
Madame Birrell, voulez-vous ajouter quelque chose?
[Français]
Maître Gunn, comment interpréter la position que votre alliance a adoptée quand on lit, au paragraphe 127 de la décision, que l'un des critères pour demander l'aide médicale à mourir est que celui ou celle qui fait la demande doit être « une personne adulte capable »?
Comment peut-on parler de compétence et oublier l'âge?
[Traduction]
À vrai dire, je ne défends aucune position devant votre comité à cet égard. Ce que je dis, c’est que la décision Carter correspond à ce qui devrait être mis en oeuvre en ce moment, c’est-à-dire qu'on parle ici d'adultes capables qui sont pleinement en mesure de guider des fournisseurs de soins de santé.
La question qu’a soulevée le membre du Comité nécessite d’autres considérations de politique générale. Je vous ai dit quel sera le point de vue de l’alliance lorsque nous en serons là, mais cela ne constitue pas le fondement des observations que nous vous présentons aujourd’hui.
[Français]
Madame Somerville, lors de votre intervention, vous avez dit que l'aide médicale à mourir devait être une aide médicale de dernier recours. Comment conciliez-vous cette position avec l'arrêt dans l'affaire Carter selon lequel il faut se mettre dans les souliers du patient?
Selon vous, qui doit déterminer s'il s'agit bel et bien d'un cas de dernier recours, le patient ou les experts en santé?
[Traduction]
Pour répondre à la question, je dirais que la Cour suprême dit clairement que des conditions doivent s'appliquer à l’accessibilité de l’aide médicale à mourir, et il s’agit donc de les déterminer. Ce que je recommande, c’est que cette aide ne devrait servir qu’en dernier recours et très rarement, si l’on ne veut pas normaliser l’euthanasie. La « normalisation » signifie que c’est la façon dont la plupart des gens — ou un très grand nombre de gens —- mourront. Voilà pourquoi j’ai fourni les statistiques des Pays-Bas et de la Belgique et que j'ai expliqué ce que cela représenterait au Canada.
Je pense que la plupart des Canadiens seraient extrêmement préoccupés, pour employer les mots les plus modérés possible, et troublés si entre 11 000 et 12 000 Canadiens mouraient par injection létale administrée par des médecins chaque année.
Je remercie chacun des témoins d’être ici.
Madame Somerville, vous êtes professeure de droit à l’Université McGill, professeure de la faculté de médecine et la directrice fondatrice du Centre de médecine, d’éthique et de droit de la faculté de droit. Nous sommes donc très chanceux de vous accueillir aujourd’hui.
Vous avez indiqué que vous croyez qu’il est important d’offrir des soins palliatifs de qualité si on veut obtenir le consentement éclairé. Laissez-vous entendre qu’une personne ne peut donner son consentement éclairé si elle n’a pas fait l’expérience de souffrance psychologique et physique?
Si vous examinez les décisions de la Cour suprême, les deux causes principales où l’on a établi la doctrine — Reibl c. Hughes et Hopp c. Lepp — vous verrez que l’exigence est que le patient doit avoir été informé de tous les traitements raisonnablement indiqués pour la condition dont il souffre, ainsi que des avantages, des risques et des effets indésirables, ce qui englobe la possibilité de ne pas recevoir de traitement. Si le patient choisit de se faire traiter, les traitements devront lui être offerts. Autrement, le consentement du patient concernant le traitement qui lui est donné — en supposant ici qu’il est question de ce que j’appelle le « non-traitement de l’euthanasie » — ne serait pas considéré comme valide. On ne pourrait considérer qu’il y a consentement éclairé si le patient ne s’est pas vu offrir toutes les solutions de rechange raisonnables possibles.
Évidemment, on ne peut imposer ces solutions de rechange, mais sur les plans juridique et éthique, vous avez l’obligation de les offrir au patient. Étudiez les travaux du Dr Harvey Max Chochinov. Il y a d’excellentes recherches à ce sujet. Il est fréquent que des gens qui ont demandé l’euthanasie changent d’idée après qu’on leur ait proposé et des soins palliatifs de qualité et des traitements de la douleur adéquats.
J’ai mené beaucoup de travaux sur le sujet. En fait, j’ai fait de la recherche dans ce domaine pendant environ 35 ans. En 1993, on m’a demandé de prononcer l’allocution d’ouverture lors d’une conférence internationale sur la douleur, à Paris. J’ai proposé que l’accès à des traitements de soulagement de la douleur appropriés et pleinement adéquats soit un droit de la personne fondamental. Cela fait maintenant partie intégrante de ce qu’on appelle la « Déclaration de Montréal », qui a été adoptée en 2010. On y indique que le fait pour un professionnel de la santé de ne pas répondre avec célérité raisonnable à une personne qui souffre de douleurs aiguës constitue une violation des droits de la personne.
Merci.
J’ai une autre question.
Vous avez utilisé l’expression « respect de la vie ». Nous avons accueilli des représentants de Mourir dans la dignité trois fois. Dans leur dernier exposé, ils ont donné l’exemple d’une personne atteinte de la maladie Alzheimer en phase terminale. Ils ont indiqué qu’il est absurde d'obliger des gens à terminer leurs jours en vivant les affres associées à la phase terminale de la maladie d’Alzheimer et en restant alités pendant un an, avec une couche pour adultes. Pourriez-vous nous parler des aspects éthiques?
Ce qui me préoccupe, c’est que si nous disons que des personnes atteintes d’Alzheimer, peut-être de façon paisible, avec des soins palliatifs... Ne serait-ce pas porter atteinte à la dignité? Quel message envoie-t-on en disant qu’il est absurde qu’une personne vive ses derniers jours ainsi?
Cela soulève la question complexe et controversée de la définition de la dignité humaine.
Ce qui s’est produit, tant dans la littérature que dans les décisions des tribunaux, c’est que la notion d’exercice de l’autonomie a été assimilée à celle de la dignité humaine. Par conséquent, si vous perdez cette capacité d’être autonome — ce qui est le cas, par définition, si vous êtes atteint de la maladie d’Alzheimer — vous êtes alors considéré comme dépourvu de dignité.
À cet égard, l’approche des gens de l'organisme Mourir dans la dignité est de soustraire les gens de cet état, ce qui se fait évidemment par l’administration d’une injection mortelle. Il s’agit d’un appui à l’euthanasie.
L’autre concept de dignité, celui qui sous-tend la plupart de nos principes d’éthique et de droit, c’est que la dignité humaine est intrinsèque à l’être humain, et tant que vous êtes un être humain, vous jouissez de cette dignité et vous avez droit au respect au même titre que tout autre être humain. Le danger de ne pas accepter ce principe, c’est que quiconque ne satisferait pas aux critères établis de la dignité pourrait être éliminé.
C’est ainsi qu’on en arrive alors, par exemple, à l’euthanasie des nouveau-nés handicapés, à l’euthanasie des enfants... Peter Singer, par exemple, le philosophe de l’Université Princeton, croit que les parents ont le droit, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de trois ans, de décider de garder ou non un enfant handicapé. Il croit aussi qu’un enfant qui ne peut établir de liens avec d’autres personnes n’a pas droit aux protections associées à la dignité humaine.
C’est peut-être de l’autopromotion, mais je viens de publier un nouveau livre intitulé Bird on an Ethics Wire, dont le troisième chapitre — qui compte près de 40 pages — qui porte sur la notion de dignité humaine.
Merci.
J'aimerais d'abord remercier tous les témoins.
Madame Hutchison, vous qui représentez le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, je tiens à vous remercier au nom du Comité de nous avoir rappelé l'importance des déterminants sociaux de la santé, en mettant particulièrement l'accent sur les femmes vulnérables. Merci.
Messieurs les coprésidents, compte tenu du temps limité dont je dispose — cinq minutes —, j'aimerais, si je le peux, en utiliser une partie pour donner avis d’une motion pour que le Comité l'examine plus tard au cours de ses délibérations. Tous les points concernent la question des soins palliatifs, un sujet dont nous avons beaucoup entendu parler, et je m'attends à ce qu’ils reçoivent l’appui du Comité.
Les voici donc. Si vous me le permettez, j'aimerais lire l'avis au Comité.
La motion est la suivante:
Que, de l’avis du Comité, le gouvernement doit travailler avec les provinces et les territoires à un modèle souple et intégré de soins palliatifs en établissant le droit à des soins palliatifs universels et en mettant en œuvre une stratégie pancanadienne en matière de soins palliatifs et de fin de vie faisant l’objet d’un financement particulier.
Que, de l’avis du Comité, le gouvernement doit réinstaurer un Secrétariat aux soins palliatifs et de fin de vie faisant l’objet d’un financement particulier pour:
i. assurer la coordination entre les autorités de santé provinciales, territoriales et fédérale;
ii. établir des normes nationales claires;
iii. coordonner la recherche sur les soins de fin de vie et réunir des données uniformes et courantes;
iv. établir et contrôler des normes de formation pour tous les fournisseurs de soins de santé;
v. créer des mesures de soutien pour les patients et les aidants naturels;
vi. établir des recommandations pour des campagnes nationales de sensibilisation du public.
Que, de l’avis du Comité, le gouvernement doit mettre en œuvre une Campagne nationale de sensibilisation du public aux soins palliatifs et de fin de vie mettant l’accent sur la planification de l’aide en fin de vie.
Que, de l’avis du Comité, le gouvernement doit améliorer les services de soins de fin de vie dans le cadre des compétences fédérales en leur accordant le statut de services essentiels comprenant des services de soins palliatifs culturellement et spirituellement adaptés aux populations des Premières Nations, Inuits et Métis du Canada.
Et enfin:
Que, de l’avis du Comité, le gouvernement doit assurer plus de soutien aux patients, familles et aidants naturels dans la communauté, notamment en rendant la Prestation de compassion plus souple et accessible à tous les aidants naturels, et pas seulement à ceux dont un être aimé est sur le point de mourir.
Voilà l'avis de motion que je présente au Comité, si vous me le permettez.
J'ignore s'il me reste du temps pour poser une question.
Il vous en reste.
Je ferais simplement remarquer que ce sont probablement des avis de plusieurs motions.
J'ai une motion qui contient cinq parties, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il s'agit probablement de cinq motions.
Certainement.
Vous avez la parole pour encore deux minutes et 10 secondes; vous pouvez donc inviter les témoins à parler de cet avis de motion, que le Comité mettra aux voix plus tard, ou vous pouvez continuer de poser des questions.
Je pense que j'aimerais mieux poser des questions, merci.
J'aimerais interroger M. Gunn et Mme Birrell.
Merci beaucoup de comparaître aujourd'hui. Pour donner suite à quelque chose que vous avez dit, monsieur Gunn, jusqu'à quel point pouvons-nous nous permettre d'avoir une réponse minimaliste en l'absence de lois provinciales?
Je me préoccupe à cet égard. Vous parlez d'une réponse exhaustive, il me semble. Je me demande si vous avez réfléchi à l'ampleur que pourrait vraisemblablement avoir notre intervention en vertu du pouvoir du droit pénal afin de réaliser ce que nous allons chercher à accomplir.
Merci de cette question.
Dans mes notes d’allocution, j'ai indiqué que la mise en oeuvre de l'arrêt Carter comme tel — lequel, comme nous l'avons fait remarquer, se limite aux faits en l'espèce — pourrait s'effectuer en apportant des modifications somme toute légères aux dispositions 14 et 241b), qui ont été contestées. Advenant que l'aide médicale à mourir soit offerte dans une province qui n'a pas encore adopté de cadre exhaustif et que le gouvernement fédéral a eu une intervention minimaliste, comment ce vide pourrait-il être comblé?
Dans mes notes d’allocution, j'ai proposé que les lignes directrices et les normes existantes de la profession médicale en matière de prise de décisions en fin de vie comblent le vide créé par l'absence d'une intervention de la province. À l'évidence, il serait préférable que la province adopte un cadre solide, mais dans le cas contraire, je crois que cette solution de repli vaudrait mieux qu'une réponse fédérale hâtive mise en oeuvre en appliquant le pouvoir du droit pénal fédéral.
Je demanderai à Mme Birrell si elle souhaite intervenir.
Je me suis montré un peu généreux envers les autres membres. Vous pouvez continuer si vous le voulez.
Si vous m’y autorisez, alors je poserais une autre question.
Monsieur Gunn, si nous adoptons une approche progressive, comme vous l'avez préconisé, quels sont les points que nous devrions remettre à plus tard? Vous avez parlé des mineurs matures. Quels autres sujets devrions-nous garder pour plus tard, selon vous?
Permettez-moi d'aborder la question de l'angle contraire et de vous dire ce dont nous devrions nous occuper maintenant: c'est ce qui est urgent, c’est-à-dire l'arrêt Carter; ce serait donc les patients adultes qui sont dans toutes les situations figurant dans cet arrêt. Voilà ce qui importe pour l’instant. Je pense que tout le monde conviendra qu'il s'agit de questions qui méritent un processus exhaustif, et, bien que ce ne soit la faute de personne, on ne peut agir dans le cadre des contraintes avec lesquelles nous devons composer. Le Comité pourrait faciliter les choses en mettant en oeuvre ce qui doit l'être maintenant et en s'occupant de chaque chose en temps opportun.
Merci monsieur le président. Merci à tous de témoigner aujourd'hui.
Monsieur Gunn, j'aimerais continuer sur le sujet de l'interprétation minimaliste que vous nous avez présentée en répondant aux questions de M. Rankin.
La Cour suprême n'a pas défini les termes de maladie « grave » et « irrémédiable ». Certains nous ont affirmé que des définitions strictes pourraient avoir des conséquences imprévues. Comment nous conseilleriez-vous de définir ces termes?
Merci de cette question.
Je crains moi aussi que le fait de tenter de codifier une définition de ces termes finira par avoir des effets préjudiciables. Il ne fait aucun doute qu'avec les progrès de la médecine, ce qui constitue une maladie grave et une maladie irrémédiable changera avec le temps. Si on tente de codifier ces définitions dans la loi, elles finiront, au fil du temps, par inclure trop ou insuffisamment de gens dans le groupe qui devrait pouvoir se prévaloir du principe établi dans l'arrêt Carter.
À mon avis, ces définitions devraient être laissées là où elles sont actuellement et continuer de relever de la discrétion des médecins traitants en vertu des lignes directrices applicables du collège.
D'accord, merci.
Toujours dans la même veine, j'aimerais vous interroger au sujet de la définition d'« adulte ». Nous avons tous parlé de l'accès uniforme à l'échelle du pays, et nous avons entendu dire qu'il importe de recommander une définition claire de l'âge requis afin d'assurer une application et un accès uniformes et cohérents dans toutes les régions du pays. Comment définiriez-vous un « adulte »?
Je considère qu'il est très important d'appliquer les mêmes critères d'accès à l'aide à mourir aux personnes mineures compétentes. Les normes devraient être les mêmes. Je ne pense pas qu'on puisse établir une limite d'âge ou déterminer l’âge qui convient ou ne convient pas. Il faut soumettre la personne qui revendique le droit de mourir aux mêmes procédures et aux mêmes critères qu'un adulte pour déterminer si elle est réellement compétente, si elle connaît les options qui s'offrent à elle et si elle n'est pas persuadée par quelqu'un d'autre. Ce serait les mesures de protection à appliquer, et ce sont les mêmes qui s'appliqueraient à un adulte.
Même s’il en découle des interprétations différentes dans les diverses régions du pays, cela ne vous troublerait pas.
Ce que je veux dire, c'est que vous nous avez indiqué que vous souhaiteriez une approche minimaliste, dans le cadre de laquelle les provinces pourraient adopter leurs propres lois dans la mesure où ces dernières équivaudraient à la loi fédérale. Cela pourrait toutefois faire en sorte que l'accès diffère considérablement d'une région du pays à l'autre.
J'en conviens. Je pense que c'est la raison pour laquelle M. Gunn a indiqué que nous devons établir le plancher maintenant. Nous devons pouvoir en discuter, puis commencer à travailler aux autres aspects de l'aide médicale à mourir.
Je pense que nous ne pouvons attendre, mais nous ne pouvons pas non plus régler précipitamment une liste de points à moins que nous ne disposions d'un plancher, de définitions et de mesures de protection.
Merci aux témoins de comparaître. Cela nous aide grandement.
Je veux continuer d'interroger M. Gunn sur les mêmes points que la sénatrice Seidman et M. Rankin ont abordés, c'est-à-dire la différence entre votre approche, un cadre fédéral minimaliste appuyé par ce que vous avez qualifié de régime provincial exhaustif et uniforme, et la solution proposée par M. Hogg, qui considère que la meilleure manière de procéder consisterait à établir un solide régime fédéral et à laisser aux provinces le soin de le respecter. Si elles peuvent élaborer un régime équivalent, l'autorité fédérale pourrait alors décréter qu'il est équivalent, et les règlements et le régime provinciaux s'appliqueraient dans cette province.
Il considérait que c'était la seule façon d'assurer l'admissibilité pancanadienne, l'égalité de l'accès et l’application de mesures de protection équivalentes à l'échelle du pays. Il a expliqué que nous ne devrions pas présumer que toutes les provinces adopteront des lois en réaction à l'arrêt Carter ou que ces lois seront conformes à ce que vous préconisez, c'est-à-dire exhaustives et uniformes.
Pourquoi adoptez-vous une approche différente de celle de M. Hogg et pourquoi votre approche permettrait-elle de mieux s'acquitter de ces trois rôles, qui consistent à assurer l'admissibilité, la qualité de l'accès, et l'égalité ou l'équivalence des mesures de protection à l'échelle du pays, d'un océan à l'autre?
Merci de me poser la question.
La proposition présentée aujourd’hui s’appuie sur la réalité des contraintes constitutionnelles dans le cadre desquelles le présent débat se déroule. M. Hogg — et j'ai le plus grand respect pour lui et son érudition — est d'avis que le Parlement fédéral pourrait adopter un régime de réglementation exhaustif en exerçant le pouvoir du droit pénal. Selon moi, cette approche serait inappropriée et pourrait faire l'objet d'une contestation en vertu de la Constitution parce qu'elle constituerait un abus du pouvoir du droit pénal.
Je pense que la recommandation de M. Hogg a une certaine élégance architecturale, mais l'adoption de ce cadre est, à mon avis, problématique du point de vue des compétences constitutionnelles. Je préconise pour ma part un cadre qui est plus susceptible de résister à un examen de sa constitutionnalité, tout en étant applicable. Il pourrait entraîner quelques inégalités; je pense qu'il faut le reconnaître. Mais le modèle adopté doit pouvoir résister à un examen de la constitutionnalité.
Je veux passer à la question des directives préalables. Vous connaissez les recommandations formulées par le groupe de témoins provincial-territorial sur les divers niveaux et les différentes catégories. Considérez-vous que, sur le plan des directives préalables, il doit y avoir compétence, non seulement au moment de la demande initiale, mais aussi à celui où elle est honorée? Êtes-vous de cet avis?
Je laisserai Mme Birrell compléter ma réponse, mais je dirais non. À ce sujet, on a donné l'exemple de la démence, dans lequel le patient en fin de vie n’aurait vraisemblablement pas la capacité décisionnelle de donner un consentement éclairé. Cependant, si ce patient, qui a à tout autre égard satisfait aux critères, a donné une directive préalable, cette dernière devrait être respectée.
Vous voulez dire même si le patient a perdu, comme ce serait le cas dans la situation présente, la capacité entre l’exécution initiale de la déclaration et le moment où l'aide est donnée. Est-ce exact?
La question suivante s’adresse également à M. Gunn.
Dans son exposé, Mme Hutchison a indiqué que son groupe préconise l'invocation de la clause dérogatoire. Avez-vous une opinion à ce sujet?
Je considère qu’à titre de conseiller de l'alliance, il ne m’appartient pas d’aborder le sujet. À mon avis, le gouvernement a indiqué son intention de respecter l'esprit et la lettre de l'arrêt Carter. Dans la mesure où cet engagement a été pris, il semblerait incompatible d'invoquer la clause dérogatoire.
Madame Hutchison, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre avis et celui de votre groupe au sujet de cette invocation?
Le fait est que les gens n'ont pas envisagé toutes les implications. Même si l'intention consiste à laisser doucement les gens entamer leur dernier sommeil, si j’étais sur le point de rendre mon dernier souffle, alors, qu'on utilise des moyens biologiques, mécaniques ou chimiques, l'euthanasie est toujours une forme de violence. On exerce de la violence, et nous devons réfléchir très soigneusement à la question.
L'arrêt Carter n'établit pas un plancher, mais un toboggan qui dévale une pente extrêmement glacée et glissante. À titre de Canadiens, nous devons en être conscients. Notre pays n'applique pas la peine capitale, mais nous nous apprêtons à condamner à mort des gens qui sont malades et qui sont fragilisés par l'absence d'aide et de ressources adéquates pour les personnes handicapées...
Puis-je vous interrompre pour poser une autre question? Veuillez m'excuser, mais je veux vous donner l'occasion de faire un commentaire à ce sujet, car nous avons entendu le témoignage d'autres groupes représentant des personnes handicapées et de témoins handicapés eux-mêmes, lesquels se sont dits préoccupés au sujet de l'autonomie des patients. Nous discutons du fait qu'il s'agit d'une demande et d'un droit constitutionnel de l’intéressé. La personne réclame le droit de mourir.
Comment expliquez-vous cette divergence d'opinions?
Pour l'expliquer, nous avons dû nous poser beaucoup de questions, personnellement et collectivement. Comme Carter était une femme handicapée, allons-nous nuire à nos soeurs handicapées?
Le fait est que ces décisions et ces commentaires se fondent sur de la discrimination fondée sur la capacité physique, ce qu'on appelle le capacitisme. Le capacitisme est comme du racisme contre les personnes vivant avec un handicap. On aborde la question d'un angle capacitiste: je ne peux pas supporter l'idée d'être incontinent, d'être gros, d'être dépendant, mais en réalité, nous sommes tous interdépendants.
Je doute fort que les appelants dans l'affaire Carter fassent eux-mêmes leurs changements d'huile, le câblage de leur maison ou leur plomberie. Ils dépendent d'autres personnes pour certaines tâches dans la vie, comme c'est notre cas à tous.
Ne serait-ce que pour rendre ce témoignage possible, j'ai dû dépendre de techniciens, obtenir une permission de l'hôpital, et l'infirmière en chef a dû faire des démarches et obtenir toutes les approbations requises pour que je puisse venir vous parler aujourd'hui. J'ai aussi dû dépendre d'infirmières pour m'aider dans mes fonctions corporelles, afin de pouvoir venir ici.
L'autonomie...
Je vous remercie beaucoup, madame Hutchison, mais n'est-ce pas là exactement ce dont il s'agit? N'est-ce pas un choix que vous faites? Seriez-vous prête à refuser cette liberté de choix à d'autres, la liberté même qui vous permet de choisir quels soins vous recevrez?
En fait, au paragraphe 127 de l'arrêt...
... il est écrit: « il convient d'ajouter que le terme “irrémédiable” ne signifie pas que le patient doit subir des traitements qu'il juge inacceptables. » Diriez-vous que la personne a ce choix?
Je pense qu'ils n'ont pas examiné la question du choix de façon réaliste. Je pense que parfois, tant qu'on n'a pas été exposé à une situation, on l'imagine bien différemment de quand on la vit... La première fois où j'ai eu besoin d'assistance physique pour faire certaines choses, j'étais très frustrée, mais j'ai ensuite réussi à m'adapter, et avec l'aide d'autres personnes handicapées comme moi, j'ai réussi à faire beaucoup d'autres choses.
Je fais toujours beaucoup, beaucoup de choses, ne serait-ce que de vous parler, de parler de tout ce qui touche des millions de personnes, depuis mon lit d'hôpital. Je pense qu'il faut présenter cette perspective. Je pense qu'il faut encourager les gens, dire aux Canadiens que la vie compte, même lorsqu'on est atteint de démence et que sa dignité est compromise.
Merci, madame Hutchison. Nous avons un peu dépassé le temps imparti.
Je vais maintenant donner la parole à M. Cooper.
Carmela, j'aimerais vous remercier de nous présenter toute votre vulnérabilité et de nous consacrer de votre temps. C'est vraiment un plaisir que de vous entendre. Ma question s'adresse à vous, je ne sais pas si vous pourrez y répondre.
Je sais que la plupart des personnes souffrant d'un handicap traversent une période de deuil et de dépression profonde pendant laquelle elles peuvent même avoir des pensées suicidaires. Il faut du temps pour s'adapter à un handicap, bien sûr, et la plupart de ces personnes finiront par découvrir qu'il y a aussi des habiletés qui viennent avec le soi-disant handicap, des habiletés qu'elles n'avaient peut-être pas avant, et c'est ce qui donne un nouveau sens à la vie, de la dignité, du respect et de la valeur, si l'on veut.
Dans ce contexte, Carmela, j'aimerais si possible que vous m'expliquiez quelles mesures de protection vous sembleraient appropriées pour éviter qu'on euthanasie inutilement ces personnes.
Rien ne peut nous en protéger. J'ai fait des recherches sur les mesures possibles de la vulnérabilité, des indices ou... Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme infirmière en santé mentale. Comment peut-on éviter la coercition? Comment peut-on garantir que...?
Je suis très inquiète, particulièrement pour les jeunes, parce que même moi, j'ai dû m'adapter à mon handicap au début. J'ai rampé pendant des années en me disant que je ne voulais pas d'intervention. Un jour, je suis allée voir mon médecin, j'ai le même médecin depuis 1989, et je lui ai dit: « Je ne veux rien. » Il m'a dit: « Carmela, je n'accepterai pas cela. Vous n'avez que 38 ans. »
Cela a été ma première prise de conscience, c'est la première fois où je me suis rendu compte que ma vie valait quelque chose. J'ai laissé l'idée faire son chemin puis j'ai préparé des directives personnelles. Je me disais que comme Dieu a créé le monde en sept jours, je pourrais peut-être laisser les gens venir me dire au revoir, puis mettre fin à tout cela. J'ai toujours ces directives. J'étais en train de les réviser lorsque, de manière ironique, j'ai attrapé une pneumonie, qui m'a menée à l'urgence, puis aux soins intensifs. C'est la raison pour laquelle je suis toujours hospitalisée. Je suis ici depuis le 11 décembre.
Pendant tout ce temps, j'étais terrifiée. J'avais très peur d'être admise aux soins intensifs à cause de l'arrêt Carter, mais aussi parce que je cheminais dans ma réflexion. Je me suis jointe au réseau d'entraide. Je suis entrée en contact avec d'autres personnes handicapées. J'ai souffert de beaucoup de problèmes médicaux, et il y a des gens qui m'ont dit que parce que j'ai eu un traumatisme crânien, je ne peux pas recevoir de traitements de réhabilitation. Je ne peux pas recevoir d'ergothérapie.
J'ai une autre question à vous poser, très rapidement.
Compte tenu de ce que vous venez de nous dire, pourriez-vous nous aider à comprendre quels droits de la personne nous allons vous enlever en voulant donner certains droits à d'autres personnes au Canada?
C'est ce que j'essaie de vous expliquer.
Il y a des critères d'exclusion, les gens doivent pouvoir... Nous vivons à l'ère de Google. De nos jours, on peut communiquer par voie électronique avec des professionnels de la santé, afin de collaborer et de trouver ensemble des solutions aux problèmes. Mais au lieu de cela, nous nous plaignons qu'il y a trop d'information, tellement que les gens n'essaient même pas de la trouver.
J'en étais rendue à un point — et je tiens à le dire, parce que c'est là où toutes les complications entrent en jeu. Les techniciens de laboratoire n'arrivaient pas à trouver de veine. Ils ne pouvaient pas prélever d'échantillons, donc ils ont refusé de venir. Qu'est-ce qui arrive quand une personne demande l'euthanasie? Ils ne pouvaient pas venir. Personne ne pouvait installer de dilatateur, parce qu'il n'y avait anatomiquement pas assez d'espace. J'ai été intubée et j'ai passé deux semaines éveillée avant qu'il y ait assez d'espace pour que je sois intubée. Il y a beaucoup d'exemples du genre. Je n'ai pas eu accès à des traitements de réhabilitation pour traumatisme crânien au début de ma maladie parce que je souffre d'une maladie mentale. Il y a beaucoup d'exclusions. Ces critères d'exclusion doivent disparaître. Certaines recommandations sont irréalistes. De penser que oh! le médecin de famille va avoir cette conversation avec la personne, il va lui tenir la main jusqu'à la fin et tout et tout... Non. J'ai le même médecin de famille depuis 1989. J'ai probablement vu 10 ou 15 médecins, parce qu'il y a l'intensiviste, l'hopitaliste, tous les médecins en réhabilitation... J'ai rencontré différents médecins en cours de route. Donc l'idée selon laquelle...
J'essaie de me dépêcher, mais je suis systématiquement interrompue. J'aimerais terminer de répondre à au moins une question.
Nous avons des contraintes de temps, parce que nous avons plusieurs questions à poser et plusieurs témoins.
Je suis désolé. Merci beaucoup.
Nous allons passer à la sénatrice Nancy Ruth.
Je m'adresse aux représentants de l'Alliance of People with Disabilities. Je comprends que vous voulez que nous jetions les bases de ce que recommande l'arrêt Carter; vous voulez que le gouvernement s'engage de manière robuste à établir un plafond et vous voulez que nous adoptions un livre blanc. Je ne vois pas pourquoi. Nous avons un rapport provincial-territorial. Nous avons le rapport du comité externe. Nous avons entendu de très nombreux témoins sur divers enjeux et idéologies, de nature religieuse, juridique, médicale et tout. Plus de 15 000 personnes ont répondu au questionnaire du comité externe.
Que cette discussion ajouterait-elle selon vous pour nous convaincre que nous ne devons pas nous orienter vers l'établissement d'un plafond?
J'accepte toutes les observations de l'honorable sénatrice. Nous n'avons pas encore de projet de loi. La réalité est telle que nous attendons toujours que cette montagne de données — et je reconnais que la tâche est gigantesque — se traduise par une loi concrète et franchisse l'étape fondamentale du processus législatif. Je ne veux critiquer personne. Il me semble inévitable que ce processus prenne du temps. Cela dit, quand nous pourrons nous concentrer sur un projet de loi, il sera alors approprié et souhaitable de fournir au public l'occasion de l'examiner et d'y réagir. Ce n'est tout simplement pas possible, sauf de façon très minime, dans le peu de temps dont le Comité dispose.
C'est évidemment la fonction du Parlement lorsqu'un projet de loi est déposé, à la Chambre des communes et au Sénat, il doit faire l'examen public du projet de loi.
Avez-vous lu les trois projets de loi qui ont été déposés à la dernière législature, tant à la Chambre des communes qu'au Sénat? Le cas échéant, avez-vous des commentaires à exprimer à leur égard?
Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question, et je pense que Mme Birrell non plus.
Très bien.
Avez-vous des recommandations à nous faire sur les mécanismes de protection que nous devrions intégrer à la relation entre le médecin et le patient dans le contexte de l'aide médicale à mourir?
Vous pourriez envisager que la personne doive obtenir l'avis de deux médecins. Les deux devraient avoir rencontré la personne. S'il était convenu que la personne doit avoir une discussion en profondeur avec deux médecins, ce serait la base. Cette règle permettrait à la personne qui en fait la demande de changer d'idée. Ce serait aussi notre garantie qu'elle ne prend pas cette décision sous la pression d'autres personnes.
Regardons un peu la décision rendue par la Cour supérieure de l'Ontario il y a six jours. Les juges recommandent qu'en guise de protection, la famille et les amis de la personne fassent partie de la conversation. Où se situe la personne qui souhaite recevoir de l'aide médicale à mourir quand toutes ces barrières structurelles s'érigent devant elle? Je n'ai jamais vu autant d'intrusion détaillée dans les droits de la personne que j'en vois dans cette opinion de la Cour supérieure.
Les mécanismes de protection devraient être très, très simples. Il suffit de les établir. Aucun médecin ne devrait avoir l'obligation d'administrer de l'aide médicale à mourir. C'est un mécanisme facile à mettre en place. Il ne devrait pas y avoir d'exclusion des centres de santé ou des hôpitaux ou d'autres établissements où les médecins souhaitent administrer les médicaments. C'est le genre de règle qui pourrait être mise en place et qui constituerait une protection. Aucune pression ne devrait s'exercer sur la personne...
Personne ne veut — en tout cas je ne veux pas — forcer quiconque à le faire, qu'on pense aux patients ou aux médecins, mais vous avez lancé l'idée que la personne consulte deux médecins (et je présume qu'il y aurait un formulaire de consentement) et qu'elle ait le droit de changer d'idée. Avez-vous une période d'attente en tête quand vous dites cela? Quand une personne consent pour la première fois à le demander, voudriez-vous qu'il y ait un délai de quelques jours, disons, puis qu'elle doive réaffirmer sa volonté? À quoi pensez-vous?
Je pense que quand une personne donne des directives de soins anticipées, elle peut changer d'idée, et c'est très bien, mais quand la personne est allée jusqu'à rencontrer deux médecins qui n'ont pas subi de pression mais qui sont prêts à l'aider, qu'elle a fait les consultations voulues, il ne reste probablement plus que très, très peu de temps avant la fin.
Monsieur le président, je m'excuse aux deux témoins précédents, mais j'ai dû rester au Sénat pour les débats, si bien que j'ai raté leurs exposés. Bien sûr, j'ai écouté attentivement chaque réponse aux questions de mes collègues. Malheureusement, madame Somerville, je n'étais pas présent au moment de votre témoignage, mais j'ai lu avant la séance l'éditorial que vous avez publié dans The Globe and Mail le 27 octobre 2015, et j'ai entendu la dernière phrase de votre exposé. Si je peux citer la dernière phrase de votre éditorial, je pense qu'elle se rapproche beaucoup de votre conclusion. Vous estimez, et je vous cite, qu'il faut protéger:
... toutes les personnes vulnérables parmi nous en défendant le « respect de la vie » (un terme préférable au « caractère sacré de la vie ») dans la société en général.
Je crois comprendre que vous maintenez cette position fondamentale.
Très bien, donc je me sens plus sûr de moi pour vous interroger. Je vous remercie d'écrire, parce qu'il est très difficile de lire ce que vous écrivez.
J'essaie de comprendre le concept du « respect de la vie », mais n'est-ce pas un terme codé dans différentes religions, chargé de différentes croyances ou de diverses interprétations? Dans certaines religions, par exemple, les gens croient que la peine de mort est acceptable pour le meurtre d'un policier dans l'exercice de ses fonctions, et c'est la même chose pour un soldat. D'autres croient que l'avortement est acceptable pendant une courte période, mais pas après. Enfin, il y a d'autres religions qui accepteraient l'idée de l'aide médicale à mourir, entre autres.
Autrement dit, le concept du respect de la vie peut être interprété de différentes façons. Il peut avoir un caractère religieux. Il peut n'avoir aucune connotation religieuse. Il y a des gens qui défendent le respect de la vie même s'ils ne croient en aucun dieu. Je dirais qu'il est difficile de vous suivre quand vous utilisez ce terme, parce qu'il ouvre la porte à beaucoup d'interprétations. D'une certaine façon, je préfère la proposition que la Cour suprême a avancée presque au même moment où vous avez publié votre article, dans l'affaire du Mouvement laïque québécois, au Québec. Je suis certain que vous en avez pris connaissance. J'aimerais vous citer trois lignes de cet arrêt de la Cour suprême, qui illustre mon dilemme quant au concept du respect de la vie: « Un espace public neutre, libre de contraintes, de pressions et de jugements de la part des pouvoirs publics en matière de spiritualité, tend à protéger la liberté et la dignité de chacun... »
J'ai l'impression que toute la difficulté est là pour ce qui est du concept de l'aide médicale à mourir. L'État n'oblige personne à l'imposer. Un médecin est libre de l'exercer ou non; la personne qui estime que c'est contraire à ses croyances ne sera pas obligée d'en recevoir. La protection de personnes vulnérables: nous acceptons cela. Comment pouvons-nous concilier votre conception du respect de la vie...
Dans l'histoire, si l'on analyse les situations dans lesquelles il a été accepté qu'on mettre fin à la vie, et je parle ici de sociétés civilisées, de sociétés auxquelles nous pouvons nous comparer au Canada, ce sont toutes des situations dans lesquelles il a été jugé nécessaire de retirer la vie pour préserver la vie humaine. C'est d'ailleurs le juge de première instance qui a donné l'exemple de l'autodéfense dans l'affaire Carter: il est possible de tuer une personne sans en subir de sanctions judiciaires dans le contexte de l'autodéfense, lorsque c'était nécessaire pour sauver la vie humaine de personnes innocentes. C'est la même chose dans le contexte de la guerre juste. À l'origine, c'était la même chose pour l'avortement: il visait à sauver la vie de la mère. C'est la même chose pour la peine capitale, parce qu'on croyait que si une personne en avait tué une autre une fois, elle le ferait de nouveau.
Le respect de la vie n'est pas qu'un concept religieux. La religion a déjà été utilisée pour le défendre — et je le dis dans mon exposé — mais ce n'est fondamentalement pas seulement un concept religieux.
Le meilleur ouvrage à ce sujet est celui de Jürgen Habermas, le philosophe allemand, qui explique qu'il s'agit d'une valeur fondamentale de toute société dans laquelle on veut vivre. La question est donc la suivante: est-ce que le fait de légaliser les actes par lesquels les médecins tueraient leurs patients, pour dire les choses crûment, parce que c'est ce dont il s'agit, déroge à la valeur du respect de la vie de la société en général à un point tel que nous ne devrions pas les légaliser, même si on peut comprendre pourquoi une personne le voudrait et même si elle exerce sa pleine autonomie.
Premièrement, parce que je crois qu'il y a d'autres manières bien établies pour atténuer les souffrances d'une personne, je soutiens que le professionnel de la santé qui laisse une personne en grande douleur contrevient à ses droits de la personne. D'ailleurs, divers organismes compétents le reconnaissent, comme l'OMS, l'Association médicale mondiale et la Société canadienne pour le traitement de la douleur.
Ce n'est pas que je veux laisser les gens souffrir, mais dans l'institution de la médecine, on dit depuis 2 500 ans que le médecin ne tuera point et on défend la valeur du respect de la vie dans la société en général. Il y a aussi une loi, c'est la loi dans toutes les sociétés comme le Canada, qui dicte qu'on ne peut pas tuer une personne (c'est ce que notre Code criminel prescrit) et qui défend la valeur du respect de la vie. Donc devrions-nous vraiment déroger à tout cela?
Nous devons nous arrêter ici. Je crois que vous pourriez participer à Tout le monde en parle et y avoir une discussion fantastique.
C'est ici que se termine la première partie de la réunion de ce soir.
Nous allons maintenant nous arrêter, avant de revenir dans la pièce à 19 heures, pour accueillir un autre groupe de témoins.
Je remercie nos témoins de s'être joints à nous aujourd'hui.
Nous reprenons nos travaux, après une interruption d'une heure.
Nous poursuivons la 12e séance du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir.
Nous souhaitons la bienvenue aux témoins qui sont parmi nous ce soir. Je vous remercie de prendre le temps de venir faire part de votre expertise au Comité pendant ses délibérations.
Nous recevons le Dr John Soles, président de la Société de la médecine rurale du Canada, qui comparaît de Clearwater, en Colombie-Britannique.
Je pense que nous allons commencer tout de suite par le Dr Soles, parce qu'on ne sait jamais, on peut toujours perdre la connexion. Si nous commençons par vous, nous aurons toujours la chance d'échanger avec vous au besoin par la suite.
Nous entendrons ensuite tous les autres témoins nommés ici, c'est-à-dire le Dr Hartley Stern, Michael Bach et Gerald Chipeur.
Vous disposez chacun de 10 minutes pour vous exprimer ce soir. Nous allons commencer par le Dr Soles.
Merci d'avoir invité la Société de la médecine rurale du Canada à présenter un exposé au Comité.
Notre société agit comme porte-parole national des médecins travaillant en milieu rural. Notre rôle consiste à exercer le leadership nécessaire pour favoriser la mise en place de conditions durables et de soins équitables au bénéfice des collectivités rurales.
Je vous ai fait parvenir une copie des principaux arguments que j'ai soulevés à l'automne devant le comité externe, et je ne vais pas répéter tout cela en détail. Vous souhaitez connaître nos recommandations quant au cadre d'intervention que le gouvernement fédéral devrait établir en tenant compte de la Constitution, de la Charte des droits et libertés et des priorités des Canadiens en matière d'aide médicale à mourir. Je suis persuadé que mes points de vue se rapprochent sensiblement de ceux que vont vous exposer de nombreux groupes de médecins.
Après quelques informations générales sur la situation du Canada rural, j'aimerais faire le tour avec vous des principaux points sur lesquels vous voulez que nous nous prononcions. S'il me reste du temps, je vais traiter plus à fond des considérations particulières à la vie en milieu rural.
Comme vous le savez, la géographie du Canada fait en sorte que le pays est rural à 90 %. Un peu moins de 20 % de notre population vit en milieu rural. À peu près 10 % des médecins canadiens travaillent dans les régions rurales. La population rurale du Canada est plus pauvre et en moins bonne santé; elle comporte une proportion nettement plus élevée d'Autochtones, surtout dans le Nord. Les Canadiens des régions rurales ont moins facilement accès aux soins de santé et doivent souvent parcourir de très longues distances, surtout dans les régions nordiques, pour obtenir des soins. Les médecins ruraux du Canada sont plus âgés et proportionnellement beaucoup plus nombreux à avoir obtenu leur diplôme à l'étranger — je suis l'exception à cette règle. Dans les très petites collectivités rurales, les soins de santé peuvent être dispensés par du personnel infirmier ou d'autres travailleurs de la santé, plutôt que par des médecins. L'accès à des spécialistes est limité, et la plupart des médecins en milieu rural travaillent comme généralistes et fournissent notamment des soins palliatifs.
C'est d'ailleurs cet aspect que je voudrais aborder d'entrée de jeu.
Les législateurs doivent tenir compte du fait que les soins palliatifs de qualité sont une forme d'aide médicale à mourir. En fait, nous sommes ici pour examiner les situations où cette aide médicale est fournie plus tôt dans le parcours de vie d'une personne. Comme pour tous les processus qui sont irréversibles, les erreurs d'évaluation doivent absolument être évitées. Les patients qui choisissent cette option doivent avoir la capacité de prendre une décision éclairée. Ils doivent disposer de suffisamment de temps pour repenser à leur décision. Ils ne doivent pas avoir d'autres possibilités de traitement qui auraient de bonnes chances d'alléger leurs souffrances.
Les médecins sont souvent appelés à évaluer la capacité de décider d'un patient, mais n'ont pas nécessairement la formation ou les compétences requises à cette fin. Les mesures législatives touchant l'aide médicale à mourir doivent inclure des définitions claires de la capacité à prendre des décisions, et exiger que les patients soient évalués par deux médecins n'ayant pas de liens entre eux.
Bien que l'on puisse considérer les enfants aptes à prendre différentes décisions concernant leur santé lorsqu'ils sont à même de comprendre la situation, j'estime que l'on devrait les exclure de ce processus dans un premier temps. Si nous ne permettons pas à des adultes de prendre des décisions touchant l'aide médicale à mourir à la place d'autres adultes incapables de le faire — et je crois que c'est très bien comme ça —, nous ne pouvons pas non plus permettre à des adultes de prendre ces mêmes décisions à la place des enfants.
Dans la plupart des autres pays, on considère comme « adulte » toute personne ayant 18 ans et plus, et je pense que le Canada devrait faire de même à titre de point de départ.
Qu'est-ce qu'un problème de santé grave et irrémédiable? C'est déterminé en grande partie par la situation du patient. Il ne doit exister aucun traitement acceptable pour le patient qui aurait pour effet de soulager ses souffrances, ni aucun problème psychiatrique important qui pourrait être traité. Si les souffrances persistantes devenues intolérables pour le patient sont d'origine psychiatrique, il faut exiger une évaluation par deux psychiatres avant de considérer l'aide médicale à mourir. S'il y a lieu de se demander si un problème psychiatrique peut être à l'origine de la demande d'aide médicale à mourir, j'estime qu'il est raisonnable de solliciter l'opinion d'un psychiatre.
Lorsqu'il faut évaluer un patient qui fait une demande d'aide médicale à mourir, il est important que les entrevues se déroulent de manière à éviter qu'une autre personne puisse avoir une influence sur le patient. Il faut en effet mettre les patients vulnérables à l'abri des pressions exercées par d'autres personnes. Il faut également demander au patient si quelqu'un peut l'avoir incité à aller de l'avant.
L'établissement d'un processus adéquat n'est pas une mince tâche, et je suis heureux de ne pas être mandaté pour rédiger cette loi. Un processus structuré doit être mis en place pour la formulation de ces demandes. Il n'est pas rare qu'un patient dise à son médecin qu'il souhaite en finir avec la vie. Bien souvent, cette volonté d'en finir n'est plus aussi forte quand vient le temps d'en faire la demande. Il doit par conséquent y avoir un document officiel à signer.
Il convient donc d'évaluer la capacité de décision du patient et de déterminer si des problèmes psychiatriques sont en cause. Il faut aussi chercher à voir si d'autres options de traitement sont possibles et discuter avec le patient pour déterminer si elles sont acceptables pour lui. Comme je l'indiquais, il faut qu'il y ait une seconde évaluation par un autre médecin dans un délai raisonnable, et on doit laisser au patient suffisamment de temps pour repenser à sa décision. Toutes les interactions et les discussions doivent être bien documentées.
Enfin, il faut déterminer qui fait quoi. À mon sens, quelles que soient les croyances personnelles d'un médecin, il doit être disposé à discuter de toutes les options légitimes avec son patient et l'aiguiller vers les ressources appropriées s'il ne peut pas lui-même fournir le service requis. Je crois que c'est un peu le même processus que pour l'avortement au Canada. Un médecin ne devrait pas être obligé de contribuer à la prestation d'un service qui lui pose des problèmes moraux, mais il devrait tout de même être capable d'en discuter avec ses patients et de les référer à des collègues au besoin.
Lors des échanges au sujet de cette problématique, il a notamment été question de la façon de remplir les certificats de décès. Je crois que l'on devrait y indiquer que l'aide médicale à mourir est la cause immédiate du décès, en précisant le diagnostic qui a mené à cette solution.
Les gens des régions rurales sont inquiets. Comme c'est le cas dans ma collectivité, il n'est pas rare en milieu rural que les médecins se regroupent pour travailler ensemble. Il est difficile en pareil cas d'obtenir une seconde opinion quand il s'agit de déterminer si un patient satisfait aux critères d'admissibilité ou est apte à prendre une décision. Je ne crois pas qu'il soit approprié de solliciter une seconde opinion de la sorte auprès d'un médecin avec lequel on travaille. Comment peut-on obtenir rapidement une consultation psychiatrique, le cas échéant, si tous les médecins ainsi regroupés ont des objections de conscience à l'égard de ce processus? Dans une petite collectivité, comment un patient peut-il avoir accès à ce service que la loi autorise si tous les médecins sur place ne peuvent pas lui fournir ce service en toute bonne conscience? À la différence des cas d'avortement, il est beaucoup plus fréquent que les déplacements soient problématiques pour les patients qui sollicitent cette forme d'aide.
À quel endroit et de quelle manière pourra-t-on mener à terme ce processus dans une collectivité rurale où tout le monde se connaît? Quelles seront les répercussions pour les autres membres de la collectivité? Dans quelle mesure le personnel de l'hôpital local sera-t-il affecté? Qu'adviendra-t-il si les quelque médecins travaillant au sein d'un même groupe diffèrent largement d'opinion à ce sujet?
Je vais donc me limiter à ces aspects qui m'apparaissent les plus importants.
Merci. Voilà qui est magnifique. Très souvent, les témoins terminent les éléments importants de leur exposé et poursuivent avec des points mineurs, mais ce n'est pas ce que vous avez fait. C'est excellent et nous l'apprécions.
Nous accueillons maintenant le docteur Hartley Stern qui est directeur général de l'Association canadienne de protection médicale. Merci d'être des nôtres ce soir.
Bonsoir à tous. Je suis le Dr Hartley Stern et je suis directeur général de l'Association canadienne de protection médicale (ACPM).
Honorables sénateurs et députés, je vous remercie de me donner l'occasion de comparaître devant vous. Dans le temps à ma disposition, je vais essayer d'aborder toutes les questions que vous nous avez posées. Vous trouverez de plus amples détails dans notre mémoire écrit.
Pendant la plus grande partie de ma carrière, j'ai été chirurgien oncologiste, avant d'être directeur du Centre de cancérologie de l'hôpital d'Ottawa. Depuis peu, je suis directeur général de l'Hôpital général juif de Montréal.
Dans chacun de ces postes, j'ai pu être témoin des incroyables souffrances qui affligent certains patients à la fin de leur vie. J'en ai également constaté les conséquences dévastatrices sur leurs proches, les médecins et les autres professionnels de la santé qui se préoccupent du sort de ces patients.
J'essaie de faire comprendre à mes étudiants toute l'importance que revêt la relation de confiance et d'empathie qui s'établit entre le médecin et son patient lorsque celui-ci arrive en situation de fin de vie.
Si j'ai joint les rangs de l'Association canadienne de protection médicale, c'est parce que notre rôle de fournisseur principal d'assistance juridique aux médecins canadiens nous permet d'appuyer nos membres dans leurs efforts pour offrir sans cesse à leurs patients des soins de qualité. Nous nous situons à l'intersection des systèmes canadiens de santé et de justice. À ce titre, nous recevons déjà des questions de nos membres, et ce n'est qu'un début, et nous leur prodiguons des conseils sur tous les aspects des soins de fin de vie, ce qui comprend les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir.
Pour les fins des travaux du Comité, je vais concentrer mes observations d'aujourd'hui sur l'aide médicale à mourir.
En formulant nos recommandations sur les suites législatives à donner à la décision Carter, nous voulons surtout insister sur le fait qu'il est absolument nécessaire d'avoir une loi fédérale fondée sur des principes de clarté et d'uniformité de manière à abattre les obstacles qui empêchent actuellement certains patients de conserver leur droit constitutionnel à l'aide médicale à mourir, et à leur assurer toute la protection juridique voulue.
Ces obstacles que nous observons sont attribuables au vide juridique actuel qui crée de la confusion dans l'esprit des patients, de leurs proches, des médecins et des autres professionnels de la santé quant à savoir qui est admissible à l'aide médicale à mourir, quelles sont les mesures de protection prévues pour les patients, surtout les plus vulnérables, et quelle forme d'aide médicale devrait être fournie en pareil cas.
Nous sommes d'avis qu'une loi fédérale est nécessaire. Si l'on fait exception du Québec, il n'existe pas de loi en la matière, ce qui crée de l'incertitude. Nous avons des membres qui nous ont déjà consultés en raison de cette incertitude. Compte tenu de ce vide juridique, les tribunaux seront appelés à rendre des décisions concernant l'aide médicale à mourir jusqu'au 6 juin prochain. Il leur sera difficile d'en arriver à des jugements uniformes en pouvant s'appuyer uniquement sur les grands principes énoncés dans la décision Carter.
Nous savons que la Cour fédérale de l'Ontario a déjà publié un guide pratique pour les cas soumis aux tribunaux. Les autorités médicales, c'est-à-dire les ordres des médecins et chirurgiens, ont également publié des lignes directrices à l'intention des médecins. Nous nous réjouissons de ces efforts, mais il n'en reste pas moins qu'il nous faut une loi détaillée pour combler le vide en matière de politique sociale.
La loi fédérale doit d'abord et avant tout établir des critères d'admissibilité et des mesures de protection qui s'appliqueront de la même manière partout au pays. Nous sommes pleinement conscients du chevauchement de compétences que cela crée avec les législatures provinciales et territoriales. À cet effet, le Comité pourrait envisager la possibilité d'établir une formule suivant laquelle la loi fédérale n'aurait pas préséance sur une loi provinciale essentiellement équivalente. Une approche semblable a déjà été utilisée au Canada.
J'aimerais maintenant vous présenter nos recommandations à votre intention relativement aux critères d'admissibilité et aux mesures de protection, deux questions de toute évidence délicates. Il convient dans un premier temps d'apporter des modifications au Code criminel pour confirmer qu'un médecin qui aide un patient à mourir ne contrevient pas aux interdictions générales concernant le suicide assisté. Cette garantie est essentielle pour permettre au médecin d'établir avec son patient la relation fortement axée sur la confiance et l'empathie qui est essentielle à l'application efficace de cette politique.
Nous nous inquiétons tout particulièrement du fait que différentes interprétations du terme « adulte » sont utilisées dans la décision Carter. Nous sommes d'avis qu'une définition claire du critère d'âge est nécessaire pour dissiper cette incertitude. De deux choses l'une, soit la loi s'en tient à la l'âge de la majorité, soit elle définit ce qu'on entend par capacité de décision pour un mineur mature. Si l'on détermine que les mineurs matures peuvent être admissibles, nous croyons qu'il faudra également établir la manière dont la capacité décisionnelle du patient sera évaluée dans ce contexte. Cette capacité est jaugée au moyen de critères subjectifs, ce qui n'est pas chose facile même dans le meilleur des cas. Dans une situation aussi complexe que celle-ci, l'application d'une politique semblable sera encore plus ardue. Tout bien considéré, nous estimons donc qu'il serait préférable d'utiliser un critère d'âge bien défini.
La loi fédérale devra aussi déterminer les différentes formes que peut prendre l'aide médicale à mourir, et indiquer s'il peut y avoir autoadministration. La loi doit prévoir des mesures pour la protection des patients. Ce n'est pas un aspect dont la Cour suprême a traité expressément dans sa décision. Au Québec, l'aide médicale à mourir doit être administrée par un médecin. Un médecin ne peut donc pas prescrire une dose létale de médicament à un patient pour qu'il se l'administre lui-même. L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario a publié des lignes directrices qui envisagent la possibilité d'une autoadministration.
Dans la décision Carter, la Cour suprême parle de « problèmes médicaux graves et irrémédiables ». Comme vous le savez, ce n'est pas une expression tirée de la terminologie médicale. La loi devrait fournir des principes directeurs à cet effet de telle sorte que le patient et son médecin puissent bien comprendre les critères d'admissibilité, sans toutefois que l'on perde de vue la situation particulière du patient. La loi devrait en outre bien préciser s'il est possible pour le patient de demander l'aide médicale à mourir au moyen d'une directive anticipée. Pour assurer une approche uniforme et un accès égal pour tous, les législateurs doivent déterminer avec soin si ces directives doivent être respectées et, le cas échéant, dans quelles circonstances.
J'aimerais maintenant vous parler du droit à l'objection de conscience. La Cour suprême a reconnu le droit du patient à l'aide médicale à mourir, mais elle s'est assurée de préciser que sa décision ne visait pas à obliger les médecins à fournir une aide semblable. Nous avons donc besoin de mesures législatives pour maintenir un juste équilibre dans l'application de ces deux droits. À ce titre, le Comité pourrait prendre en considération la formule adoptée en vertu de la loi québécoise. Suivant ce modèle, un médecin qui refuse d'acquiescer à une demande d'aide médicale à mourir pour des motifs de conscience doit en informer l'autorité désignée, laquelle verra ensuite à trouver un médecin disposé à prendre la demande en considération.
Permettez-moi de répéter les raisons pour lesquelles il est essentiel d'assurer une protection juridique aux médecins. Les médecins fournissant une aide médicale à mourir jouent un rôle unique auprès de leurs patients. Comme je l'indiquais, c'est une relation fondée sur la confiance et l'empathie, car le patient et son médecin doivent établir des liens étroits pour travailler ensemble afin de trouver la meilleure solution dans cette situation des plus complexe. Nous sommes d'avis que la loi fédérale doit offrir certaines garanties aux médecins en les assurant qu'ils ne s'exposeront pas à des poursuites s'ils respectent les exigences légales en matière d'aide médicale à mourir et s'ils estiment en toute bonne foi que leur patient satisfait aux critères d'admissibilité.
En conclusion, honorables sénateurs et députés, votre Comité a un rôle primordial à jouer. Nous vous prions de toujours garder à l'esprit l'importance de la relation entre le patient et le médecin, et la nécessité de veiller à ce qu'ils soient tous deux protégés tout au long du processus.
[Français]
Au nom de l'ACPM, je remercie le Comité mixte de m'avoir accordé la parole.
Nous serons heureux de vous fournir tout autre renseignement ou donnée qui pourrait vous être nécessaire.
Merci beaucoup.
Nous poursuivons avec M. Michael Bach.
[Traduction]
Il est vice-président à la direction de l'Association canadienne pour l'intégration communautaire.
Monsieur Bach.
Monsieur le président, honorables sénateurs et députés, je vous remercie.
Pour en arriver aux recommandations que l'Association canadienne pour l'intégration communautaire va vous présenter aujourd'hui, nous avons consulté l'organisme Personnes d'abord du Canada, un regroupement national de personnes vivant avec une déficience intellectuelle qui défendent leurs propres intérêts. Ces gens-là nous ont exprimé sans équivoque deux volontés bien précises. Premièrement, ils veulent avoir accès à l'aide médicale à mourir sans faire l'objet de discrimination en fonction de leurs déficiences. Comparativement à la population en général, les risques de décès évitable sont de trois à quatre fois plus élevés pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Les maladies cardiaques et le cancer sont les principales causes de ces décès. Les personnes ayant une déficience intellectuelle connaissent des morts pénibles à l'issue de souffrances persistantes et intolérables. Elles veulent avoir accès à l'aide médicale à mourir au même titre que tous les autres Canadiens.
Ces mêmes personnes nous ont cependant dit avec tout autant de passion qu'elles voulaient avoir la garantie absolue que des mesures seraient prévues pour protéger leur droit inhérent à la vie et qu'elles pourraient bénéficier de ces mesures sans discrimination fondée sur leur handicap. Elles ne veulent pas qu'on les aide à mourir. Elles ont plutôt besoin de mesures de soutien et de soins de qualité, car elles sont proportionnellement plus nombreuses à souffrir de la pauvreté, d'un manque de soutien ou d'une situation d'abus.
Dans la foulée de la décision Carter, on a amplement parlé du droit de choisir, mais nous estimons qu'il est également important de mettre en lumière l'autre moitié de l'équation dans la recherche de cet équilibre sur lequel a insisté la Cour suprême, à savoir la protection du droit à la vie.
C'est un peu étrange, vous savez. Je parle de droit inhérent à la vie et dès que je prononce ces paroles, j'ai l'impression que bien des gens croient que nous essayons d'effacer les gains acquis de haute lutte pour la liberté de choix, comme les droits des femmes en matière de procréation. On ne saurait être plus loin de la vérité en présumant ainsi de nos motivations. Voilà d'ailleurs 30 ans cette année qu'un petit groupe de personnes ayant une déficience intellectuelle se sont rendues jusqu'à la Cour suprême du Canada afin qu'on leur reconnaisse le droit de ne pas être stérilisées sans leur consentement. Ils ont eu gain de cause dans la décision Eve qui a établi une nouvelle norme internationale.
Nous sommes parfaitement au fait des considérations liées à la liberté de choix. Nous sommes aux premières lignes de ce combat depuis des décennies. Nous devons toutefois adopter une position aussi ferme relativement à la protection du droit inhérent à la vie, un héritage issu du souvenir sombre des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, pour que ce droit soit reconnu de façon incontestable et devienne une obligation pour les États signataires: le Code de Nuremberg, qui établissait la nouvelle norme quant au sens que doit prendre le consentement éclairé en éthique médicale et dans le comportement du médecin, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques.
S'il est vrai que le caractère sacré de la vie humaine trouve sa source dans les différentes traditions religieuses perpétuées sur notre planète, il ne faut pas oublier que c'est dans les textes fondamentaux régissant les droits de la personne à l'échelle internationale au XXe siècle ainsi que dans notre Charte des droits et libertés que le droit inhérent à la vie trouve ses justifications laïques les plus clairement contraignantes pour le Parlement comme pour tous les Canadiens. Si l'on essayait maintenant de voir pour quelles raisons il nous faut concevoir un régime d'aide médicale à mourir en tenant compte à la fois du droit de choisir et du droit inhérent à la vie.
Pas plus tard que lundi de cette semaine, la chaîne belge de langue flamande diffusait un reportage sur les deux soeurs d'une jeune femme euthanasiée en 2010 en vertu de la loi de ce pays. À la suite d'une rupture sentimentale, elle s'est retrouvée en pleine crise de santé mentale et a été traitée par un psychiatre. Deux mois avant que l'on mette fin à ses jours, le psychiatre a posé un diagnostic d'autisme, ce qui lui permettait de conclure que ses problèmes de santé étaient irrémédiables et que ses souffrances psychologiques étaient intolérables. On l'a donc aidée à mourir. Quand ses proches encore sous le choc ont demandé à son médecin pourquoi il avait confirmé l'évaluation du psychiatre, il a admis qu'il n'était pas d'accord, mais qu'il n'avait pas le choix, en indiquant qu'il croyait que Tine Nys avait consulté un trop grand nombre de médecins.
Il y a deux autres cas qui ont été rapportés dans des revues médicales. En Oregon, une patiente de 85 ans atteinte d'un cancer et d'une démence allant en s'aggravant a fait une demande d'aide médicale à mourir, mais son psychiatre croyait que sa famille exerçait des pressions sur elle à cet effet. Un psychologue a tout de même acquiescé à sa demande. Aux Pays-Bas, une femme qui ne voulait plus ou n'était plus capable de s'occuper de son vieux mari malade lui a donné le choix entre l'euthanasie et l'admission dans un centre d'accueil. Craignant d'être laissé à la merci de purs étrangers dans un endroit qu'il ne connaissait pas, il a choisi l'euthanasie et son médecin a mis fin à ses jours.
Lorsque l'affaire Carter a été entendue pour la première fois à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la juge Smith était suffisamment renseignée sur les cas semblables pour examiner minutieusement les nombreuses preuves qui lui avaient été présentées sur les types de mesures de protection qui pourraient être mises en oeuvre pour respecter l'obligation de protéger le droit à la vie des personnes vulnérables. Elle a conclu son analyse avec la liste des mesures suivantes: une évaluation psychiatrique obligatoire pour veiller à vérifier la capacité de donner un consentement éclairé, la disqualification des dépressions graves, une période d'attente minimum, l'avis d'un médecin indépendant qualifié par son expertise sur la maladie du patient, une consultation obligatoire avec un médecin spécialisé dans les soins palliatifs, un groupe d'experts chargés de l'examen préalable qui doit rendre une décision en 48 heures, et le droit du patient d'interjeter appel de la décision du comité d'examen.
C'est l'avocat des demandeurs dans l'affaire Carter qui a présenté cette liste au tribunal — Gloria Taylor et l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique faisaient partie des demandeurs —, afin qu'elle serve de recommandations visant les mesures de protection efficaces qui pourraient justifier des exceptions à l'interdiction prévue dans le Code criminel.
Immédiatement après la présentation de cette liste, la juge du procès a énoncé ses conclusions. La Cour suprême les a reprises afin de justifier sa propre décision:
... les risques inhérents à l'aide médicale à mourir peuvent être identifiés et considérablement minimisés grâce à un système soigneusement conçu qui impose des limites strictes qui sont scrupuleusement contrôlées et appliquées.
Nous appuyons sans réserve les recommandations des demandeurs, et nous pensons qu'elles peuvent se traduire en six éléments fondamentaux d'un système de mesures de protection prévues par la loi qui devrait être enchâssé dans le Code criminel.
Premièrement, seulement les adultes peuvent avoir accès à cette option; nous recommandons vivement de refuser l'admissibilité aux mineurs matures. Nous savons que les enfants et les adolescents souffrent aussi, mais nous croyons que les soins palliatifs représentent la réponse appropriée dans ces cas. C'est une décision que les enfants, les adolescents et leur famille ne devraient pas avoir à prendre. Dans notre pays, on accorde seulement le droit de vote aux personnes qui ont atteint l'âge de la majorité, et on peut donc sûrement imposer la même limite dans le cas qui nous occupe.
Deuxièmement, il faut qu'un « problème de santé grave et irrémédiable » entre dans la définition de la phase terminale d'une maladie. Nous conseillons vivement aux membres du Comité de s'inspirer en grande partie des mesures prévues par la loi au Québec, et de mettre l'accent sur les maladies graves et incurables et sur le déclin avancé et irréversible des capacités. Il faudrait également tenir compte des définitions précises proposées dans l'ébauche du projet de loi par David Baker et Gilbert Sharpe — cette ébauche a déjà été présentée au Comité —, ainsi que des éclaircissements contenus dans la lettre qu'a envoyée David Baker au Comité hier. Si le Parlement décidait plutôt de suivre les recommandations du groupe consultatif provincial-territorial à cet égard, ce qui est arrivé à Tine en 2010, en Belgique, pourrait également se produire au Canada. De plus, à la suite des recommandations du groupe consultatif, sur son certificat de décès, la cause de son décès serait l'autisme. L'autisme serait ensuite qualifié de tueur dans les statistiques démographiques du Canada, tout comme le syndrome de Down, les troubles bipolaires, la paralysie cérébrale et de nombreuses autres maladies qui sont réellement graves ou très graves, et c'est la définition de « grave et irrémédiable » proposée par le groupe consultatif provincial-territorial. Les membres de ce groupe se sont servis du dictionnaire Oxford pour proposer cette définition. Nous pensons que le Parlement peut et devrait faire beaucoup mieux.
Le troisième élément concerne les souffrances persistantes et intolérables dans les circonstances — et je souligne « dans les circonstances » — de la maladie du patient. Il s'agit d'un critère important précisé dans la décision Carter, c'est-à-dire que les souffrances et les circonstances d'un patient ne peuvent pas être prévues à l'avance. Ce critère énonce clairement qu'on ne devrait pas — et à notre avis, on ne peut pas — envisager d'autoriser les directives préalables, et nous conseillons vivement au Parlement de l'énoncer explicitement dans le Code criminel. La capacité de donner un consentement éclairé doit constituer un critère jusqu'au moment de recevoir une dose létale.
Quatrièment, on parle d'un examen mené par deux médecins — des médecins indépendants — pour déterminer si on a répondu aux critères; au moins l'un de ces médecins doit être un expert de la maladie. On propose également d'exiger que le médecin demande l'avis d'autres professionnels au besoin pour établir un diagnostic et un pronostic et explorer toutes les causes des souffrances subies par le patient. C'est d'ailleurs le travail que nous confions en toute confiance aux médecins.
Le cinquième élément concerne l'obligation d'évaluer la vulnérabilité du patient. Cette évaluation doit être menée après chaque demande, afin de déterminer si des facteurs qui pourraient mener le patient à se suicider dans un moment de faiblesse l'ont poussé à faire cette demande. Nous en parlons plus en détail dans le mémoire que nous vous avons remis, ainsi que dans un document d'information sur l'évaluation de la vulnérabilité.
Le sixième et dernier élément vise le recours à un groupe d'experts indépendants qui doivent examiner la demande et rédiger un rapport sur la compétence du patient et sur d'autres critères, y compris la vulnérabilité, rapport qui sera envoyé à tous les médecins qui participent à la décision. David Baker et Gilbert Sharpe ont présenté au Comité une proposition pour la création d'un tel groupe, et le Conseil canadien des imams l'a également proposé hier. Les Canadiens appuient aussi fortement cette mesure de protection. Dans un sondage en ligne auquel ont participé environ 13 000 Canadiens, 53 % d'entre eux ont appuyé ce mécanisme, et 54 % l'ont appuyée dans un sondage publié la semaine dernière par l'Association canadienne des individus retraités.
Il est également important de souligner que l'organisme de surveillance du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Canada a ratifié en 1976, a demandé, à maintes reprises, la mise en oeuvre d'un mécanisme d'examen préalable indépendant en ce qui concerne l'aide médicale à mourir à la suite de cas comme celui de Tine, afin de veiller à ce que les pays signataires s'acquittent de leur obligation de protéger le droit inhérent à la vie conféré par l'article 6 du Pacte.
L'existence d'un tel groupe empêcherait la recherche d'un médecin complaisant, protégerait les personnes vulnérables contre les intervenants qui pourraient les encourager à se suicider et — selon nous, c'est un point extrêmement important — éviterait aux médecins de devoir jouer deux rôles inconciliables et, à notre avis, conflictuels, c'est-à-dire d'un côté, ils doivent faire tout leur possible pour évaluer et soulager les maladies et les souffrances du patient et de l'autre, ils doivent approuver des interventions visant à mettre fin à la vie de ces patients.
Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de comparaître devant le Comité aujourd'hui.
Merci, honorables sénateurs, et merci, mesdames et messieurs les députés.
Il y a 21 ans, en 1995, j'ai comparu devant un comité sénatorial similaire qui se penchait sur le même enjeu. Je suis très heureux d'être de retour pour parler de cet enjeu important. J'étais avocat au procès et à l'appel et à la Cour suprême pour l'affaire Carter, et j'ai parlé de cet enjeu aux associations universitaires canadiennes et à l'Association du Barreau canadien.
J'aimerais immédiatement faire valoir mon point le plus important, monsieur le président, et c'est que si on met soigneusement en oeuvre les mots exacts énoncés dans la décision Carter, on ne se trompera probablement pas. Je crois que c'est ce qu'a fait la juge en chef Heather Smith, et la liste des exigences du tribunal qui a été publiée aujourd'hui signifie que ma recommandation la plus importante, c'est qu'on ne devrait pas autoriser l'aide médicale à mourir à moins qu'un juge puisse confirmer que toutes les exigences formulées dans la décision Carter ont été respectées.
Dans mon exposé, j'expliquerai pourquoi je recommande vivement l'examen judiciaire préalable. Je le recommande pour toutes les provinces, y compris le Québec. Cela n'enfreindrait pas la loi dans cette province, car selon son projet de loi, il faudrait se conformer aux lois québécoises et aux lois fédérales.
Je vais répondre à toutes les questions que votre comité nous a envoyées.
Tout d'abord, en ce qui concerne l'âge, je suis d'accord avec les témoins précédents, c'est-à-dire que l'âge de 18 ans représente la limite appropriée pour l'accès à l'aide à mourir. Dans sa décision concernant l'affaire A.C. c. Manitoba, en 2009, la Cour suprême du Canada a énoncé que le Parlement devait agir dans le meilleur intérêt des enfants et qu'il devait créer une présomption selon laquelle les enfants n'ont pas la capacité de prendre des décisions de vie ou de mort, et cela signifie toutes les personnes de moins de 18 ans.
Deuxièmement, en ce qui concerne la question de la capacité, les limites établies dans la décision Carter c. Canada sont essentielles à la protection des gens vulnérables. Il devrait être interdit à toute personne atteinte d’une déficience mentale nuisant à sa capacité décisionnelle de pouvoir demander l’aide au suicide. Dans sa décision liée à l'affaire Eve, la Cour suprême réaffirme et renforce ce principe. Elle interdit le consentement à mourir au nom d'une personne qui ne peut pas donner son consentement. Cela comprend les personnes immatures, les personnes qui souffrent d'une déficience mentale et celles qui n'ont plus la capacité de prendre des décisions éclairées, peu importe la raison. Cela signifie également que dans le cas de l'aide médicale à mourir, on ne peut pas autoriser les directives préalables sans entrer en conflit avec la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Eve.
Troisièmement, toutes les conditions expressément identifiées dans la décision Carter c. Canada doivent être réitérées dans la loi adoptée par le Canada. L'absence de telles conditions posera un risque d'abus inutile et donnera l'impression que le gouvernement appuie le suicide. Ce n'est pas le message qui devrait être envoyé en ce moment, surtout en Alberta, où le taux de suicide est 100 fois celui de la moyenne nationale dans certaines collectivités des Premières Nations.
La quatrième question concernait les Canadiens vulnérables. Dans la décision Carter, la Cour suprême du Canada a soigneusement équilibré le droit à la vie de ceux qui souffrent de douleurs persistantes et le droit à la vie des personnes vulnérables qui doivent être protégées contre l'abus en vertu du Code criminel. Le tribunal a souligné que les modèles adoptés par d'autres États ne l'impressionnaient pas et que le Canada devait et pouvait faire mieux. Le droit à la vie conféré par l'article 7 de la Charte exige que le Parlement tienne compte de ces deux visions de la vie. En 2011, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée sur cette question dans l'affaire Haas c. Suisse. Dans sa décision, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la double responsabilité du Parlement ou du gouvernement, c'est-à-dire qu'il doit protéger la vie tout en permettant aux personnes de faire des choix à la fin de leur vie.
En ce qui concerne les mécanismes de la demande, les lois adoptées par le Parlement devraient interdire à quiconque, y compris les médecins, d'aborder en premier la question du suicide. La personne touchée doit être la première à évoquer cette possibilité. Faute de temps, je ne vous les raconterai pas ce soir, mais il existe de nombreuses histoires de stress psychologique et d'abus causés par le gouvernement ou le personnel médical qui aborde l'idée du suicide avec les personnes malades ou les personnes âgées. Il faut interdire et empêcher ce type d'abus. L'équipe médicale doit s'en tenir aux soins palliatifs, sauf si le patient lui-même évoque volontairement l'idée du suicide.
Il existe une autre raison pour exiger que le patient aborde la question en premier. Les gens de l'Alberta connaissent la triste histoire des efforts de stérilisation menés de 1929 à 1972. En effet, des fournisseurs de soins de santé ont utilisé leur pouvoir pour maltraiter leurs patients et stériliser presque 5 000 d'entre eux contre leur gré. Dans le dossier des patients, on écrivait régulièrement qu'ils avaient donné leur consentement. Cette affaire appuie l'idée d'exiger un examen judiciaire, mais cela appuie également l'idée d'empêcher les administrateurs d'un hôpital qui souhaitent épargner de l'argent ou les médecins qui souhaitent aborder le sujet avec leurs patients de faire ce genre de chose.
Même l'héroïne canadienne Nellie McClung s'est laissé tenter par l'eugénisme à partir de 1929. L'article « Sterilizing the « Feeble-minded »: Eugenics in Alberta », de Grekul, Krahn et Odynak, est un dur rappel que tous les progrès ne sont pas nécessairement souhaitables. Parfois, le progrès nous entraîne dans une voie que nous n'emprunterions pas si nous savions ce qui nous attend au bout. Lorsqu'une demande est formulée, le médecin traitant doit respecter toutes les exigences liées à l'état de santé formulées dans la décision Carter c. Canada.
En ce qui concerne la question de la surveillance judiciaire, une fois le consentement validé, le médecin devrait être tenu de faire une demande au juge pour recevoir l'approbation du décès avant le décès. Le médecin devrait avoir l'obligation de demander l'avis d'un second médecin, et les deux médecins devraient être tenus de signer une déclaration sous serment confirmant qu'ils sont convaincus que les conditions énoncées par la Loi ont été respectées. Le médecin devrait avoir l'obligation de faire parvenir des exemplaires de la demande et de la déclaration sous serment au plus proche parent.
Ce sont les précautions minimales qui doivent être prises lorsqu'une demande est formulée dans le cadre de la Loi provinciale de mise en tutelle des adultes et de la Loi sur les curatelles de l'Alberta et dans d'autres provinces et territoires au Canada. Le décès est sans contredit un événement plus important et permanent que les décisions liées aux finances et au logement. Si la perte du contrôle financier exige une surveillance judiciaire, la perte de la vie ne mérite rien de moins.
Les tribunaux ont l'habitude de prendre des décisions liées à ces questions en se fondant sur les preuves fournies par les médecins. La question de l'objection aux transfusions de sang pour motifs religieux n'est qu'un des domaines dans lesquels on a demandé aux tribunaux de rendre des décisions sur des questions de vie et de mort. Les tribunaux ont été en mesure, dans les plus brefs délais, de rendre de telles décisions en situation d'urgence tout en limitant le risque couru par la personne. Aujourd'hui, partout au Canada, on rend régulièrement des décisions sur de telles questions, et l'initiative menée aujourd'hui par la juge en chef de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, Mme Smith, prouve encore une fois que les tribunaux sont en mesure d'assumer cette responsabilité.
Certaines personnes ont fait valoir qu'on devrait laisser l'entière responsabilité de cette question au médecin et rejeter la surveillance judiciaire. La Cour suprême du Canada s'est déjà penchée sur la question et a conclu que personne n'avait le droit de prendre des décisions de vie et de mort en secret.
Dans la décision Cuthbertson c. Rasouli, en 2013, la Cour suprême du Canada a examiné et affirmé la surveillance judiciaire prévue dans la Loi sur le consentement aux soins de santé de l'Ontario. En vertu de cette Loi, on doit consulter les médecins, mais la décision de vie ou de mort ne devrait pas leur revenir au bout du compte. En effet, il est préférable de mener un examen judiciaire indépendant avant le décès, ce qui évitera de nombreuses souffrances et des dépenses importantes en avocats et en frais de justice. Les successions devraient revenir aux enfants et aux bénéficiaires, et non à des avocats qui se querellent pour déterminer si un médecin a obtenu et consigné un consentement de façon appropriée.
En ce qui concerne la protection de la vie privée, les tribunaux et les médecins ont protégé efficacement la vie privée des personnes lorsqu'ils ont été saisis de questions de vie et de mort au cours des dernières décennies. La Loi adoptée par le Parlement devrait maintenir cette norme en matière d'éthique médicale. Toutes les demandes de surveillance judiciaire formulées à un tribunal devraient être limitées aux parties nommées et visées par la loi.
Ensuite, comment effectue-t-on la répartition des responsabilités? Le médecin devrait être responsable de gérer le processus. Toutefois, la loi doit reconnaître les rôles joués par les autres intervenants et autoriser leur participation. En effet, les propriétaires, les administrateurs et les employés d'un établissement de soins de santé devraient tous bénéficier de l'immunité à la suite d'une ordonnance du tribunal. La décision Carter c. Canada se penche seulement sur la question des médecins. Si on limite la portée de la loi aux médecins, 99 % des fournisseurs de soins de santé du pays seront à risque.
Merci beaucoup.
En conclusion, les décisions rendues par la Cour suprême du Canada le 6 février de l'année dernière et le 15 janvier de cette année fournissent au Comité des lignes directrices importantes sur le type de modèle à adopter. C'est un modèle mené par un examen judiciaire et il contient une exigence importante liée à la participation des médecins.
Je vous remercie beaucoup de votre temps et de votre attention.
Parfait. Merci.
J'aimerais d'abord m'adresser au Dr Soles, de la Société de la médecine rurale du Canada.
J'ai quelques brèves questions. La première concerne l'accès dans les collectivités rurales et éloignées. Nous avons vu que certaines régions envisageaient d'obtenir la participation d'autres régions dans le domaine médical, par exemple du personnel infirmier et du personnel infirmier praticien. J'aimerais savoir si votre groupe a mené des discussions à ce sujet. À votre avis, seuls les médecins, qu'ils soient médecins de famille ou omnipraticiens, devraient-ils participer à la démarche ou a-t-on envisagé de permettre à d'autres personnes d'intervenir, par exemple au personnel infirmier ou au personnel infirmier praticien?
Je crois qu'il s'agit de déterminer la capacité. Une personne ayant la formation nécessaire peut s'en occuper, qu'elle ait été formée comme médecin, infirmière ou infirmière praticienne. Comme d'autres l'ont laissé entendre, je crois que si vous envisagez d'exercer une surveillance judiciaire dans ce domaine ou d'adopter un cadre juridique pour déterminer, au bout du compte, le caractère approprié de l'aide médicale à mourir, l'évaluation de santé peut certainement être menée par d'autres intervenants, et non uniquement par les médecins.
Merci. C'est la transition parfaite vers la question que j'aimerais poser au Dr Stern.
Je crois qu'au début de votre exposé, vous avez souligné que l'ACPM est en quelque sorte un point de rencontre entre les soins de santé et les lois. Dans le document que nous avons reçu, il est écrit: « l'ACPM ne prend pas position à cet égard », c'est-à-dire sur la personne qui devrait déterminer l'admissibilité d'un patient. En ce qui concerne ce point de rencontre entre les soins de santé et les lois, d'autres intervenants du milieu médical nous ont dit que les mesures de protection devraient émaner du milieu médical et que les médecins sont formés pour évaluer des patients, leur capacité, etc. Toutefois, on a également fait valoir qu'une surveillance judiciaire devrait être exercée avant d'arriver à la décision finale.
Pouvez-vous nous indiquer des éléments de ce point de rencontre qui pourraient nous aider à déterminer l'équilibre à atteindre et les mesures de protection à adopter en vue de prendre la décision finale, c'est-à-dire une fois que le patient a décidé de demander l'aide médicale à mourir?
Vous avez posé plusieurs questions, et je veux m'assurer de les avoir bien comprises. Vous avez parlé de surveillance, et je suppose que vous voulez dire à la fin du processus. Je pense que vous avez également fait allusion à l'examen préalable à la prise de décisions. Si j'ai bien compris — et corrigez-moi si je me trompe —, vous avez demandé si le processus visant à déterminer l'admissibilité des patients devrait inclure d'autres praticiens, comme les infirmiers et les infirmières, ou s'il devrait relever de la compétence du système judiciaire. Je crois que vous avez posé trois questions, à moins que je me trompe.
Plus précisément, on nous a présenté divers modèles en ce qui a trait à l'autorisation de l'aide médicale à mourir.
Le premier modèle fait intervenir l'avis d'un médecin; cela pourrait être un médecin généraliste. Ensuite, il y aurait un délai d'attente afin qu'on puisse obtenir l'opinion d'un autre médecin généraliste, et c'est ce qui viendrait clore le processus. La personne pourrait ensuite mettre fin à ses jours comme elle le souhaite.
Un autre modèle exigerait l'approbation d'un médecin généraliste et d'un spécialiste, par exemple, un psychiatre.
Dans le troisième modèle, il y aurait en quelque sorte un examen médical suivi d'une discussion, puis le cas serait ensuite renvoyé à un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui donnerait l'approbation finale.
Chose certaine, ce qu'on veut, c'est protéger les médecins qui décident de prendre part à cette intervention. Comment pouvons-nous leur donner les mesures de protection nécessaires pour nous assurer que tous les processus ont été suivis? Comment bien faire comprendre aux patients qui prend la décision définitive? Encore une fois, on se retrouve devant une série de questions.
Sauf tout le respect que je vous dois, je crois que j'en ai retenu deux. Je veux sincèrement m'assurer de bien répondre à vos questions.
Pour ce qui est du nombre de médecins ou du rôle des spécialistes par rapport à celui des médecins de famille, sachez qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun médecin au pays qui a une expertise particulière dans le domaine. Un spécialiste n'a pas plus d'expertise qu'un médecin de famille pour prendre une telle décision. Par conséquent, nous n'avons pas vraiment d'opinion sur le type de médecins qui devraient être présents.
Selon nous, ce qui est essentiel, c'est que le projet de loi que vous présenterez définisse explicitement les critères d'admissibilité et soit uniforme partout au pays. Si le libellé est clair, les médecins seront en mesure de déterminer qui est admissible et qui ne l'est pas. Cela aidera également le patient à mieux comprendre ce qu'il en est.
C'est pourquoi, dans notre mémoire, nous avons insisté sur le choix des termes et la nécessité d'avoir un libellé sans équivoque, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire dans mon exposé, étant donné que les médecins peuvent participer et, je crois, protéger...
Merci, docteur Stern. Je regrette de vous interrompre, mais nous allons dépasser le temps qui est prévu.
Monsieur Cooper.
Merci, monsieur le président.
Mes questions s'adressent à M. Chipeur.
L'une des choses sur lesquelles le Comité doit se pencher est la définition de « problèmes de santé graves et irrémédiables ». Pourriez-vous définir ce que vous entendez par ce terme et s'il sous-entend, par exemple, une maladie terminale?
Je ne vais pas essayer de faire mieux que la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carter. Je considère qu'elle a fait un très bon travail. Je pense que ce terme serait approprié dans le cadre d'une loi. Vous pouvez étoffer un peu plus, mais selon moi, la Cour a voulu établir un sain équilibre entre le droit à la vie des personnes souffrant de façon persistante, et le droit à la vie des personnes vulnérables ayant besoin de protection contre les abus en fin de vie.
Si on dit que n'importe qui peut, en tout temps, s'enlever la vie avec l'aide de l'État, on donne l’impression que le gouvernement soutient le suicide. Nous nous opposons fermement à la peine de mort dans le domaine de la justice pénale, mais nous nous autorisons à donner la mort dans le domaine de la santé.
Selon moi, ce que la Cour a voulu dire, c'est qu'il y a très peu d'occasions où l'État devrait autoriser ce type de procédure très dangereuse et qu'il faut établir les normes les plus rigoureuses, qui ne concernent que les personnes qui souffrent et qui ne peuvent faire autrement que de vivre avec leur souffrance. Je crois que c'est ce que la Cour a essayé de dire — et je considère qu'elle l'a très bien expliqué —, et c'est pourquoi je vous recommande de reprendre ses termes.
Merci.
Vous avez notamment parlé des directives préalables, que la Cour suprême n'a pas abordées clairement dans l'arrêt Carter. Cependant, vous avez cité la décision Eve, dans laquelle la Cour suprême a exclu explicitement les directives préalables.
Pourriez-vous nous en dire plus sur la position de la Cour suprême?
À mon avis, si vous appliquiez aujourd'hui l'arrêt Carter à un décès relié à une directive préalable, vous seriez déclaré coupable de meurtre en vertu du Code criminel.
Il en serait de même avec l'affaire Eve. Dans sa décision, la Cour a simplement dit que si une personne n'était pas en mesure de prendre une décision concernant sa vie, personne d'autre ne pourrait le faire à sa place. C'est certainement le cas des directives préalables, parce qu'elles ne s'appliquent que lorsqu'une personne n'est pas en mesure de prendre une décision et qu'elle se trouve dans la même situation que la personne concernée dans l'affaire Eve.
Je pense que les arrêts Carter et Eve ont tous deux éliminé explicitement la possibilité de ces directives préalables.
En terminant, vous avez fait allusion à l'arrêt A.C. c. Manitoba. Dans cette affaire, la Cour suprême a reconnu la doctrine de common law du mineur mature, c'est-à-dire le droit des mineurs de prendre des décisions concernant leur santé selon leur niveau de maturité.
Pourriez-vous nous dire ce que vous en pensez et comment cela s'applique dans le contexte de l'arrêt Carter?
Je considère que la décision de la Cour suprême rendue dans l'affaire A.C. c. Manitoba a établi un principe très important qui exige du Parlement qu'il crée, en vertu de la Charte, la présomption que l'enfant est incapable de prendre de telles décisions. C'est le moins qu'on puisse exiger. L'arrêt A.C. c. Manitoba ne vous empêche pas d'établir une limite ferme, parce qu'ici, il ne s'agissait pas de vie ou de mort, mais plutôt de déterminer si un mineur mature pourrait prendre des décisions concernant des soins de santé.
La Cour suprême n'a pas encore établi si le suicide assisté faisait partie des soins de santé ou non. Je ne vous dis pas que l'arrêt A.C. c. Manitoba exige que vous fixiez la limite à 18 ans, mais il n'y a rien qui vous empêche d'interdire l'aide à mourir aux personnes âgées de moins de 18 ans.
Merci beaucoup.
Merci à tous nos témoins pour vos excellents exposés.
J'aimerais poser ma première question au Dr Soles. Si j'ai bien compris, vous avez dit que lorsqu'un problème psychiatrique était peut-être à l'origine de la demande d'aide médicale à mourir, il fallait exiger une évaluation par deux psychiatres afin de déterminer l'admissibilité du patient. Est-ce exact?
Oui. Naturellement, je parle ici d'un patient qui a un problème psychiatrique qui lui cause des souffrances irrémédiables. En Europe, on a déjà exprimé quelques réserves à l'égard de certains patients. Ici, cependant, il est question d'un patient dont les souffrances irrémédiables sont d'origine psychiatrique. Il n'est pas question d'un patient qui souffre d'un problème de santé et d'un trouble psychiatrique en même temps.
Est-ce que c'est logique?
Absolument.
Étant donné votre rôle au sein de la Société de la médecine rurale du Canada, croyez-vous que la situation pourrait être problématique dans les régions éloignées du Canada? Selon vous, la télémédecine pourrait-elle être utile là où il y a visiblement une pénurie de psychiatres? Comment cela fonctionnerait-il?
Tout à fait.
Divers témoins ont exposé différentes approches en vue d'établir les cadres juridiques, et ainsi de suite, mais toutes ces approches sont difficiles à mettre en oeuvre si on pense aux circonstances des régions rurales du Canada. Il est difficile d'y trouver un psychiatre, imaginez deux. On a aussi proposé que la majorité des patients subissent une évaluation psychiatrique. Je dirais qu'il y a très peu de chances que ce soit une solution pratique dans les collectivités du Canada rural, et dans une bonne partie du pays.
Merci.
Monsieur Bach, je vous remercie pour votre excellent exposé.
J'aimerais vous donner l'occasion de nous décrire un peu l'évaluation obligatoire de la vulnérabilité dont vous nous avez parlé. Vous avez donné plus de détails dans votre mémoire. Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Allez-vous former les médecins sur ces évaluations de la vulnérabilité? Allez-vous solliciter l'aide d'autres professionnels? Comment cela va-t-il se dérouler?
Il s'agit d'un processus en trois étapes.
Les médecins qui évaluent les patients et qui rendent les diagnostics seraient tenus de déterminer s'il y a d'autres facteurs que l'état de santé lui-même qui motivent la demande. Évidemment, nous savons que la maladie du patient lui cause des souffrances intolérables, mais nous devons savoir si d'autres facteurs motivent son désir de mourir. Chez les personnes vulnérables, une insécurité financière, un manque de soutien, de la violence familiale associée à l'apparition d'une incapacité, etc., sont tous des facteurs qui peuvent inciter au suicide.
À l'heure actuelle, les professionnels de la santé doivent appliquer des protocoles normalisés pour l'évaluation des risques de suicide. Lorsque des patients leur manifesteront leur désir de mourir, que feront-ils: évoquer le protocole d'évaluation du risque de suicide ou accéder à leur demande? Selon nous, à ce stade-ci, nous devons établir des lignes directrices claires à l'intention des médecins. Lorsqu'on craint qu'un facteur autre que l'état de santé du patient puisse motiver la demande, il faudrait exiger une évaluation de deuxième niveau. Pour la plupart des patients, on s'attend à ce que les médecins examinent leurs demandes, puis établissent qu'elles sont étroitement liées à leur état de santé et qu'ils y donnent suite. Lorsqu'on craint qu'il y ait d'autres facteurs en jeu, comme dans les exemples que je vous ai donnés, il faudrait faire appel à d'autres professionnels de la santé afin de se pencher sur les causes possibles. La famille est-elle stressée et complètement au bout du rouleau?
D'accord.
Si c'est le cas, nous devrons examiner la situation, parce que c'est ce qui motive la demande.
Ensuite, à la troisième étape, si ces facteurs prédominent, à ce moment-là, on ne pourrait pas donner suite à la demande du patient. Nous recommanderions l'intervention d'un psychiatre afin de déterminer si des problèmes de santé mentale sont en cause.
Docteur Soles, dans votre témoignage, vous avez dit que l'aide médicale à mourir était un soin palliatif. Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet?
Absolument. En fait, c'est plutôt l'inverse: les soins palliatifs sont une aide médicale à mourir. Ce sont des soins destinés à des patients en fin de vie qui comprennent la gestion des symptômes, la gestion de la douleur, etc. Quelle que soit la loi qui sera rédigée, il faut absolument mettre l'accent sur la prestation des soins palliatifs.
À la fin de votre exposé, vous avez soulevé de nombreuses questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, alors j'aimerais que vous répondiez à quelques-unes d'entre elles, du mieux que vous pouvez.
Vous avez parlé des médecins qui travaillent ensemble. Ces médecins ne seraient pas nécessairement indépendants les uns des autres. Par conséquent, comment peut-on obtenir une deuxième opinion ou l'avis d'un psychiatre?
Vous avez aussi parlé des patients qui ne peuvent pas se déplacer en toute sécurité. Vous nous avez demandé ce qu'il arrive lorsque tout le monde se connaît ou lorsqu'on a des opinions médicales totalement différentes au sein d'une même collectivité.
Je n'ai pas la réponse à ces questions. Pourriez-vous nous aider un peu?
Merci. Je n'ai pas nécessairement la réponse à ces questions non plus.
Je crois qu'on a mentionné le rôle de la télémédecine. Si un patient demande l'aide médicale à mourir dans une collectivité où il n'y a qu'un seul groupe de médecins, il serait tout indiqué que ce patient soit évalué par un deuxième médecin. Si cela ne peut être fait en personne, il faudra le faire autrement, que ce soit par vidéo ou téléconférence, mais idéalement par vidéoconférence.
Si, dans une petite collectivité, il n'y a pas de médecin qui accepte de participer à ce processus, si ce n'est que pour informer le patient sur la marche à suivre, cela pourrait occasionner de grands problèmes. Je ne crois pas que de telles décisions devraient être prises sans qu'on s'assoie avec le patient.
Si la loi autorisait la prescription, par un médecin, d’une dose mortelle de médicaments destinée aux patients qui en feraient la demande, comme c'est le cas en Oregon, est-ce que cela serait utile?
Je ne crois pas que ce soit le bon mot. J'essaie de voir comment les infirmières praticiennes ou les autres professionnels de la santé des régions rurales pourraient composer avec la situation, s'il y avait une demande légitime de la part d'un patient qui a été évalué par télémédecine et qui souhaite demeurer chez lui, que ce soit à Grise Fiord dans l'Extrême-Arctique ou ailleurs au Canada. La combinaison de médicaments pourrait lui être envoyée par la poste, comme on le fait pour d'autres médicaments. Pouvez-vous imaginer une telle situation? À quels types de problèmes serions-nous confrontés?
Certainement. Comme tout médecin ayant offert des soins palliatifs, je prescris tout le temps des doses mortelles de médicaments à des patients sans penser qu'ils vont les prendre.
Juste pour préciser, si je traite un patient atteint d'un cancer en phase terminale, par exemple, ce patient retournera chez lui avec une dose de médicaments qui pourrait être mortelle. Ce qui m'étonne le plus, c'est que je ne peux pas penser à un seul patient qui a choisi de mettre fin à ses jours de cette façon.
Si l'on prescrit des médicaments à distance et qu'on les envoie par la poste et que ces médicaments sont administrés par la famille du patient ou une infirmière, ce qui me préoccupe, c'est ce qui pourrait arriver si les choses tournaient mal. Je ne voudrais pas faire de comparaison, mais aux États-Unis, il est arrivé que l'exécution de prisonniers par injection létale ait pratiquement tourné à la torture. Ces doses sont administrées par des médecins, alors je n'ose pas penser à ce qui pourrait arriver si une infirmière de Grise Fiord administrait de tels médicaments.
Le rapport provincial-territorial a recommandé que toutes les régies régionales de la santé disposent d'un système efficace de coordination des soins de santé subventionnés par l'État afin d'assurer aux patients l'accès à l'aide médicale à mourir.
D'après vous, comment un tel système de coordination pourrait-il être mis en place, particulièrement au sein des collectivités rurales? Et quelle est la situation actuelle?
Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans ces provinces, alors il est difficile pour moi de me prononcer là-dessus. Je pense qu'il existe différents réseaux dans les différentes provinces en fonction des maladies; certains d'entre eux fonctionnent bien, d'autres non. Je considère qu'au cours des prochaines années, la situation va s'améliorer, mais pour ce qui est de la forme que cela prendra dans les différentes provinces, cela reste à voir.
Merci, monsieur le président.
J'adresse ma première question au Dr Stern.
À la page 7 de votre mémoire, vous discutez des droits de conscience. La question a été soulevée et discutée par de nombreux témoins. Hier, nous recevions les représentants des Églises. Ils se débattaient avec le problème du médecin ou du fournisseur de soins qui refuserait, pour des motifs moraux ou religieux, de participer à l'aide médicale à mourir.
Voici la recommandation que vous nous faites dans le premier paragraphe complet de la page 8:
Une approche appropriée à considérer, qui permet d'assurer aux patients un accès aux soins, est l'approche adoptée au Québec en vertu de la Loi concernant les soins de fin de vie. En vertu de cette loi, un médecin qui refuse une demande d'aide médicale à mourir pour des raisons de conscience doit informer les autorités désignées
— Je souligne « les autorités désignées » —
qui prendront les mesures nécessaires pour trouver un autre médecin prêt à traiter la demande.
Pourriez-vous nous expliquer qui sont les autorités désignées et comment, dans les faits, cela fonctionnera? La loi a été mise en application au Québec. Je crois donc comprendre que vous pourriez posséder les renseignements que nous cherchons à obtenir sur la protection des droits de conscience.
J'ai quitté le Québec il y a trois ans, et je ne connais pas tous les détails de la mise en oeuvre de cette loi.
À la lecture du texte de la loi québécoise, nous avons eu l'impression qu'elle offrait une solution très élégante à un problème très complexe pour les médecins, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment incapables, pour des motifs de conscience, d'envisager de diriger directement un patient vers un autre médecin qui le ferait volontiers. Le Québec offre de le diriger vers les autorités. Qui est-ce que ça désigne? Je n'en suis pas sûr, vu les réformes récentes au Québec, la réorganisation du système. Est-ce l'hôpital ou les autorités régionales, dont beaucoup n'existent plus? Mais c'est une solution élégante que le Québec a envisagée, pour essayer d'aider les médecins qui ont de graves...
Je pense que cette solution pourrait être adoptée ailleurs.
D'après ma lecture de cet article de la loi québécoise, l'article 31, dans le cas d'un médecin qui exerce dans un hôpital, le problème est renvoyé au directeur de l'établissement, de sorte que l'établissement n'est pas neutre dans cette situation. Hier soir, un témoin a fait valoir que les établissements sont également protégés par les droits de conscience. Au Québec, il est manifeste, d'après la loi, que l'établissement n'est pas neutre; l'établissement a l'obligation de fournir le service.
Les autorités locales qui ne sont pas un établissement doivent diriger le patient vers le Centre local de services communautaires, le CLSC au Québec. Autrement dit, les établissements publics sont tenus de faire donner suite à la demande.
Considérez-vous que c'est une protection sûre du droit du médecin de ne pas vouloir participer à l'aide médicale à mourir?
Comme tous les témoins qui ont comparu devant vous, nous nous sommes débattus avec ce problème de conscience des plus complexes. Je sais très bien que, dans l'arrêt Carter, la Cour suprême a bien dit qu'il était incorrect ou inacceptable d'obliger un médecin à participer à l'aide médicale à mourir.
Cette réserve nous amène à la question suivante: Que faire alors? Comment diriger le patient pour lui assurer un accès approprié à quelqu'un qui est prêt à répondre favorablement à sa demande? Encore une fois, quand j'ai quitté le Québec, alors que j'étais directeur général d'un hôpital, nous nous y préparions. C'était avant l'adoption du projet de loi. Nous nous préparions à un mécanisme, par le truchement du directeur de la santé publique, pour pouvoir fournir un médecin dans ces cas-là.
Chaque province possède un mécanisme différent de gouvernance. Je ne les connais pas tous et je ne connais pas tous les systèmes provinciaux de gestion, mais je suis d'accord avec votre position: que le directeur de l'hôpital et que le conseil d'administration de l'hôpital ont l'obligation de participer à cette mesure conformément aux lois du pays.
Je le répète, cette solution nous semble la meilleure. C'est une solution semblable à celle que le Québec offre à ses patients qui en ont besoin.
Je remercie tous les témoins pour les renseignements qu'ils nous fournissent.
Je tiens à vous remercier, monsieur Chipeur, de nous faire profiter de vos connaissances, vous qui avez été intervenant, au nom de l'Alliance des chrétiens en droit, dans l'affaire qui allait mener à l'arrêt Carter.
Je tenais à vous questionner, parce que vous avez parlé de l'avis de pratique qu'a publié la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Je tenais seulement à m'assurer que vous comprenez que ce n'est pas une loi de l'Assemblée législative de l'Ontario.
Oui, absolument. C'est un avis émanant du juge en chef, dans la foulée de l'arrêt de la Cour suprême du Canada du 15 janvier. D'après moi, il vous propose une solution merveilleuse. Je vous conseille d'adopter le modèle actuellement appliqué.
Mais ce n'est pas une décision de l'Assemblée législative de l'Ontario d'adopter une révision judiciaire pour l'Ontario.
Très bien.
En ce qui concerne mes questions, j'en ai pour le Dr Stern.
Vous mentionnez dans votre rapport, à notre intention, que votre association voudrait que la loi prévoie des protections pour les médecins contre les poursuites criminelles et civiles. Dans votre lettre, vous proposez un libellé inspiré par la loi du Vermont, qui se lit comme suit: « Un médecin sera exempt de toute responsabilité civile ou pénale ou de tout recours en discipline professionnelle pour les actions faites et conformes de bonne foi... ».
Avez-vous vu d'autres modèles? Est-ce celui que vous préférez?
Plutôt que de focaliser sur le modèle, je pense que je m'arrêterai au libellé. D'après mon interprétation, la question s'articule sur la bonne foi. Les médecins qui agissent de bonne foi, en suivant la loi, devraient être protégés contre les poursuites. La mauvaise foi, l'indifférence ou la désinvolture les soustrairaient à cette protection, mais je crois que l'immense majorité des médecins participera de bonne foi. La loi devrait les protéger, par ce libellé précis.
D'accord. Dans ce type de disposition, nous devons, d'après vous, axer nos réflexions sur la notion de bonne foi?
Je ne suis pas avocat, mais je crois que les avocats qui savent ce qu'est la bonne foi pourraient intégrer cette notion dans votre loi, de manière à mieux éclaircir la situation.
Je tenais aussi à parler d'accessibilité. Vous pourrez me corriger, mais, à ce que je sache, les médecins paient différentes primes selon le type de services professionnels qu'ils fournissent. Est-ce...?
Les médecins ne nous versent pas de primes. Nous ne sommes pas une société d'assurances. Nous sommes une mutualité de protection en matière de responsabilité médicale, à but non lucratif. Ils paient des cotisations annuelles, qui sont fondées non sur leur risque individuel, mais sur leur risque professionnel. La cotisation d'un obstétricien, qui est exposé à un risque plus élevé de poursuites en matière civile, serait supérieure à celle d'un dermatologue ou d'un médecin de famille.
D'accord. C'est ce à quoi j'essayais d'en venir, mais je vous remercie de cette mise au point.
Sur l'aide médicale à mourir, voudriez-vous voir figurer dans la loi une disposition qui empêcherait que la cotisation des médecins fournissant ce service et évalués par votre association ne devienne prohibitive au point qu'ils ne fourniraient pas ce service?
Simplement pour que vous sachiez bien quelles seront les répercussions de cette loi, elle n'aura aucun effet sur les cotisations de nos médecins.
Je vous remercie pour cette réponse.
Monsieur Chipeur, je voulais parler brièvement de cet avis de pratique.
Un procès entraîne des dépenses, notamment le versement d'honoraires à des experts. Qui épongerait ces coûts? Dans un tel système judiciaire, ne risquons-nous pas d'ériger un obstacle qui limitera l'accessibilité aux riches?
Aujourd'hui, nous n'érigeons certainement pas de barrières contre les demandeurs de la tutelle et la curatelle ou lorsque des décisions sont prises pour les enfants dont les parents ont refusé de recevoir des soins de santé. Dans tous ces cas, le médecin ou l'établissement de santé paie les frais juridiques.
Nous ne devrions pas prendre de décisions sur une question de vie ou de mort en fonction du payeur. On peut régler les questions de détermination du payeur. C'est certainement du ressort des provinces. Notre système est assez souple pour s'occuper du coût.
Mon souci, c'est la vulnérabilité et la recherche de la meilleure protection non seulement pour le patient, mais, aussi, le médecin. Le problème, ici,...
Merci, monsieur le président.
Messieurs, soyez les bienvenus à votre Parlement canadien.
[Traduction]
Monsieur Chipeur, vous avez dit que vous vouliez une révision judiciaire avant l'acte. Vous êtes avocat, mais nous parlons, ici, de soins de santé. Comment un juge peut-il savoir ce qui est bon ou néfaste pour un mourant?
Cela se fait actuellement dans probablement une dizaine de circonstances différentes, où des médecins décident ou émettent un avis d'expert pour des enfants, des personnes mentalement incompétentes, des personnes incapables de décider par elles-mêmes, des cas de tutelle et de curatelle. En ce moment même, leurs décisions sont régulièrement révisées par des juges compétents pour le faire.
Pour protéger les médecins, le mieux est la prévention. Après coup, nous nous exposons à d'importants recours collectifs. Des avocats spécialistes de ces recours interviendront pour représenter les membres de certaines familles qui n'étaient pas d'accord avec les décisions prises par le patient et le médecin.
Je pense que cela présente un risque élevé de procès et d'abus. Je le sais parce que, en Alberta, des cas remontent à 1972, et on en observe en ce moment même en Europe, où on examine après coup les mesures prises par les médecins. Pour éviter les embêtements du long processus de révision après coup, les médecins ne rédigent plus de rapports.
Ce n'est pas de la théorie, ce sont des faits actuels. La révision après coup ne comptera pas tous les morts, il y aura des abus, de la négligence.
Merci, monsieur Chipeur.
Docteur Stern, vous avez été témoin de l'expérience québécoise lorsque vous étiez à l'Hôpital général juif de Montréal. Ce que nous devons surtout éviter, c'est le contact des cours criminelles avec le système de santé. La santé relève des provinces; le Code criminel, de l'administration fédérale. D'après votre expérience professionnelle et ce que vous avez vu au Québec, pensez-vous que la nouvelle loi que le Parlement doit adopter doit être prescriptive à l'égard de la province plutôt que de lui permettre plus de souplesse?
C'est une question très importante, mais notre regard est vraiment tourné vers le patient et, pour nous, il importe que la loi prévoie d'assurer à tous les patients du pays un accès égal à l'aide médicale à mourir.
Nous croyons absolument qu'il faut une loi fédérale et nous sommes troublés par les interprétations différentes ou dissemblables des critères d'admissibilité. Il importe au plus haut point que la définition de ces critères et que les sauvegardes et la protection soient uniformes, particulièrement pour les patients vulnérables, dont mes collègues, à gauche, ont parlé avec tant d'éloquence. D'après moi, d'après nous, ça ne peut se faire que dans un cadre fédéral.
J'ai évoqué le concept de similitude: si les lois fédérale et provinciale sont suffisamment similaires, j'en conclus que la loi fédérale ne remplacera pas la provinciale. À cet égard, si toutes les provinces s'inspiraient de la loi à laquelle le Québec a beaucoup réfléchi, et la loi fédérale aussi, je crois nous aurions atteint l'uniformité que nous cherchons.
Merci, monsieur Deltell.
Je voudrais poser une, peut-être deux questions à M. Chipeur, pour obtenir des éclaircissements.
Vous avez donné des exemples de révision judiciaire avant l'application des mesures médicales. Pouvez-vous m'en donner un où la compétence n'est pas en cause? Disons que la compétence a été déterminée, avec le concours de médecins. Vous avez donné des exemples. Je pense que dans tous, le degré de compétence était en jeu dans la révision judiciaire de la décision. Pouvez-vous nous donner un exemple de révision judiciaire d'une pratique médicale dans laquelle la compétence ne serait pas un problème?
Les décisions touchant les enfants ne concernent pas vraiment la compétence, mais l'intérêt de l'enfant. Ce serait des exemples. Des exemples pourraient être des cas de transfusion sanguine, mais...
Effectivement.
D'accord. Ma deuxième question concerne les directives opérationnelles de la juge Smith. Savez-vous qu'elles découlent d'une décision de la Cour suprême requérant une révision judiciaire, provisoirement, en raison d'une prolongation de délai accordée en raison de la longueur de la période électorale? Voilà la raison. Cela n'a rien à voir avec l'insistance de la cour ontarienne pour une révision. Le saviez-vous?
Merci, monsieur le président.
Merci à tous d'être ici ce soir.
Revenons à une question qui nous travaille tous. Docteur Stern, vous nous l'avez vraiment dit. Nous nous débattons avec les droits de conscience.
Nous comprenons que nous avons l'obligation impérative de concilier les droits à l'objection de conscience que la Charte des droits accorde aux médecins avec le droit d'accès que la même Charte accorde aux patients. Dans votre réponse au sénateur Joyal, vous avez parlé du droit des patients d'accéder aux soins et comment le Québec y avait pourvu.
Allons tout à fait au bas de la page 7 de votre mémoire. J'essaie de faire le lien avec ce que j'y lis: « nous exhortons le Parlement à s'assurer que la liberté de conscience des médecins est protégée dans sa réponse législative à Carter ».
Je comprends l'approche québécoise qui permet « d'assurer aux patients un accès aux soins ». Est-ce là la réponse visant à assurer la protection de la liberté de conscience des médecins, dont vous avez chargé le Parlement? Je voudrais vous interroger à ce sujet aussi, si je peux.
Il existe en fait deux niveaux de liberté de conscience. Le premier est celui des médecins qui, pour des raisons de conscience, ne sont pas à l'aise de répondre à la demande du patient, mais qui n'ont pas d'objection à diriger ce dernier vers un autre médecin disposé à fournir l'aide. Je pense que ce serait le cas de la majorité des médecins qui expriment des réticences pour des raisons de conscience.
La dernière partie, celle du Québec et à laquelle nous faisons référence, concernerait un tout petit nombre de médecins qui pourraient se sentir mal à l'aise de diriger un patient vers un autre médecin pour des raisons de conscience. C'est notre tentative d'indiquer que nous considérons que le Québec a effectué un examen exhaustif des questions de conscience. Les responsables ont soigneusement réfléchi à la question, et la solution qu'ils ont proposée constitue, à notre avis, la meilleure manière de concilier les droits du patient et ceux du médecin. Cela s'appliquera à un nombre très restreint de médecins, mais c'est ce qui est important, selon nous. Nous voulons protéger le médecin pour lui permettre de participer d'une manière empathique et réfléchie, et il est très utile de savoir que certains de ses collègues pourraient éprouver des réticences dans le cadre de ce processus.
En nous disant qu'il faut tenir compte de deux aspects pour traiter cette question, vous m'aidez vraiment à comprendre, mais j'aimerais également revenir au passage où vous exhortez le Parlement à assurer la protection de la liberté de conscience des médecins. Considérez-vous que ce point devrait être résolu dans la loi fédérale, ou est-ce qu'il relèverait plutôt des compétences des provinces ou d'un organe de réglementation? Qu'en pensez-vous?
Je pense que c'est une nécessité absolue. Ce que nous craignons, c'est que certaines provinces n'adoptent pas de loi. En l'absence de loi pour régir cette politique sociale très importante, tant les médecins que les patients seront laissés dans le vide, aux prises avec une grande incertitude. Ce vide sera comblé de manière insuffisante, ce qui se traduira par une inégalité de l'accès. Il ne faut pas que l'accès du patient diffère d'une province du pays à l'autre. La loi fédérale garantira ainsi la satisfaction des exigences législatives et l'uniformité de l'accès des patients à l'aide médicale à mourir dans toutes les régions du pays. Nous espérons que les lois provinciales, dans les provinces où une telle loi sera adoptée, seront suffisamment semblables pour que la loi fédérale ne les supplante pas.
En ce qui concerne la liberté de conscience des médecins, incombe-t-il au Parlement fédéral de l'enchâsser dans la loi, ou considérez-vous qu'il s'agit d'une responsabilité des provinces ou d'un organe de réglementation?
Je suis absolument convaincu qu'il s'agit d'une exigence législative fédérale, pour les raisons énoncées. C'est pour assurer l'uniformité de l'accès des patients.
Si nous revenons à mon point initial, le médecin inquiet en raison de l'incertitude ne pourra établir cette relation avec le patient sans craindre de subir des représailles. Ils doivent avoir noué cette relation empreinte d'empathie et de confiance pour que le patient puisse s'en remettre à ce médecin pour recevoir l'aide médicale à mourir.
Merci à tous les témoins. Nous avons entendu des propos fort intéressants et très importants.
Docteur Stern, je voulais aborder la question du processus de prise de décision. Vous avez indiqué que l'ACPM appuie un processus décisionnel qui sera facilement accessible aux patients, qui respectera la protection de leur vie privée et qui n'imposera pas de difficultés administratives indues, ni aux patients, ni aux médecins. Vous avez entendu M. Chipeur parler d'un processus plus élaboré comprenant un examen préalable, qui inclurait des audiences devant un tribunal et la présentation d'affidavits aux plus proches parents. Pouvez-vous formuler des commentaires sur la proposition qu'il nous a faite ce soir par rapport à la position de l'ACPM, au sujet de laquelle je vous ai lu un passage tiré de votre mémoire?
Je tiens à préciser que nous ne nous opposons pas formellement à un examen judiciaire, mais nous avons quelques réserves. Ce qui nous préoccupe, c'est l'accès limité par un processus complexe qui peut faire en sorte qu'un patient ait plus de difficulté à obtenir l'aide médicale à mourir.
Premièrement, il ne faut pas que le processus soit exagérément bureaucratique et complexe et qu'il rende l'accès difficile pour le patient et, deuxièmement, il faut que le processus soit clair et compréhensible, de sorte que le patient puisse parfaitement le comprendre.
Les patients qui traitent avec des médecins dans un climat de confiance obtiennent de l'information claire et sans équivoque sur le processus parce que leur médecin est digne de confiance et empathique. Le tribunal représente un environnement distant, de nature juridique, et cela se traduit par un climat beaucoup plus effrayant pour la prise de telles décisions. Encore là, nous ne nous y opposons pas, mais nous nous inquiétons que, premièrement, les patients ne comprendraient pas le processus et que, deuxièmement, l'accès serait retardé.
Nous estimons que oui. Encore une fois, nous ne nous opposons pas au processus d'examen judiciaire, mais les deux réserves — qu'il soit simple et bien compris des patients, et qu'il ne limite, ne ralentisse ou ne retarde pas l'accès — sont les facteurs fondamentaux que vous devez tenir en compte dans votre prise de décisions, d'après nous.
Monsieur Chipeur, le coprésident vous a mentionné l'avis de pratique qui a été publié. D'après ma compréhension des choses — et je veux simplement m'assurer que je comprends bien —, vous ne dites pas que le régime proposé par la juge en chef Smith est requis par la décision Carter; son objectif est de respecter les exigences provisoires imposées par la Cour suprême du Canada lorsqu'elle a accordé la prorogation de quatre mois.
Je pense que ce que la juge en chef a fait, c'est de se conformer à la décision du 15 janvier.
Ce que je dirais au Comité, c'est que c'est un excellent modèle. Il fonctionne. Il a été créé de manière organique par des gens qui connaissent ces problèmes et y font face jour après jour. Je dis donc que si vous vous adressez à ceux qui font déjà cela aujourd'hui et que vous suivez leur modèle, vous ne risquez pas de vous tromper.
Je ne dis pas que nous ne pourrions faire cela, mais ce que je comprends aussi de ce que vous dites, c'est qu'il faudrait que nous fassions cela pour respecter l'arrêt Carter.
Je crois que j'ai posé toutes les questions que j'avais. J'ai cependant quelque chose à dire pour que ce soit au compte rendu. Je n'ai pas tendance à faire cela, mais si je peux avoir une minute à la fin...
Ce n'est peut-être qu'une précision.
Les membres du Comité se rappelleront qu'hier, nous avons reçu des pédiatres. Quelqu'un a indiqué que le groupe d'experts provincial-territorial n'avait pas accès à de l'expertise pédiatrique, qu'aucun témoin n'avait été invité ou que cet aspect de la perspective pédiatrique, si je puis dire, n'était pas à la portée du groupe provincial-territorial.
C'était un peu étrange, et j'aurais dû m'en rendre compte à ce moment-là. Je suis allé voir la composition du groupe provincial-territorial. J'ai vu que la Dre Nuala Kenny, une pédiatre que je connais très bien, en faisait partie. Elle est une associée du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Elle était au département de pédiatrie de l'hôpital pour enfants malades (Sick Kids Hospital) de Toronto, à Queen's, puis elle est venue à Dalhousie, où j'ai fait sa connaissance. Elle était alors chef du département de pédiatrie et chef de la pédiatrie à l'hôpital pour enfants de Halifax. Elle a aussi déjà été présidente de la Société canadienne de pédiatrie.
Elle n'a pas témoigné devant le groupe, mais en était membre. Je dirais que les membres du groupe estimaient qu'ils avaient une perspective pédiatrique parmi eux et je voulais simplement préciser cela.
Monsieur le président, j'aimerais préciser que je ne disais pas qu'aucun pédiatre n'y participait.
La question hier soir était celle de savoir en particulier si la Société canadienne de pédiatrie avait été consultée. Deux fois, on a indiqué très clairement que non.
C'est la seule chose que je disais.
Très bien.
C'est là-dessus que se termine la séance.
Je remercie nos témoins.
Je sais que vous accordez une grande importance à vos curriculum vitae, alors je tiens à souligner que vous êtes les témoins numéro 59, 60, 61 et 62 de nos audiences, et que nous avons tenu 11 réunions au cours des 9 derniers jours. Nous avons maintenant entendu 62 témoins et nous avons reçu plus de 100 mémoires à examiner. Vos témoignages, comme ceux des 58 autres témoins, seront examinés à compter de demain matin, 9 heures, dans la pièce 237-C de l'édifice du Centre.
Nous nous réunissons de nouveau demain matin à 9 heures. Nous aurons deux réunions demain, pour donner des directives aux analystes. La fin est proche.
Merci beaucoup.
La séance est levée.
Explorateur de la publication
Explorateur de la publication

