PDAM Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
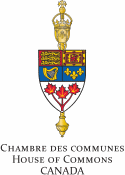
Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir
|
l |
|
l |
|
TÉMOIGNAGES
Le mercredi 3 février 2016
[Enregistrement électronique]
[Traduction]
Nous avons le quorum et je déclare la séance ouverte.
[Français]
J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la 11e réunion du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir.
[Traduction]
Je m'appelle Kelvin Ogilvie. Je suis sénateur de la Nouvelle-Écosse et coprésident de ce comité. Je préside la séance d'aujourd'hui avec mon collègue, le coprésident Rob Oliphant, député de Don Valley-Ouest.
Au cours de la présente séance, qui se déroulera de 17 h à 18 h, deux groupes interviendront. Premièrement, nous entendrons Son Éminence le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, qui sera accompagné de Laurence Worthen, directeur exécutif de la Christian Medical and Dental Society of Canada et de la Coalition for HeathCARE and Conscience.
Nous vous souhaitons la bienvenue. Je vous rappelle que vous disposez au total de 10 minutes pour présenter votre exposé.
Nous accueillons également par vidéoconférence Vyda Ng, directrice exécutive du Conseil unitarien du Canada.
Madame Ng, vous aurez aussi 10 minutes. Étant donné que nous devons faire appel à des moyens technologiques et que vous avez dû changer d'endroit à Toronto après ce qui s'est passé au premier site, nous allons vous inviter à prendre la parole en premier, madame Ng.
Avant de commencer, je tiens simplement à rappeler aux témoins et à tous les participants que chaque membre du comité dispose en tout de cinq minutes pour la période de questions et réponses. Nous vous prions donc d'être aussi précis et directs que possible dans vos questions et réponses.
Sur ce, j'inviterais Mme Ng à prendre la parole.
Merci de me donner l'occasion de prendre la parole devant le comité mixte.
Depuis le début des années 1970, le Conseil unitarien du Canada défend le droit des malades en phase terminale de décider du moment où ils souhaitent mourir et de la façon dont cela se déroulera. Nous sommes intervenus dans les affaires Taylor et Carter en 2012 et en 2014. Au cours de ma présentation, j'aimerais mettre l'accent sur les questions suivantes.
Premièrement, pour ce qui est des critères d'admissibilité et de la capacité, nous croyons que l'exigence liée à la capacité devrait s'appliquer à la demande initiale d'aide médicale à mourir, ainsi qu'à la prestation du traitement demandé. Cependant, nous sommes conscients que les malades atteints d'une affection irrémédiable peuvent voir leur état de santé se détériorer à tout moment. Par conséquent, nous pensons qu'une fois donné, le consentement éclairé devrait être maintenu et que les décisions sur la façon et le moment de mourir devraient être prises selon chaque cas, par exemple lorsqu'une personne est atteinte de démence ou sombre dans le coma après avoir donné initialement son consentement éclairé.
Nous croyons aussi que le consentement à mettre fin à sa vie doit être donné librement, sans contrainte ou pression, après que le patient a eu l'occasion d'envisager toutes les options de traitement disponibles.
Nous croyons qu'un certain nombre de maladies, de handicaps et d'affections répondent à la définition de problèmes de santé graves et irrémédiables et que la cause de la souffrance intolérable devrait être définie par la personne qui en est atteinte, plutôt que par une entité de l'extérieur. Nous croyons très fermement qu'il ne devrait pas exister de liste préétablie de maladies, d'affections ou de symptômes, car les circonstances varient d'une personne à une autre.
Pour ce qui est de l'accès équitable, nous croyons que les établissements publics devraient être tenus de fournir l'aide médicale à mourir dans leurs installations. D'autres professionnels de la santé peuvent administrer des médicaments dans le cadre de l'aide médicale à mourir, en particulier dans les cas où aucun médecin n'est présent ou disposé à le faire, ou encore dans certaines régions éloignées.
Dans les régions éloignées, il faut trouver des façons de permettre aux patients d'avoir un accès équitable à l'aide médicale à mourir, de telle sorte qu'ils n'aient pas à subir des retards et qu'ils puissent bénéficier de soins prodigués avec compassion.
Lorsque le médecin n'est pas disposé à fournir l'aide médicale à mourir, des mécanismes doivent être prévus pour que les malades puissent y avoir accès sans faire l'objet de stress indu.
Nous croyons également que les médecins et les autres professionnels de la santé devraient être autorisés à prendre des décisions selon leur conscience. Ils devraient toujours être autorisés à refuser de fournir l'aide médicale à mourir si cette pratique est contraire à leurs croyances personnelles. Ils devraient pouvoir prendre des décisions à cet égard sans crainte de représailles ou de conséquences négatives; les établissements pour lesquels ils travaillent ne devraient pas être autorisés à leur faire subir des conséquences, peu importe leur nature.
Lorsqu'un médecin refuse de fournir l'aide médicale à mourir, le patient doit avoir pleinement accès à d'autres options. Aucun obstacle ne devrait être imposé aux personnes qui demandent l'aide médicale à mourir, et les établissements ne devraient pas empêcher les patients d'y avoir accès.
Il faut mettre en place un système mûrement réfléchi pour le transfert des soins, de telle sorte que les patients puissent avoir accès à des soins prodigués avec compassion, et ce, sans subir de stress ou de traumatisme additionnel. Les besoins des patients doivent primer sur la volonté des médecins, et les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales devraient s'assurer qu'il n'existe aucun obstacle pour les malades qui souhaitent avoir accès à l'aide médicale à mourir.
Pourquoi le Conseil unitarien du Canada a-t-il une opinion aussi tranchée à ce sujet? En tant qu'institution religieuse, nous sommes conscients que les croyances varient d'une confession à une autre. Toutefois, nous ne pensons pas que l'opinion d'une confession donnée puisse être utilisée pour restreindre les libertés individuelles. En tant qu'entité religieuse, nous avons toujours appuyé la liberté de choix dans toutes les situations, même lorsque cette position n'est pas très populaire, par exemple dans des dossiers comme l'avortement, les droits des lesbiennes, des gais et des bisexuels, ou encore l'ordination des femmes. Nous avons souvent suivi un chemin impopulaire, mais nous croyons que c'est la bonne chose à faire.
Nous croyons qu'il est tout à fait conforme aux valeurs canadiennes de faire passer les besoins et les volontés des Canadiens avant les valeurs des médecins et des établissements, ainsi que de respecter la dignité de chaque personne au moment le plus traumatisant de sa vie.
Nous pensons également que, pour protéger l'intégrité du processus, chaque cas d'aide médicale à mourir devrait faire l'objet d'un examen après coup. Cela est nécessaire. Toutefois, nous ne croyons pas que le fait de procéder à un examen avant l'administration de médicaments est dans l'intérêt du patient, car cette pratique entraînerait des retards.
C'est ainsi que se termine notre présentation.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Je donne maintenant la parole à Son Éminence et à son collègue. Vous pouvez maintenant présenter votre exposé.
Bonsoir, et merci de nous donner l’occasion d’intervenir sur un sujet d’une telle importance.
Je m’exprime aujourd’hui au nom de la Coalition for HealthCARE and Conscience. Je suis accompagné de Larry Worthen, directeur général de la Christian Medical and Dental Society of Canada.
Nos deux organismes partagent des vues similaires et sont résolus à défendre la liberté de conscience des professionnels de la santé et des établissements de santé. Outre l’archidiocèse catholique de Toronto et la Christian Medical and Dental Society of Canada, nos membres comprennent l’Organisme catholique pour la vie et la famille, la Fédération canadienne des sociétés de médecins catholiques, l’Institut canadien catholique de bioéthique et les Médecins canadiens pour la vie.
Je voudrais aborder deux questions: la protection de la liberté de conscience des travailleurs de la santé, ainsi que les soins palliatifs et les services de soutien pour les personnes vulnérables.
Pendant des siècles, des organisations et des communautés religieuses ont pris soin des plus vulnérables dans notre pays, et elles le font encore aujourd’hui. Nous savons ce que c’est que de cheminer avec ceux qui affrontent de grandes souffrances physiques et mentales, et nous sommes déterminés à les accompagner avec un amour et une compassion qui sont fondés sur la foi et qui s’incarnent dans les meilleurs soins médicaux disponibles.
Une mission commune nous rassemble: respecter le caractère sacré de la vie humaine, qui est un don de Dieu; protéger les personnes vulnérables; et permettre aux particuliers et aux établissements de fournir des soins de santé sans être contraints de trahir leurs convictions morales. Étant donné cette mission, nous ne pouvons ni appuyer ni accepter l’aide au suicide ou l’euthanasie.
La mort est la conclusion naturelle de la vie en ce monde. Comme le dit avec sagesse l’auteur du livre de l’Ecclésiaste il y a très longtemps, « la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle de vie, à Dieu qui l’a donné ». La mort n'épargne personne; les patients ont donc parfaitement le droit de refuser des traitements accablants ou disproportionnés, qui ne font que prolonger le processus inévitable de la mort. Toutefois, il y a une différence absolue entre mourir et se faire tuer. Sur le plan moral, nous sommes convaincus qu’il n’est jamais justifié qu’un médecin aide un patient à mourir, quelles que soient les circonstances.
Nous vous exhortons à considérer avec soin la gravité des conséquences négatives qu’aura le suicide assisté par un médecin dans notre pays. Le fait de tuer quelqu’un ne sera plus perçu comme un crime, mais traité plutôt comme une forme de soin de santé. Selon la Cour suprême, les adultes de tout âge, et pas seulement ceux qui seraient à l’article de la mort, peuvent demander l’aide au suicide.
Suivant l’exemple de certains pays européens, dont nous ignorons à nos risques l’expérience en matière d’aide au suicide et d’euthanasie, le Groupe consultatif provincial-territorial d’experts sur l’aide médicale à mourir n'entend plus restreindre l’accès à l’aide au suicide seulement aux adultes, mais propose de l’étendre aussi aux enfants.
En pratique, le droit de se faire tuer deviendra, dans certains cas, le devoir de se faire tuer, à mesure qu’augmenteront les pressions subtiles exercées sur les personnes vulnérables.
Ceux qui ont la noble vocation de guérir collaboreront plutôt à donner la mort, ce qui aura de lourdes conséquences non seulement sur l’intégrité de la profession médicale, qui s’est engagée à ne causer aucun mal, mais aussi sur la confiance des patients envers ceux de qui ils attendent la guérison. Même les médecins qui appuient en principe la légalisation de cette pratique seront sans doute mal à l’aise quand ils auront à faire l’expérience de ses vastes conséquences.
La force du message de la Cour suprême n’échappe à personne: certaines vies ne valent tout simplement pas la peine d’être vécues. Nous ne sommes absolument pas d’accord avec ce message.
Dans ce contexte, il est clair que des personnes raisonnables, avec ou sans convictions religieuses, peuvent avoir en conscience une objection d’ordre moral à participer de quelque façon à l’offre d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Ces personnes méritent d’être respectées. Il est essentiel que le gouvernement veille à ce qu’on protège la liberté de conscience des fournisseurs de soins, qu’il s’agisse d’établissements ou de particuliers. Ils ne doivent pas être contraints de poser des gestes à l'encontre de leur conscience, ou de réorienter des patients vers d’autres praticiens, puisque cela revient, sur le plan moral, à prendre part à l’acte lui-même. Il est tout simplement faux et contraire à la justice de dire: vous n’avez rien à faire qui aille contre votre conscience, mais vous devez vous assurer que ça se fasse.
Notre valeur comme société se mesure par le soutien que nous donnons aux plus vulnérables. Les personnes frappées par la maladie peuvent choisir de mettre fin à leur vie pour des motifs d’isolement, de découragement, de solitude ou de pauvreté, même si elles ont peut-être encore de nombreuses années à vivre. Qu’est-ce donc qu’une société où les personnes malades et vulnérables sentent qu’elles sont un poids? Une demande de suicide est souvent un appel à l’aide. La société doit offrir de la sollicitude et de la compassion à ces personnes vulnérables, pas la mort.
La majorité des Canadiens n’ont pas accès à des soins palliatifs adéquats. Il est moralement impératif que tous les ordres de gouvernement de notre pays portent leur attention et leurs ressources vers des soins qui permettent un contrôle médical de la douleur et, surtout, qui accompagnent avec amour les personnes qui s'approchent de la fin inévitable de la vie.
Larry Worthen va maintenant présenter en détail quelques recommandations précises.
Mesdames et messieurs les membres du Comité, Son Éminence vous a donné un aperçu de nos réserves quant aux conséquences pour les patients vulnérables de la légalisation de l'aide médicale à mourir ou de l'euthanasie.
Selon les critères définis par les tribunaux, du moment qu'elles sont aptes à donner leur consentement, les personnes ayant une incapacité telle que la polyarthrite rhumatoïde ou la paraplégie ou encore celles qui ont des troubles mentaux seraient admissibles à l'aide à mourir. Or, quiconque vit ce genre d'épreuve se débat souvent dans un monde parsemé d'embûches et risque d'opter pour le suicide assisté parce que la société n'aura pas su lui fournir le soutien voulu.
En élargissant l'accès aux soins palliatifs ainsi qu'aux services de santé visant les incapacités et les maladies chroniques ou mentales, le Canada a le pouvoir de réduire considérablement le nombre de personnes qui voient dans la mort l'unique recours pour mettre un terme à leur isolement et à leur sentiment d'inutilité, pour cesser d'avoir l'impression d'être un fardeau.
Au-delà des patients, nous avons aussi à coeur de protéger le droit de conscience. Dernièrement, l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario a adopté une politique exigeant le transfert de soins dans les dossiers d'aide à mourir. Le transfert de soins consiste pour un médecin à confier le soin d'un patient à un autre médecin ou à recommander cette démarche. Exiger le transfert de soins obligerait donc nos membres à agir contre leur conviction morale que le suicide assisté ou l'euthanasie nuiront bel et bien à leurs patients. Cependant, s'ils refusaient de procéder au transfert de soins, ils s'exposeraient à des sanctions disciplinaires de l'Ordre des médecins de l'Ontario.
Lorsque l'on propose une pratique qui remet en question une valeur aussi fondamentale pour le bien commun de la société et la définition même de sa profession, le travailleur de la santé a le droit de s'y opposer. Un travailleur de la santé ne perd pas le droit à son intégrité morale du simple fait d'avoir choisi une profession donnée.
Dans le fameux arrêt Carter, la Cour suprême du Canada a statué qu'aucun médecin ne peut être forcé de prendre part à un suicide assisté et que cette question relève des libertés de conscience et de religion, que protège la Charte. Il n'est pas dans l'intérêt public d'exercer une discrimination envers une catégorie de personnes en fonction de leurs convictions morales ou de leurs croyances religieuses. Ce n'est pas ainsi que l'on crée une société plus tolérante, plus accueillante ou plus pluraliste. Quel paradoxe de proposer tout cela au nom de la liberté de choix.
Heureusement, six autres ordres des médecins n'exigent pas le transfert de soins. Nous avons soumis plusieurs solutions possibles pour que le gouvernement fédéral veille au respect des droits régis par la Charte d'un bout à l'autre du pays. Nous avons demandé un avis juridique, que nous mettrons à la disposition du Comité. Il énumère cinq moyens pour le gouvernement fédéral de protéger le droit de conscience.
L'inaction du gouvernement fédéral nous exposerait à un ensemble de mesures réglementaires disparates et risquerait de causer un préjudice grave à des médecins dévoués, compétents et très soucieux de leur conscience.
Malgré nos réserves, si une loi devait être adoptée, les membres de la coalition n'entraveraient pas la décision des patients. Le gouvernement fédéral pourrait instituer un mécanisme laissant le patient accéder directement à des renseignements ou à des services de transfert de soins par l'intermédiaire d'un tiers, qui évaluerait le dossier après que le patient aurait abordé la question du suicide assisté avec son médecin traitant et arrêté une décision claire en ce sens.
Nos membres ne veulent pas abandonner leurs patients dans leur pire moment de vulnérabilité, lorsqu'ils sont au plus mal. Lorsque nous recevrons une demande d'aide à mourir, advenant qu'une loi soit adoptée, nous tenterons de mettre le doigt sur ce qui motive fondamentalement cette demande de manière à déterminer s'il existe d'autres moyens de gérer la situation. Nous fournirons des renseignements complets sur les options médicales possibles, y compris le suicide assisté. Cependant, une fois qu'une personne s'engagera résolument sur cette voie, nos membres devront se retirer du processus et laisser le patient réclamer lui-même une évaluation.
À l'instar de notre coalition, l'Association médicale canadienne a déclaré que les médecins ne devraient pas être tenus d'assurer le transfert de soins dans les dossiers de suicide assisté ou d'euthanasie. Rappelons au Comité qu'aucun autre État n'oblige les médecins à jouer un rôle dans l'aide à mourir par l'intermédiaire du transfert de soins.
Pour conclure, nous soulignons quatre grands enjeux, à savoir le besoin d'améliorer les soins au patient, y compris en matière de soins palliatifs et de santé mentale, sans oublier le soutien aux personnes ayant une incapacité; la protection des patients vulnérables; le fait de ne pas exiger des médecins, du personnel infirmier et des autres travailleurs de la santé qu'ils offrent une aide à mourir ou qu'ils assurent le transfert de soins, sans qu'ils ne subissent de discrimination du fait de leurs convictions morales; et, enfin, la protection des établissements de santé, notamment les hôpitaux, les maisons de retraite et les centres de soins palliatifs, qui ne sont pas en mesure d'offrir une aide à mourir dans leurs installations en raison de leurs valeurs institutionnelles.
Je vous remercie de votre temps et de votre attention.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Ma question s'adresse à Mgr Collins et à M. Worthen.
Je tiens à préciser que je suis une catholique pratiquante, même si je ne mets pas les préceptes en pratique autant que je le voudrais. Soyez assurés que j'ai beaucoup réfléchi à cette question, que j'ai prié à son sujet, même avant que je devienne députée. J'ai dû faire la paix avec mes croyances personnelles. Je sais à quoi je crois et j'ai bon espoir que, si je devais faire un choix, je serais capable de choisir une solution conforme à ma foi. Cela dit, je suis ici en tant que députée et je ne peux pas imposer mes croyances aux autres. Je suis pleinement consciente que nous devons formuler des recommandations relativement à une mesure législative qui touchera les croyances et les valeurs de tous les Canadiens.
Je suis soulagée de vous entendre accepter l'arrêt Carter, comme nous le devons tous. Comment concevez-vous votre approche, étant donné la multitude de Canadiens, notamment catholiques, qui se tournent vers des établissements de santé confessionnels pour les soins en fin de vie? Comment concevez-vous la prestation de soins en fin de vie aux Canadiens qui réclament une aide médicale à mourir?
Larry vous fournira des précisions.
Je signale d'emblée que nous ne sommes évidemment pas tous d'accord avec le suicide assisté et l'euthanasie. Nous estimons que ces démarches causent des souffrances incroyables à toutes sortes de personnes, ce qui nuit à la société dans son ensemble. Au final, elles causent d'immenses souffrances aux personnes les plus vulnérables, y compris celles qui envisagent le suicide et d'autres solutions semblables. Nous savons cependant que, de toute évidence, comme vous le dites, les gens s'engagent sur cette voie en réaction à la décision de la Cour suprême, mais les personnes... Loin de moi l'idée de soutenir que j'empêcherai par mes paroles les choses de progresser. Il existe une procédure parlementaire, et ce n'est pas à moi de m'y immiscer. Je dirai simplement que beaucoup, beaucoup de Canadiens, surtout parmi ceux qui ont un rôle éminemment direct et intime en matière de soins, sont profondément bouleversés que notre pays s'engage sur cette voie. La procédure que vous êtes en train de concevoir, quelle qu'elle soit, doit selon moi protéger leur conviction profonde en ce sens, protéger leur conscience. Je me réjouis que l'Église unie soit du même avis. Je crois que cela doit s'appliquer non seulement aux particuliers, mais aussi aux établissements.
Il existe des moyens de gérer le dossier tout en protégeant le droit de conscience. Je crois que Larry en a parlé, mais il veut peut-être en dire un peu plus à ce sujet.
Oui, la proposition que nous laisserons est celle dont nous avons discuté en long et en large avec l'Association médicale canadienne, qui l'a approuvée. Essentiellement, le médecin ferait part au patient de son objection de conscience relativement au suicide assisté et à l'euthanasie, il discuterait de la question avec lui en lui donnant de l'information sur toutes les options possibles, puis il se retirerait simplement du processus en laissant le patient demander lui-même de faire l'objet d'une évaluation pour obtenir de l'aide à mourir. Nous espérons que les gouvernements fédéral ou provinciaux mettront sur pied des services d'information et de transfert de soins pour que les patients qui ont discuté de la question avec leur médecin traitant puissent y recourir directement. Nous avons soumis cette proposition à des théologiens, aussi bien évangéliques que catholiques romains, et ils la jugent acceptable sur le plan moral. Ce serait selon nous un moyen pour le médecin de continuer à prendre son patient en charge sans nuire à la relation médecin-malade, tout en laissant le patient en arriver à sa propre décision, sans obstruction de la part du médecin.
Seriez-vous donc ouvert à l'idée de devoir informer, alors? Non pas un transfert de soins en tant que tel, mais simplement l'obligation d'informer une autre entité que le patient a réclamé une aide médicale à mourir?
Nous ne sommes pas tout à fait du même avis que le Groupe consultatif d'experts provinciaux et territoriaux. Selon ses recommandations, il reviendrait au médecin d'informer la tierce partie. Or, nous jugeons que ce serait inacceptable de devoir assumer cette responsabilité et que c'est plutôt au patient lui-même de faire la démarche. Si le patient était incapable de s'en charger, ce qui se produirait normalement en établissement, on pourrait alors envisager de transférer le patient d'une manière permettant à un autre médecin de l'établissement de répondre à ses préoccupations.
Je remercie les témoins de leur présence. C'est très intéressant.
J'ai effectué des recherches sur le Conseil unitarien et j'ai constaté que l'Église unie n'a fondé aucun hôpital. J'ai toutefois trouvé de nombreux hôpitaux confessionnels catholiques.
Je remercie Mme Shanahan de sa question, mais aussi d'avoir souligné que nous devons nous garder d'imposer nos croyances aux Canadiens. Cependant, il faut également tenir compte de notre foi et agir selon notre conscience. Il a aussi été question de protéger le droit de conscience des médecins, peut-être en effectuant un transfert de soins au lieu de s'occuper eux-mêmes du patient.
La plupart des médecins m'ont dit... À vrai dire, je crois que c'est 70 % des médecins qui ne veulent pas être tenus d'effectuer un transfert de soins; autrement dit, 30 % des médecins, soit 24 000 personnes, sont prêts à le faire. Pour ce qui est des 70 %, je pense que la majorité des Canadiens estiment qu'il ne faut pas les forcer à participer à un suicide assisté ou à une euthanasie ni à un transfert de soins.
Si je ne m'abuse, c'est une sénatrice qui a dit que les établissements en tant que tels n'ont pas de conscience. À votre avis, les établissements ont-ils un système de valeurs allant dans un sens ou dans l'autre? Un établissement devrait-il avoir le droit de dire non?
Une harmonisation est-elle possible? Certains établissements, certains hôpitaux, un hôpital catholique par exemple, pourraient ne pas être tenus d'effectuer le transfert de soins parce qu'ils offrent des soins de santé. On pourrait les qualifier d'hôpitaux proposant des soins de santé et une mort naturelle, alors que d'autres hôpitaux proposeraient autre chose. Avez-vous des commentaires à ce sujet?
Je crois qu'il est tout à fait vrai de dire que les établissements sont bien plus que des murs et des planchers. On ne regarde pas un peu partout en disant... Ce sont les personnes qui font les établissements. Pensons par exemple aux Soeurs de Saint-Joseph, aux Soeurs grises, aux multiples groupes qui offrent des soins empreints d'amour dans ces endroits. Les établissements ne sont pas des choses, ce sont des communautés. Ils ont des valeurs, et c'est pourquoi les gens s'y font soigner. C'est pourquoi ils les choisissent.
Par exemple, lorsque les gens se rendent à un hôpital — je pense entre autres à l'hôpital St. Michael, à l'hôpital St. Joseph, au Centre Providence, qui offre un fantastique programme de soins palliatifs... Ils savent que leur confiance est bien placée lorsqu'ils s'adressent aux soeurs ou à l'Église. C'est tout aussi vrai pour les établissements juifs ou protestants, les établissements du même ordre, et il y en a beaucoup. Dans mon propre diocèse, il y en a vraiment beaucoup. Ils ont confiance, car ils savent que nous revendiquons certaines valeurs, des valeurs qui importent à l'ensemble de la société. Les partis politiques ont des valeurs. D'autres institutions ont des valeurs. Ce ne sont pas des choses objectives. Ce ne sont pas des choses matérielles. C'est très important pour l'ensemble de la société.
Le gouvernement finance ces établissements parce qu'ils font de l'excellent travail. Ils offrent aux gens de la variété, de la diversité, du choix, pour ainsi dire, et ça, c'est très, très important.
Je dirais que les établissements ont une âme. Je pense à celui qui est à deux pas de chez moi, l'hôpital St. Michael, avec ses anges urbains. Il est un symbole d'espoir pour les gens. Porter atteinte aux fondements mêmes d'un établissement nuirait concrètement à la société. La collectivité entière deviendrait beaucoup plus dure, plus froide, plus cruelle si elle n'avait pas sous les yeux l'exemple des communautés confessionnelles qui évoluent sur le terrain, dans la rue, jour après jour, pour prendre soin des personnes qui en ont le plus besoin. Je ne crois pas qu'il faille leur nuire ou les attaquer.
Merci beaucoup, cardinal Collins.
Je m'interroge sur les garde-fous relativement au droit de conscience. Vous avez dit avoir des idées par rapport aux médecins qui ne voudraient pas agir dans le contexte d'un régime fédéral. J'ai entendu dire que l'une des suggestions serait de criminaliser le fait d'obliger quelqu'un, médecin ou établissement, à prendre part au processus.
Est-ce l'une des solutions que vous envisagiez?
Oui.
L'avis juridique que nous avons demandé propose au total cinq options distinctes. Comme le prévoient les documents de certains ordres des médecins, les médecins qui choisissent de pratiquer l'euthanasie sont protégés contre la discrimination de la part d'établissements confessionnels, alors nous demandons aussi que les médecins qui refusent de la pratiquer le soient tout autant, ce qui pourrait être accompli au moyen d'une loi qui criminaliserait la coercition visant à obliger quelqu'un à prendre part à ce genre de démarche.
Merci beaucoup, monsieur le président.
Je remercie tous les témoins. En particulier, je vous remercie, cardinal Collins, d'avoir insisté sur l'idée que le Comité doit se pencher sur la question des soins palliatifs. Je vous en sais gré.
Je veux revenir sur ce que M. Warawa vient de dire dans sa question, à M. Worthen, je crois. Je paraphrase un document intitulé Interim Guidance, de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. On y lit que le médecin doit assurer un transfert de soins efficace et rapide à un médecin ou un organisme qui n'a pas d'objection, qui est disponible et qui est accessible. Dans ma province, la Colombie-Britannique, l'organisme équivalent précise que le médecin doit assurer un transfert de soins efficace. Ces règles s'inscrivent dans le contexte de la protection du droit de conscience des fournisseurs de soins de santé.
Vous avez dit que l'obligation d'assurer le transfert de soins porterait atteinte au droit de conscience de certains médecins et qu'il faudrait plutôt prévoir un mécanisme par lequel une tierce partie serait chargée d'informer le patient, de procéder à l'évaluation de son dossier et de lui fournir des services. J'ai quelques réserves, cependant, parce que d'autres témoins nous ont affirmé que le simple fait de dire à quelqu'un qui désire exercer un droit protégé par la Constitution de consulter les Pages jaunes ou de lui fournir un numéro 1—800 ou une adresse Internet ne suffit pas à remplir l'obligation d'assurer un transfert de soins efficace.
J'essaie de comprendre ce que vous proposez, en particulier en ce qui a trait aux conséquences de votre recommandation, si elle était retenue, sur le droit à un accès « efficace » pour les Canadiens en région éloignée.
Merci de votre question. Elle est excellente.
Je crois qu'il doit y avoir davantage de... Notre proposition ne vise pas simplement à dire aux gens de consulter les pages jaunes, loin de là. Nos médecins sont dévoués au maintien de la vie et du bien-être de leurs patients; ils voudraient donc conserver les liens médecin-patient. Ils voudraient discuter de cette importante décision avec leur patient. Ils voudraient prendre le temps de déterminer les motifs de la demande. Ils voudraient aussi s'assurer que leur patient puisse obtenir l'évaluation qu'il souhaite, le cas échéant. Ils ne voudraient pas s'opposer à cela.
Nous ne voudrions pas qu'au Canada, on en soit réduit à joindre l'opératrice pour obtenir un numéro. Selon moi, il faudrait répondre avec compassion à ces gens, car bon nombre d'entre eux vont avoir besoin de services, de soutien et d'aide. Selon l'Association médicale canadienne et, je crois, les recommandations du groupe consultatif provincial-territorial d'experts, il s'agirait d'offrir des services de soutien et que la personne puisse obtenir une évaluation complète et appropriée. Il n'est pas question de référer quelqu'un aux pages jaunes; il s'agit d'une démarche exhaustive.
Je crois que cette question est vraiment importante dans les collectivités éloignées, car même dans les régions éloignées il pourrait y avoir un ou deux médecins. Ces deux médecins pourraient ne pas être prêts à aider quelqu'un à mourir. Cela signifie qu'il serait important que cette personne puisse avoir accès à un tel service, et je crois qu'il est de la responsabilité du gouvernement de s'assurer qu'il existe un tel service, et que les gens y aient accès.
Dans le trop peu de temps qu'il nous reste, j'aimerais passer à l'aspect institutionnel. Nous avons parlé de la conscience du fournisseur de soins de santé. J'aimerais revenir à l'argument institutionnel, et soumettre sans ambage que si un établissement comme celui dont le cardinal a parlé reçoit des fonds publics, ne devrait-il pas être obligé d'assurer à tous les Canadiens les droits constitutionnels dont ils jouissent actuellement?
Je comprends l'aspect professionnel, et vous avez présenté de bons arguments à ce sujet, mais je ne comprends toujours pas pourquoi un organisme qui reçoit des fonds publics ne devrait pas être obligé d'assurer les droits constitutionnels dont jouissent l'ensemble des Canadiens.
En un mot, je dirais que c'est mal interpréter le jugement Carter que de dire qu'il faut un médecin ou un établissement pour offrir ce service. Selon ce jugement, les Canadiens y ont droit, mais chaque médecin et chaque établissement n'est pas tenu de le leur offrir.
Mais qu'arrive-t-il s'il n'y a qu'un seul établissement dans une région éloignée du Nord de l'Ontario?
Cela se produit tout le temps dans le monde des soins médicaux. Certaines procédures ne sont offertes que dans certaines régions. La décision revient au gouvernement. Les ministères de la Santé ne peuvent se défiler dans ces cas.
Si la Cour suprême a rendu sa décision, les ministères de la Santé devront trouver des façons d'offrir ces services. Si cela signifie qu'ils doivent envoyer un médecin jusqu'à un patient... cela arrive fréquemment.
Madame Ng, vous avez dit que l'accès devrait être égal et que les médecins doivent transférer les patients s'ils ont une objection de conscience. Quelle est l'opinion du Conseil unitarien s'il ne s'agit plus uniquement d'un médecin, mais d'un l'hôpital confessionnel qui s'objecte à l'aide médicale à mourir? Le Conseil unitarien...
Nous sommes conscients qu'il existe de nombreux établissements confessionnels qui offrent des soins palliatifs. Il est encore plus important dans ces situations qu'on procède à un transfert efficace des soins, comme on l'a dit, en particulier en régions éloignées. Chaque Canadien a le droit constitutionnel d'obtenir de tels soins, et la ligne est mince entre protéger le droit de conscience du médecin et s'assurer que les droits du patient n'ont pas été bafoués. Il doit y avoir un bon mécanisme. Qu'il s'agisse d'une recommandation directe d'un médecin ou d'une recommandation par un tiers, le tout doit se dérouler sans anicroche. Je crois que si une personne s'adresse à un établissement ou un centre de soins palliatifs confessionnel, elle devrait savoir à l'avance qu'on y pratique certaines valeurs morales.
Pour revenir à la question précédente au sujet des établissements financés par des fonds publics, nous croyons que de tels établissements devraient offrir l'aide médicale à mourir.
Nous croyons aussi au caractère sacré de la vie, mais nous ne pensons pas que la vie devrait être prolongée et maintenue à tout prix. Nous croyons que la qualité de la vie est elle aussi importante. Il n'y a pas de dignité ou de compassion lorsqu'une personne est en phase terminale, qu'elle est en fin de vie et qu'elle ne peut plus prendre soin d'elle. Son corps l'a abandonnée, elle souffre et ne peut plus s'occuper d'elle-même. Il n'y a aucune dignité là-dedans.
Mon partenaire est mort il y a un peu plus de deux ans. Il a été diagnostiqué au début des années 2000 et il a vécu plus longtemps que ce que les médecins avaient prédit. Il a eu la chance de recevoir d'excellents soins dans un établissement de soins palliatifs. Mais aurait-il souhaité avoir accès à une aide médicale à mourir? Oui. Il souffrait. Il n'était jamais confortable. Il ne se reconnaissait plus. Si on oblige une personne à vivre plus longtemps parce qu'un médecin ne souhaite pas offrir ce genre de service, alors on bafoue ses droits constitutionnels.
Je crois qu'un processus d'examen permet de s'assurer que les bons mécanismes sont en place. Au moment de la mise en oeuvre de cette pratique et de cette loi, nous ne saurons pas à quoi tout cela ressemble. Donc, pour aider autant l'établissement que le médecin à faire des choix judicieux, je crois qu'il faudrait procéder à un examen exhaustif de la nature de la demande, de la façon dont elle a été traitée et de la façon dont l'établissement et le médecin s'en sont occupé. Cela sera bénéfique à l'établissement et au médecin.
Je crois qu'il devrait s'agir d'un tiers objectif, comme un comité mis sur pied par divers intervenants... Il ne devrait pas s'agir de l'établissement ou du médecin qui ont prodigué les soins. Il faut que cela soit fait en toute objectivité. Je crois que cet examen est encore plus...
Pensez-vous qu'on pourrait confier cette tâche au bureau du coroner? Ce que je veux dire, c'est pensez-vous qu'il faut créer une nouvelle institution, ou est-ce qu'on pourrait recourir à une institution qui existe déjà dans chaque province et territoire?
Je crois qu'il existe diverses options, à la condition que le processus ne soit pas biaisé. Il doit y avoir un processus permettant de s'assurer que les examens seront objectifs et qu'il n'y aura pas d'idées préconçues.
Bienvenue aux témoins, et merci pour vos exposés
Votre Éminence, j'apprécie votre opposition fondée sur des motifs religieux à l'aide médicale à mourir, mais là n'est pas la question. La Cour a rendu une décision et nous sommes liés par cette décision. L'aide médicale à mourir est un droit constitutionnel pour ceux qui y sont admissibles. Je comprends vos objections et vos arguments concernant les objecteurs de conscience et que personne ne soit forcé à participer. Mais il me semble toutefois, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, que ce dont il s'agit vraiment ici, c'est de se mettre à la place du patient. Il s'agit des droits et des convictions du patient.
Vous préféreriez peut-être qu'il n'y ait pas d'aide médicale à mourir dans ce pays, mais ce n'est pas le cas. Donc, quelles précautions particulières faudrait-il recommander afin d'empêcher toute forme d'abus et de protéger les personnes vulnérables? Je crois que nous aimerions tous accorder toutes les mesures de protection possibles aux personnes vulnérables, mais que devrions-nous recommander pour permettre l'aide médicale à mourir tout en offrant les mesures de protection appropriées aux personnes vulnérables?
Je suis persuadé que bien des gens, dont certains se trouvent autour de cette table aujourd'hui, sont déterminés à ce qu'on offre l'aide médicale au suicide partout au pays. Manifestement, à la suite du jugement Carter, c'est l'intention de ce Comité.
Comme je l'ai dit clairement, je ne crois pas que c'est la voie que ce pays devrait emprunter. Loin de moi l'idée de suggérer qu'il devrait y avoir trois médecins, deux médecins ou un médecin. Je ne crois pas que cela devrait exister, alors je ne peux convaincre...
Je suis persuadé que d'autres s'en chargeront, mais personnellement, je n'y crois pas. Je crois par contre en la liberté de conscience, et qu'il faut protéger les droits de ceux qui prodiguent quotidiennement avec compassion des soins à ceux qui en ont le plus besoin. Je crois aussi que d'autres options, comme les soins palliatifs, devraient bénéficier d'un financement direct.
Encore une fois, vous prêchez à des convertis, car nous sommes tous d'avis que toute la population devrait pouvoir avoir accès plus facilement à de meilleurs soins palliatifs. Mais ce n'est pas la question dont nous sommes saisis. Ce dont il est question, et M. Worthen pourrait peut-être répondre de façon plus précise... Vous avez dit que la protection des personnes vulnérables posait problème. Que peut-on faire pour protéger ceux qui sont vulnérables dans le cadre d'un régime qui permet aux personnes admissibles de se prévaloir de leur droit constitutionnel à bénéficier de l'aide médicale à mourir?
Je partage l'opinion du cardinal à ce sujet. J'ai passé un certain temps avec le Dr Theo Boer, le déontologue médical des Pays-Bas, il y a un an et demi. Il faisait partie de la commission sur l'euthanasie de ce pays et son rôle consistait à examiner les cas. Il a dit qu'ils avaient examiné chacune des soi-disant mesures de protection de la loi néerlandaise, et il m'a expliqué que les médecins les avaient contournées dans certains cas. Une étude a démontré que dans environ 20 % des cas, les médecins ont pratiqué une euthanasie alors qu'ils pensaient effectuer une sédation palliative.
Pendant mes discussions avec le Dr Boer, j'ai dit qu'il me semblait que ces soi-disant mesures de protection ne servaient qu'à aider à vendre le concept de l'aide au suicide.
Manifestement, s'il y a des mesures de protection et que les médecins ou d'autres professionnels de la santé les ignorent ou les contournent, alors c'est au conseil disciplinaire du Collège des médecins ou de l'association des infirmiers et infirmières qu'il revient d'agir.
Malheureusement, quand on regarde ce qui se passe dans ces pays, les médecins ne reçoivent qu'une petite tape sur les doigts.
Ils reçoivent une lettre.
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'une fois qu'on accepte l'idée que le meurtre de patients sanctionné par l'État est moralement acceptable, il se crée alors une brèche et il devient presque impossible de stopper le processus.
J'aimerais vous remercier tous de vos commentaires. Ils me donnent beaucoup plus à réfléchir que je ne le croyais.
Cardinal Collins, vous avez dit que vous ne vouliez pas participer à la formation ou à la création... je vais donc m'adresser aux deux autres participants.
Toujours en ce qui concerne les mesures de protection, nous avons entendu certains témoins dire qu'elles devraient être de nature médicale. Si une personne est intéressée, il existe un processus à un médecin, voire deux médecins, avec un temps d'attente à déterminer. D'autres témoins ont dit qu'il faudrait retirer ce processus à la communauté médicale pour en faire un processus juridique ou quasi juridique.
J'aimerais connaître votre opinion au sujet de ces options ou si, selon vous, il existe une autre option concernant les mesures de protection qu'il faudrait envisager au moment de déterminer ce qu'il convient de faire pour protéger les personnes vulnérables. Comment en arriver au délai de réflexion approprié, tant pour le patient que pour les fournisseurs de soins, et dans quel domaine? Y a-t-il quelque chose que nous n'aurions pas envisagé dans le domaine juridique ou médical?
C'est une idée que je lance comme ça. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Nous avons étudié l'exemple de divers pays ayant légalisé l'aide médicale à mourir. En général, le problème, c'est que différents facteurs peuvent être en cause lorsqu'un patient exprime au médecin sa volonté de mourir. La plupart d'entre eux sont du domaine du gérable. Si on s'attend à ce qu'un médecin soit en mesure de procéder à l'évaluation complète requise pour vérifier que la personne n'agit pas sous la contrainte, le hic, c'est qu'aucune instance n'est prête à débloquer les fonds pour que ce soit fait comme il se doit.
Vous dites que la participation de deux médecins constituerait une mesure de protection... Dans les autres pays, on constate la pratique qui consiste à « magasiner ses médecins »; lorsque les gens n'obtiennent pas la réponse attendue des deux premiers médecins, ils vont en consulter un troisième, un quatrième, un cinquième. Ces gens trouveront éventuellement un médecin qui croit en l'autonomie absolue du patient et qui estime que les personnes qui souhaitent mourir devraient pouvoir mettre fin à leurs jours.
En fait, même le terme « mesure de protection » nous pose problème. Habituellement, ce terme s'applique à n'importe quelle structure que nous puissions créer pour pouvoir apaiser notre conscience par rapport à la façon dont on donnera la mort à ces gens vulnérables. Les critères de la décision Carter comprennent les personnes handicapées.
Il est très fréquent — cela arrive chaque semaine — que des patients disent à leur médecin qu'ils souhaitent mourir: lorsqu'ils viennent de vivre une situation traumatisante sur le plan psychologique, lorsqu'ils viennent d'apprendre qu'ils sont atteints d'une maladie grave ou lorsqu'ils viennent de devenir paraplégiques ou quadriplégiques. Bien des facteurs peuvent susciter dans l'esprit d'une personne la volonté de mettre fin à sa vie. Il faut nous demander si notre société se soucie assez de ces gens pour les aider en affectant les ressources nécessaires, ou si nous finirons par les euthanasier en nous dégageant essentiellement de toute responsabilité.
J'aimerais aussi entendre l'autre participante.
Madame Ng, que pensez-vous de l'idée des mesures de protection?
Il est très important de protéger les personnes vulnérables, et, pour cela, j'estime que l'évaluation de la compétence est essentielle.
Il est ici question de deux choses différentes: la protection des personnes vulnérables et les mesures permettant de s'assurer que la personne qui demande de l'aide médicale à mourir est certaine de ce qu'elle demande. Voilà où entre en jeu le processus d'évaluation approfondie.
Je crois que vous avez fait valoir un excellent argument en disant que la personne ne souhaite peut-être pas mourir, mais seulement sortir de la situation où elle est. Voilà où l'évaluation de la volonté de suicide pourrait s'avérer utile. Si d'autres solutions permettent d'aider plus sainement les personnes ayant des troubles de santé mentale, elles devraient leur être offertes.
La différence, par contre, c'est que, lorsqu'il est question de gens atteints d'une maladie incurable, les perspectives sont peu réjouissantes, n'est-ce pas? Il est donc très important de procéder à une évaluation rigoureuse et approfondie. Le patient doit absolument comprendre les conséquences de sa décision pour lui-même et sa famille. Il doit connaître tous les traitements qui s'offrent à lui. À mon avis, l'important, c'est que le patient en vienne à choisir librement cette option après avoir considéré toutes les autres possibilités, et la demande d'aide médicale à mourir doit venir du patient, et non d'une autre partie. En ce qui concerne la protection des personnes vulnérables, on craint que quelqu'un d'autre puisse demander la mort du patient. Nous voulons absolument éviter qu'une telle chose se produise; la demande d'aide médicale ne doit donc pas provenir d'une autre partie, mais du patient.
Je vous remercie beaucoup, et je remercie les témoins de s'être déplacés.
Monsieur le cardinal Collins et monsieur Worthen, votre point de vue est rafraîchissant. Je dirais, respectueusement, que j'aurais aimé que ce point de vue soit défendu plus souvent au Comité.
J'aimerais soulever deux questions. Si vous êtes d'accord, je vais les soulever en même temps, puis vous laisser le reste de mon temps pour y répondre comme vous le voulez.
Je crois comprendre que la notion de dignité, un mot que nous entendons souvent au Comité, est aussi très importante dans la tradition catholique, mais je crois qu'on utilise parfois les mots « dignité » et « compassion » sans leur donner un sens précis.
Monsieur le cardinal Collins, pourriez-vous nous parler un peu du sens du mot « dignité » dans la tradition catholique et nous le définir? Évidemment, nous voudrions tous que les gens soient traités avec dignité au moment de leur mort. Il faudrait donc peut-être réfléchir un peu à ce que signifie vraiment la dignité.
J'aimerais aussi entendre parler davantage des soins palliatifs. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que les soins palliatifs sont une bonne chose et qu'il faudrait qu'il y en ait davantage. Selon moi, il faut même aller jusqu'à reconnaître que les soins palliatifs ne sont pas seulement souhaités, mais nécessaires.
Il est clairement dit ceci dans le rapport du groupe d'experts, et je cite, qu'une demande d'aide médicale à mourir ne peut pas véritablement être volontaire si la personne qui la fait n'a pas accès à des soins palliatifs pour alléger ses souffrances. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout d'un choix autonome si nous continuons d'offrir des soins palliatifs à une infime partie de la population canadienne. En fait, si nous allons de l'avant sans respecter la conscience des institutions, je crains que cela entraîne la disparition de services confessionnels de soins palliatifs qui ne seront pas prêts à offrir de l'aide médicale à mourir.
Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez du sens de la dignité et de la place centrale qu'on doit accorder aux soins palliatifs?
D'accord. Je vais commencer par le point très important que vous avez soulevé au sujet de la dignité. Chacun peut avoir une opinion ou un point de vue différent à ce sujet.
Je dirais que la dignité vient de l'intérieur de la personne. Selon moi, même une personne sans convictions religieuses peut concevoir la dignité d'un point de vue strictement humain. La dignité ne provient pas de l'extérieur. Du point de vue de la foi, elle vient de l'idée que chaque personne est un enfant de Dieu, qu'elle est inhérente. Chaque personne doit être traitée avec respect.
Jean-Paul II avait-il une dignité? Lorsqu'il skiait dans les montagnes à 58 ans, il avait une dignité. Avait-il une dignité dans les dernières années de sa vie, lorsque son corps se dégradait? Je dirais qu'il avait alors une dignité, comme il en avait une aux autres moments de sa vie. La dignité vient de l'intérieur de la personne. Je dirais que la dignité vient du respect qu'on témoigne à une personne, et c'est pourquoi nous devrions entourer les gens de soins. Pensez à Mère Teresa. Les personnes dont elle s'occupait avaient-elles une dignité? Oui, et Mère Teresa essayait d'alléger leurs souffrances et de leur donner les soins dont elles avaient besoin. La dignité vient de l'intérieur. Je dirais que la dignité vient de Dieu. Depuis des centaines d'années, je dirais même depuis quelques milliers d'années, nous entourons une personne de soins par respect pour sa dignité. C'est pourquoi nous croyons qu'il n'est pas acceptable de tuer quelqu'un. Pour nous, ce n'est tout simplement pas bien. Ce n'est pas ainsi qu'on respecte la dignité des gens.
En ce qui concerne les soins palliatifs, j'estime qu'il faut non seulement en parler, mais que le gouvernement fédéral, les provinces, les municipalités et, sans aucun doute, le secteur privé devraient aussi s'en occuper. Je peux dire que dans mon diocèse — je ne peux pas parler pour les autres confessions religieuses —, il y a diverses initiatives. Pas plus tard que cet après-midi, il a été question d'ouvrir un autre centre de soins palliatifs au centre de Toronto. C'est ce que nous faisons. Nous sommes sur le terrain. Nous offrons des soins. Nous soignons les gens. Mais je crois qu'il serait très utile que l'argent soit au rendez-vous. À quoi consacrons-nous des fonds au Canada? Je pense que l'argent devrait servir à soigner les gens, qui ont une dignité intérieure, de leurs premiers moments sur terre jusqu'à leurs derniers instants. Je crois qu'il ne faut pas seulement en parler, mais agir.
Je vous remercie, monsieur le président.
Madame Ng, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus du processus d'examen après la mort d'un patient. Nous avons entendu les témoins dire, par exemple, que cet examen était très important. La collecte de données et les mécanismes de surveillance pourraient permettre un examen continu de la loi afin de la mettre à jour et de la faire évoluer. On a dit que cette supervision pourrait se faire conjointement par le fédéral, les provinces et les territoires. Vous avez parlé de l'importance de cet examen. Pourriez-vous nous en dire davantage?
Je crois que nous tirons des leçons de nos erreurs. Nous ne savons pas vraiment comment les choses vont se passer dans la société canadienne. Les opinions se partagent souvent en deux camps bien distincts. Je crois qu'un examen servirait tous les camps. Sans examen, nous ne saurons pas ce qui aura été bien fait et ce qui pourrait être amélioré. Nous ne saurons pas si les soins palliatifs peuvent régler une bonne partie des problèmes que connaissent les gens qui ont une maladie incurable. S'il s'agissait d'une entreprise conjointe entre le fédéral, les provinces et les territoires, le processus d'examen permettrait d'obtenir des réponses à bien des questions que nous nous posons actuellement et nous aiderait à vérifier, premièrement, que les processus qui fonctionnent bien seront améliorés et communiqués aux autres intervenants et, deuxièmement, que les processus qui ne fonctionnent pas aussi bien seront aussi améliorés, surtout dans les régions éloignées, dans les cas où les médecins agissent selon leur conscience et dans les cas où les professionnels de la santé ne sont pas assez formés ni informés. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la mise en oeuvre de ces services se fassent sans heurts.
En ce qui concerne la surveillance et la rétroaction dans le processus législatif, quelles données ce processus permettrait-il, selon vous, de recueillir?
Voici quelques exemples: la façon dont l'évaluation de compétence se fait; la façon dont les médecins discutent avec leurs patients; l'aisance des patients à aborder le sujet avec leur médecin, dans la mesure où certains médecins ne sont pas prêts à offrir des soins de ce genre; la question de savoir si l'institution dispose de ressources suffisantes pour soutenir à la fois le patient et son personnel médical lorsqu'une telle discussion a lieu; la présence de deux médecins, si cette condition change quelque chose dans la demande du patient; les médicaments employés; la question de savoir si certains patients demanderont d'administrer eux-mêmes le médicament ou si celui-ci sera nécessairement administré par un médecin. Je crois que la question de savoir si les membres de la famille auront un rôle à jouer est importante. Tout cela soulève aussi la question de la coercition et de la protection des personnes vulnérables. Les membres de la famille pourraient exercer des pressions subtiles d'un côté comme de l'autre. Il est aussi important que le processus d'examen couvre ces questions intangibles.
L'une des choses les plus importantes que j'ai dites au sujet de l'accès équitable, c'est l'accès des régions éloignées à ces services. Son Éminence a parlé d'un processus de renvoi à un tiers. En principe, nous ne sommes pas contre, mais si un tel processus crée d'autres obstacles et empêche les patients de demander ces services, et s'il ne fonctionne pas très bien, il faudra créer un meilleur mécanisme.
Certains ont dit que les infirmières praticiennes et d'autres professionnels de la santé pourraient participer à l'administration de l'aide médicale à mourir, à la mort du patient. Est-ce possible, selon vous?
Ce serait possible si les professionnels de la santé en question recevaient l'information, les cours, la formation et le soutien nécessaires. Nous ne disons pas que les médecins devraient être les seuls à le faire, car nous savons que les conditions sont différentes d'une région à l'autre du Canada, surtout dans les régions les plus éloignées. Alors, oui, nous sommes ouverts à ce que d'autres professionnels de la santé puissent participer à l'administration de l'aide médicale et au soutien connexe.
Je remercie les témoins de leur présence parmi nous aujourd'hui et mes collègues, de leurs questions.
Il faut régler cela en deux ou trois minutes pour la prochaine séance.
Sur ce, je suspends les travaux.
Nous reprenons nos travaux.
Nous accueillons trois groupes de témoins.
Nous avons parmi nous l'imam Sikander Hashmi, qui parlera au nom du Conseil canadien des imams.
Nous entendrons deux groupes par vidéoconférence. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale sera représenté par le Dr Tarek Rajii, chef du service de géronto-psychiatrie, et Kristin Taylor, vice-présidente aux services juridiques. La Société canadienne de pédiatrie sera représentée par la Dre Dawn Davies, présidente du comité de bioéthique, et Mary Shariff, professeure agrégée en droit et doyenne associée universitaire à l'Université du Manitoba.
Je rappelle, à l'intention des groupes de témoins, que chaque groupe disposera de 10 minutes en tout et que les membres du Comité disposeront de cinq minutes pour poser leurs questions.
Monsieur Genuis, vous avez la parole.
J'invoque très brièvement le Règlement.
Un autre député et moi avons noté le temps de parole qui m'a été accordé, et je crois qu'il me restait environ 45 secondes quand vous avez indiqué que le temps dont je disposais était écoulé. Je suis certain qu'il n'y avait pas de mauvaise intention de votre part, mais je me demande s'il ne serait pas possible d'accorder ces secondes à un autre membre de notre côté.
Selon le greffier, j'ai dit 20 secondes à Mark, mais il s'agissait de 22 secondes, et d'après ma montre, c'était plutôt 25. J'arrête systématiquement les intervenants après ce délai. S'ils prennent 30 secondes ou plus et que le témoin n'a pas le temps de répondre, je demande à ce dernier de fournir une réponse écrite plus tard.
Merci beaucoup.
Sur ce, je vais, comme précédemment, laisser d'abord la parole aux témoins qui participent par vidéoconférence, au cas où il y aurait des problèmes techniques. Je suivrai également l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste que j'ai sous les yeux. Je vais donc inviter les représentants du Centre de toxicomanie et de santé mentale à faire leur exposé en premier.
Mesdames et Messieurs du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, je vous remercie de nous donner l'occasion de vous présenter aujourd'hui notre point de vue sur cette question d'une très grande importance.
Je me nomme Tarek Rajji. Je dirige le service de géronto-psychiatrie du Centre de toxicomanie et de santé mentale. Ma collègue Kristin Taylor, vice-présidente aux services juridiques, m'accompagne.
Le Centre de toxicomanie et de santé mentale est l'un des plus grands centres universitaires des sciences de la santé oeuvrant dans le domaine de la toxicomanie et de la santé mentale au Canada. Nous combinons les soins cliniques à la recherche et à l'éducation afin de transformer la vie des personnes atteintes de maladie mentale ou de toxicomanie. Nous avons au-delà de 500 lits en établissement, 3 000 employés, plus de 300 médecins et plus de 100 scientifiques. Nous traitons plus de 30 000 personnes par année.
Quand il s'agit de maladie mentale, l'aide médicale à mourir est une question extrêmement complexe. La Cour suprême n'a pas défini explicitement les états pathologiques particuliers qui satisfont aux critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir, mais a établi que la « personne adulte capable » doit être « affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances » physiques ou psychologiques « persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. » C'est donc dire qu'une personne souffrant de maladie mentale pourrait être admissible à l'aide médicale à mourir.
Devrait-elle l'être, cependant? Dans l'affirmative, comment envisager la question dans le cadre d'une relation thérapeutique clinique? Comment s'assurer qu'il existe des garanties pour protéger les personnes à qui la maladie mentale donne des idées suicidaires?
Nous n'avons pas encore de réponse à ces questions. Le centre continue d'y travailler. Nous avons chargé un groupe de travail réunissant des spécialistes des questions cliniques, juridiques, éthiques et politiques au sein de notre organisme de tâcher de répondre à ces questions et de déterminer l'incidence que l'aide médicale à mourir aurait sur nos patients, nos cliniciens et notre organisme. Kristin est ici aujourd'hui à titre de coprésidente de ce comité.
Nous voulons exposer au Comité deux idées centrales émises par ce groupe de spécialistes qui, nous l'espérons, contribueront à l'élaboration d'un cadre fédéral sur l'aide médicale à mourir.
Pour commencer, nous avons pensé qu'il faut se demander si la maladie mentale est incurable. Elle est d'ordinaire chronique et épisodique. Selon son évolution naturelle, chez certaines personnes, les symptômes persistent, chez d'autres, ils s'aggravent et chez d'autres encore, ils disparaissent, même s'il s'agit d'une maladie comme la schizophrénie. Nous n'avons pas encore réussi à prévoir quelle sera l'évolution dans chaque cas. Par ailleurs, il existe des traitements efficaces pour la maladie mentale et nous possédons certaines connaissances qui nous aident à personnaliser les traitements. Nous sommes toutefois encore loin de prévoir le traitement qui fonctionnera pour telle ou telle personne.
Les pensées suicidaires comptent parmi les symptômes qui persistent, s'aggravent ou disparaissent. C'est cependant une minorité de patients atteints de maladie mentale qui se donnent la mort. Même si nous connaissons assez bien les facteurs de risque et certaines interventions qui se sont révélées efficaces pour réduire les tendances suicidaires, nous ne pouvons toujours pas prévoir quand un suicide surviendra. L'évolution naturelle de la maladie mentale contraste avec celle des maladies terminales et de certaines maladies physiques chroniques, qui sont irrémédiables en ce sens qu'il faut s'attendre à une mort prochaine.
La maladie mentale peut donc être grave pour certaines personnes. Les symptômes peuvent causer des souffrances psychologiques et parfois physiques persistantes. La souffrance n'est cependant pas synonyme d'incurabilité, et si l'évolution naturelle de la maladie ne conduit pas à une mort inévitable ou prévisible, nous avons la possibilité d'offrir un traitement axé sur le rétablissement.
Les soins de santé mentale axés sur le rétablissement que nous offrons au Centre de toxicomanie et de santé mentale mettent l'accent sur l'espoir et l'acquisition des compétences nécessaires pour vivre avec la maladie mentale et ses symptômes. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur le traitement ou la guérison de la maladie. Par ailleurs, sur le plan des déterminants sociaux de la santé, les personnes atteintes de maladie mentale peuvent être vulnérables: elles peuvent connaître la pauvreté, vivre dans un logement inadéquat et être dépourvues de soutien social. Ces circonstances peuvent exacerber leur souffrance et les amener à penser que leur maladie est incurable.
Dans l'approche axée sur le rétablissement, les professionnels de la santé mentale doivent notamment travailler avec les malades pour les aider à s'en sortir et à s'attaquer aux causes réversibles de leur souffrance. Par conséquent, dans un milieu clinique axé sur le rétablissement, il est toujours possible que la maladie mentale puisse être guérie.
Je vais prendre un exemple clinique pour illustrer mon propos: une femme de 73 ans souffre depuis toujours de façon récurrente du trouble bipolaire et a un désir persistant de mourir nourri par le sentiment d'être inutile et limitée par sa maladie et les déficits cognitifs, les problèmes d'attention et les difficultés à planifier qui l'accompagnent. Cette femme a déjà été mariée, elle a une fille adulte et une petite-fille. Elle a aussi un voisin avec qui elle a des contacts limités. Elle réagit bien aux médicaments qu'on lui donne pour sa maladie, mais continue tout de même de vouloir mourir.
Au cours du traitement, quand je parlais avec elle de la mort, je reconnaissais son désir, je le respectais, mais je le circonscrivais. J'ai surtout cherché avec elle comment affermir sa relation avec sa fille par des visites régulières et de fréquents repas ensemble. Ces rencontres ont fini par se transformer en périodes régulières de gardiennage sur lesquelles sa fille et son gendre comptaient. Cette nouvelle forme de relation a apporté à la patiente une satisfaction inattendue et le sentiment d'être utile. Ces nouveaux sentiments et ces nouvelles expériences n'ont pas fait disparaître son désir de mourir, mais se sont développés en parallèle et s'y sont opposés au quotidien.
Nous avons également examiné la possibilité de renforcer ses liens avec son voisin. À un moment donné, celui-ci a eu un accident vasculaire cérébral, et la patiente a fait partie de son réseau d'aidants naturels.
Ce travail thérapeutique avec elle a duré environ trois ans. Il a été possible parce que la mort n'était ni inéluctable, ni prochaine. Par ailleurs, tout au long de cette période, ce qui a dissuadé la malade de se suicider, c'est la crainte de souffrir ou de garder des séquelles si elle ratait son coup et la honte qui rejaillirait sur sa fille.
La possibilité de choisir de mourir sans douleur avec la sanction d'un médecin aurait-elle éliminé les obstacles au suicide que constituaient la peur de la douleur et la honte et aurait-elle empêché la malade de suivre la thérapie jusqu'au bout?
Le deuxième point que je veux faire valoir est la nécessité de mesures garantissant que les personnes qui souffrent de maladie mentale ont réellement la capacité de consentir à l'aide médicale à mourir.
Outre ce que j'ai dit précédemment au sujet de l'évolution naturelle de la maladie mentale et de ses déterminants sociaux, la maladie et ses conséquences altèrent les perceptions des personnes malades.
En période de crise majeure, par exemple pendant une dépression grave, un épisode psychotique aigu ou un épisode de manie intense, il n'est pas rare que les malades aient une perception sérieusement altérée d'eux-mêmes, du monde et de leur avenir. Parfois, leur sentiment d'impuissance, d'inutilité et de désespoir perdure même quand les symptômes de la maladie mentale sont mieux contrôlés.
Ces altérations de la perception soulèvent des questions quant à la capacité des personnes malades de demander l'aide médicale à mourir pendant les phases aiguës et moins aiguës de leur maladie. De plus, c'est pendant les phases de bien-être relatif que les soins axés sur le rétablissement sont essentiels pour corriger les perceptions altérées qui ont souvent été renforcées par une expérience de vie marquée par une maladie mentale récurrente, les préjugés qui l'accompagnent et parfois les mauvais traitements ou la négligence qui en résultent.
Je vais, encore une fois, me servir d'un exemple clinique pour illustrer ce que je viens de dire: un homme de 55 ans souffre de schizophrénie depuis l'âge de 18 ans. Même avant que la maladie se manifeste clairement, le jeune homme était considéré comme bizarre à l'école, se faisait intimider par ses camarades de classe et était incapable d'exceller dans plusieurs activités scolaires et sociales. Il a continué à subir des échecs jusqu'à la première vraie crise: il était notamment incapable de conserver un emploi, d'avoir une relation amoureuse et de maintenir les relations qu'il avait avant la maladie.
Il n'est pas difficile de percevoir le manque de capacité quand survient un épisode psychotique aigu, mais qu'en est-il en période plus calme? Les échecs et les mauvais traitements à répétition ne contribueront-ils pas à nourrir un sentiment d'inutilité et de désespoir?
Ces perceptions de soi altérées et apprises peuvent peut-être changer grâce à un traitement axé sur le rétablissement plutôt que centré uniquement sur la psychose aiguë.
Dans les deux exemples, nous reconnaissons que certaines personnes souffrant de maladie mentale persisteront à croire que leur maladie est incurable. Ces personnes peuvent également alléguer qu'elles ont la capacité de prendre une décision concernant l'aide médicale à mourir. Dans ces cas, nous pensons qu'un organisme compétent en la matière, comme la Commission du consentement et de la capacité de l'Ontario, doit rendre une décision objective quant à la nature incurable de la maladie de la personne concernée.
Je vous remercie encore une fois, mesdames et messieurs du Comité mixte, de m'avoir permis de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse facile à la question de l'aide médicale à mourir dans le cas des personnes souffrant de maladie mentale.
J'ai tâché aujourd'hui de vous exposer les préoccupations du Centre de toxicomanie et de santé mentale et les défis bien réels auxquels il doit faire face en tant qu'organisme axé sur le rétablissement et visant à transformer la vie des personnes souffrant de maladie mentale. Nous espérons que nos vues et nos recommandations vous aideront à avancer dans votre travail.
Kristin et moi serons heureux de répondre à vos questions.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
J'invite maintenant les représentantes de la Société canadienne de pédiatrie à présenter leur exposé.
Nous vous remercions de nous avoir invitées à témoigner aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir le faire.
Je suis professeure de droit et j'effectue des recherches sur l'aide médicale au suicide et les soins palliatifs depuis 2008 environ. J'ai agi à titre de témoin expert en matière de comparaison des lois sur l'interruption de la vie de différents pays dans le cadre de l'affaire Carter.
Une solution législative possible consisterait évidemment à interpréter l'arrêt Carter de la manière la plus restrictive possible, c'est-à-dire le limiter aux faits précis de cette affaire. Bien entendu, vous pourriez aussi utiliser cet arrêt comme point d'entrée afin d'inclure des individus ou des troubles médicaux qui ne figuraient ni dans les délibérations ni dans la décision de la Cour suprême.
Je suis ici aujourd'hui pour parler de la question des enfants et, en ce qui les concerne, je soutiens que vous ne devriez pas aller plus loin que le jugement de la Cour suprême.
Pour décider à qui l'aide médicale à mourir peut être accordée légalement, les lois sur l'interruption de la vie comportent deux volets directeurs principaux.
Il y a d'abord les critères fondamentaux qui sont, pour nous, les critères d'admissibilité des patients, c'est-à-dire les facteurs qui font en sorte qu'un médecin admet la demande d'un patient. Il y a ensuite les critères procéduraux de soins diligents, à savoir la procédure mise en place pour s'assurer que le patient répond vraiment aux critères fondamentaux.
Comme nous le savons, en rouvrant le Code criminel pour permettre aux médecins qui le souhaitent de fournir des services d'interruption de la vie sans s'exposer à des poursuites, la Cour suprême n'a fait que définir expressément les critères fondamentaux, à savoir la notion d'adulte capable, les problèmes de santé graves et irrémédiables, les souffrances persistantes intolérables pour l'individu et le consentement éclairé à mettre fin à ses jours. La Cour n'a pas clairement établi les critères procéduraux de soins diligents, c'est-à-dire qu'elle n'a pas défini les garanties à mettre en place pour s'assurer que le patient satisfait à ces quatre à six critères d'admissibilité.
Nous savons aussi que la notion d'adulte est un critère fondamental prévu par la Cour suprême, mais que cette dernière n'a pas défini le terme « adulte ». Toutefois, la Cour ne pouvait se prononcer que sur les faits pertinents de l'affaire, ce qu'elle a fait. La question ne touchait tout simplement pas les patients non adultes.
Premièrement, j'estime qu'il n'est pas arbitraire d'exclure les patients non adultes des critères d'admissibilité de la première version de la loi canadienne sur l'interruption de la vie. Je répète que les tribunaux ne disposent d'aucun élément de preuve au sujet des enfants ou des adolescents. Il convient aussi de signaler que les considérations présentées par le juge de première instance, telles que mentionnées par la Cour suprême, rendaient compte de l'absence, dans la société, de consensus clair sur l'aide médicale à mourir, mais de l'existence d'un fort consensus sur le fait que cette aide ne serait conforme à l'éthique qu'à l'égard d'adultes capables et avisés qui y consentent, qui sont atteints d'une maladie grave et irrémédiable et qui font un choix libre.
Deuxièmement, une énorme question d'éthique se pose quant à l'admissibilité à recevoir une injection mortelle d'enfants et d'adolescents se trouvant dans la situation citée précédemment. Cette question éthique n'a pas été prise en compte dans l'affaire Carter et, à ma connaissance, les Canadiens ne l'ont pas examinée soigneusement. En effet, l'analyse juridique canadienne ne peut se fonder sur aucune donnée éthique concernant des mineurs. La Dre Davies abordera la question des données plus en détail.
Troisièmement, certains soutiennent que la loi permet déjà à des mineurs matures de prendre des décisions médicales, même si ces dernières peuvent causer leur décès. Voyons cela d'un peu plus près. Ces cas de décès découlent de la décision d'un enfant de refuser de suivre un traitement, ce qui risque de causer sa mort. C'est une situation tout à fait différente à celle d'un enfant qui est censé consentir à recevoir une injection mortelle.
Quatrièmement, dans la jurisprudence canadienne, il est fréquent de voir que le tribunal passe outre au refus d'un mineur si les chances de survie de ce dernier sont bonnes s'il poursuit son traitement. Nous savons que l'arrêt Carter ne tient pas compte du critère de la maladie mentale. Comment peut-on donc calculer les chances de survie d'un enfant dont le trouble médical est un trouble de santé mentale ou une autre forme de handicap?
Ce qui m'amène à mon cinquième et dernier point, puis je passerai la parole à la Dre Davies.
Il existe effectivement des processus permettant de cerner la capacité d'un enfant à prendre une décision et la maturité nécessaire pour le faire, mais ce processus ne répond pas à la question fondamentale. La décision de la Cour dans l'arrêt Carter ne tenait pas seulement compte de la capacité particulière aux adultes.
Bonjour, je m'appelle Dawn Davies. Je suis médecin en soins palliatifs à l'hôpital pour enfants Stollery, en Alberta. Je représente aujourd'hui la Société canadienne de pédiatrie, dont je préside actuellement le Comité de bioéthique.
Je vous remercie de donner à la SCP l'occasion de prendre la parole devant vous. La mesure législative que vous envisagez est particulièrement importante pour les médecins qui soignent des enfants et des jeunes, et ce, en raison de la complexité des questions d'admissibilité et de consentement. J'ai attiré votre attention sur les éléments cliniques particuliers aux soins prodigués aux enfants gravement malades et sur le recoupement de ces éléments avec la mesure législative sur l'aide médicale à mourir, que je désignerai AMM pour gagner du temps.
La SCP recommande que la démarche complexe qui consiste à évaluer la capacité d'un mineur soit confiée à ses parents et à son équipe clinique immédiate. Comme le précise l'arrêt Carter, les médecins sont en mesure de procéder à cette évaluation.
Comme cela a toujours été le cas auprès des mineurs matures, plus le risque de graves blessures ou de décès est élevé, plus les professionnels de la santé doivent se montrer vigilants dans leur évaluation de la capacité décisionnelle du mineur et de l'absence de contraintes de la part des parents ou d'autres figures d'autorité. Il est aussi important de comprendre que ces évaluations sont parfois difficiles à effectuer et qu'il n'est pas rare que des cas de vie ou de mort soient renvoyés aux tribunaux.
Bien que le comité provincial et territorial d'experts estime que la capacité décisionnelle compte davantage que l'âge, celui-ci n'a consulté ni fournisseurs de soins en pédiatrie, ni parents, ni mineurs. Avant de poursuivre la mise en oeuvre d'une loi qui inclurait les enfants et les adolescents, la SCP recommande vivement une vaste consultation auprès des groupes suivants: des parents d'enfants ayant une grave déficience ou une maladie en phase terminale, ainsi que des parents dont les enfants atteints de telles maladies sont décédés; des professionnels pertinents de la santé pédiatrique; des représentants des principales associations religieuses et de groupes de défense des enfants.
La loi belge sur l'euthanasie des adultes est entrée en vigueur en 2002 et s'est étendue aux enfants en 2014, mais elle a été largement critiquée en raison de l'absence d'une vaste consultation appropriée avant cet ajout.
En outre, aucune donnée pédiatrique n'a été publiée à propos des demandes d'aide médicale à mourir pour des mineurs, de l'opinion des pédiatres canadiens sur l'AMM, ni de leur désir plus spécifique de fournir une aide médicale à mourir à des enfants.
Nous devons prévoir d'où viendront les demandes d'AMM, et nous pensons tout particulièrement aux parents d'enfants incapables. Bien que nous sachions que des mandataires ne pourront pas demander une AMM au nom d'une autre personne, il n'est ni nouveau ni extrêmement rare que des parents d'enfants en phase terminale demandent l'euthanasie de ceux-ci. La prise de décision relative au traitement des enfants incapables repose sur le critère de l'intérêt supérieur. Il se peut que les parents contestent la décision des tribunaux en faisant valoir que le maintien de la vie, telle qu'elle est vécue par leur enfant mourant ou présentant une grave déficience, n'est pas dans l'intérêt de celui-ci.
Des recherches démontrent que les parents sont plus susceptibles de soumettre de telles demandes si la douleur de l'enfant est incontrôlée. Or, les soins palliatifs offerts aux enfants canadiens laissent grandement à désirer, car de nombreux professionnels de la santé en milieu communautaire n'ont pratiquement reçu aucune formation pour offrir ces soins à ce groupe précis. Par conséquent, la SCP recommande l'amélioration des soins palliatifs en pédiatrie, leur financement et leur aménagement de manière à soigner les enfants et leur famille à l'endroit de leur choix, particulièrement à domicile. Étant donné l'évolution rapide de la société depuis la décision Carter et le court délai prévu d'ici l'adoption de la loi, la SCP consacre fermement le droit du médecin à l'objection de conscience à l'AMM, particulièrement dans le cas d'enfants et d'adolescents.
Merci.
Merci beaucoup.
Je passe maintenant au témoin qui se trouve dans la salle avec nous.
Monsieur Hashmi, vous pouvez faire votre présentation.
Je vous remercie, monsieur.
Bonsoir à tous. Mon nom est Sikander Hashmi. Je suis imam à l'association musulmane de Kanata et je suis également membre du Conseil des imams d'Ottawa-Gatineau. Je suis ici ce soir à titre de porte-parole du Canadian Council of Imams.
La tradition religieuse musulmane n'appuie ni n'encourage ni l'euthanasie ni l'aide au suicide. Toutefois, puisque la Cour suprême a déjà statué en la matière, nos préoccupations sur la légalisation de l'aide médicale à mourir tournent autour de la préservation de la vie et de son caractère sacré, ainsi que de la vulnérabilité des patients.
La plupart des Canadiens conviendront que la vie est sacrée et que dans la plupart des circonstances, sinon toutes, il faut s'efforcer de la préserver. Le verset 5:32 du Coran fait ressortir l'importance de sauver la vie et dit que quiconque sauve une vie sauve le monde entier. Nous comprenons que, parfois, les patients qui éprouvent des douleurs et des souffrances extrêmes, et ceux qui s'attendent à la même chose dans l'avenir, puissent souhaiter mettre fin à leur vie. Nous compatissons à leur souffrance. Comme nous l'enseigne notre religion, nous prions pour le soulagement de leurs souffrances et nous faisons de notre mieux pour veiller à leur confort en leur offrant les meilleurs soins possibles.
Ce qui nous préoccupe, c'est qu'on puisse choisir mourir avec l'aide d'une autre personne qui pourrait, dans certains cas, être motivée par des intérêts autres que ceux du patient, ce qui pourrait encourager ou promouvoir, directement ou indirectement, l'aide médicale à mourir. Nous estimons qu'il faut mettre en place de solides garanties pour veiller à ce que ce choix ne puisse être exercé que par ceux qui le font de façon libre et indépendante, après avoir pris une décision éclairée.
Nous proposons que toute demande de ce genre soit étudiée et évaluée par une équipe de fin de vie formée de quatre membres: premièrement, un médecin qui soit idéalement familier avec les antécédents médicaux du patient et qui participe à son traitement; deuxièmement, un psychiatre ou un psychologue qui soit en mesure de comprendre l'état d'esprit du patient et les raisons de sa décision; troisièmement, un travailleur social qui puisse informer le patient des soins à sa disposition et discuter des répercussions possibles de son choix sur lui et sur les membres de sa famille; quatrièmement, un aidant spirituel, représentant de la tradition religieuse du patient, qui puisse offrir des conseils et des avis spirituels si le patient le souhaite.
Cette équipe doit veiller à ce que toutes les options de soins à la disposition du patient lui aient été expliquées clairement sans parti pris; que le patient prenne sa décision librement et sans contrainte ni encouragement d'une autre partie; que le patient comprenne les répercussions de sa décision; que la famille immédiate du patient soit informée du processus, si possible, et qu'un soutien psychologique lui soit offert, et ce, à moins d'avis contraire explicite du patient.
En outre, nous recommandons que l'alinéa 214a) du Code criminel du Canada soit modifié pour veiller à ce que l'incitation au suicide, notamment le recours à un médecin pour mourir, demeure une infraction criminelle. À notre avis, un patient devrait pouvoir obtenir l'aide d'un médecin pour mettre fin à sa vie s'il respecte tous les critères suivants: il a atteint l'âge de la majorité dans sa province; il est en mesure de prendre ses propres décisions; il souffre de problèmes de santé graves et irrémédiables; il est dans une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; il éprouve régulièrement des souffrances physiques insupportables qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'il juge tolérables.
Le patient doit être tenu de signer un formulaire de demande ou, en cas de handicap, être en mesure d'exprimer son souhait clairement et sans ambiguïté par d'autres moyens. Le processus et les procédures pourraient ressembler à ce qui suit:
Le patient informerait le professionnel de la santé de sa demande ou de son désir d'obtenir des soins ou une aide médicale à mourir. L'équipe de soins de fin de vie rendrait visite au patient pour évaluer son admissibilité et l'informer des choix à sa disposition. L'équipe communiquerait avec les membres de la famille, les informerait de la demande et leur offrirait du soutien, à moins d'avis contraire de la part du patient. L'équipe ferait une visite de suivi auprès du patient. Si le patient choisit l'aide médicale à mourir, l'équipe lui ferait signer les formulaires requis. La demande serait ensuite soumise au personnel soignant, qui déterminerait le lieu et le moment de la procédure et trouverait un médecin disposé à aider le patient à mourir. Les détails seraient fournis à la famille immédiate, à moins d'avis contraire de la part du patient. Avant la procédure, si le patient est encore en mesure de communiquer, l'équipe de fin de vie confirmerait une fois de plus sa décision. Dans l'affirmative, le médecin aiderait le patient à mettre fin à sa vie et le décès serait signalé à un registre central fédéral.
À notre avis, les médecins et les établissements de soins confessionnels ne devraient pas avoir l'obligation de pratiquer cet acte médical si leur conscience, leurs croyances et leurs valeurs personnelles ne les autorisent pas à interrompre la vie humaine.
Nous aimerions citer un extrait de l'énoncé du Collège des médecins de famille du Canada concernant les enjeux liés aux soins de fin de vie:
Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes [...] devraient avoir accès à des soins palliatifs qui satisfont aux normes nationales. C’est une question de justice sociale. Les soins palliatifs doivent être offerts dans tous les établissements de soins de santé. De plus, une variété d’établissements de soins de fin de vie doit être disponible.
Tout comme le collège, nous estimons que le financement doit être suffisamment élevé pour garantir que tous les Canadiens auront accès à des soins palliatifs qui satisfont aux normes nationales et répondent aux besoins de chaque collectivité.
Les enseignements de notre foi nous portent à croire qu'il existe un moyen de guérir chaque maladie. Il nous suffit de déployer les efforts nécessaires pour le trouver. Par conséquent, nous recommandons de mettre davantage l'accent sur la recherche médicale afin de trouver des traitements et de meilleures façons de gérer la douleur, plus particulièrement en augmentant le financement et en annulant les compressions visant certains programmes, comme le programme combiné de M.D./Ph.D., qui n'est plus financé depuis juin 2015.
En terminant, nous tenons à rappeler que la religion islamique n'appuie pas et n'encourage pas le suicide assisté ou l'euthanasie. Nous estimons qu'il est nécessaire et possible d'améliorer la qualité de vie des patients et de protéger les personnes vulnérables. Nous espérons que nos propositions s'avéreront utiles pour l'élaboration d'une mesure législative équilibrée et empreinte de compassion.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je m'adresse maintenant aux membres du Comité. Puisqu'il y a trois groupes d'experts, je vous saurais gré de bien vouloir indiquer très précisément à qui votre question s'adresse.
Monsieur Arseneault, vous avez la parole.
J'aimerais poser une question à la Dre Davies à propos de l'âge.
[Français]
Ma question sera brève et portera sur les personnes mineures.
En quoi la détermination de la capacité des enfants à prendre une décision au sujet de leur traitement est-elle différente de la détermination de la capacité des adultes à faire la même chose?
[Traduction]
En gros, lorsque nous évaluons la capacité d'une personne mineure, nous tentons de déterminer si celle-ci peut comprendre pleinement les renseignements qui lui sont fournis, si elle peut évaluer toutes les options qui lui sont offertes et si elle est en mesure de prendre une décision qui demeurerait la même si nous avions de nouveau la même discussion. Nous tentons donc de déterminer si la personne mineure a le niveau de maturité et de raisonnement d'un adulte.
Je pense que plus la personne est jeune, plus il y a des difficultés. Ainsi, différents facteurs entrent en jeu: la personne peut vouloir faire plaisir aux autres, par exemple à ses parents — et parfois même aux conseillers religieux et spirituels de sa famille —, et elle peut même avoir une opinion sur ce qui est bon pour sa famille ou ce qui sera bon pour ses frères et soeurs, par exemple. Je pense que c'est pour cette raison que les tribunaux sont souvent saisis de l'affaire lorsqu'il faut prendre une décision par rapport à la vie ou à la mort, car les choses ne sont pas toujours claires. Je pense que les équipes de soins de santé veulent souvent s'en remettre à une autorité supérieure quand il est nécessaire de prendre une décision parce que l'enfant risque de mourir.
[Français]
Je vous remercie.
Je suis heureux que, dans votre document, vous ayez fait référence au fait que l'arrêt dans la cause Carter nous dit bien que les faits soulignées dans cette cause avaient mené à cette décision et que cela laissait la porte ouverte, comme l'ont dit d'autres intervenants, à d'autres possibilités.
J'aimerais revenir à la question de l'âge. Y a-t-il au moins un consensus dans votre profession, soit celui de la pédiatrie, en ce qui a trait à l'âge minimum où il n'y a aucun doute pour déterminer qu'un enfant ne peut pas donner son consentement libre et éclairé?
[Traduction]
Je ne pense pas qu'il y a un consensus à ce sujet. Même dans les provinces, l'âge du consentement varie énormément, car il se situe entre 14 et 18 ans. À mon avis, la capacité varie grandement d'un patient à l'autre, et on détermine celle-ci en posant des questions à chaque patient.
De façon générale, moins la décision a de conséquences, plus nous laissons la personne mineure jouer un rôle dans cette décision. Par exemple, on peut demander à un très jeune enfant dans quel bras il préfère avoir une injection intraveineuse, car les risques de préjudice sont très faibles. Par contre, certains autres cas sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Je pense par exemple à un enfant qui ne veut pas suivre les traitements de chimiothérapie susceptibles de lui sauver la vie alors que le pronostic est bon, ou encore à un enfant qui ne veut pas d'autres traitements après avoir subi un très grave accident d'automobile.
[Français]
Continuons sur le même sujet.
Au cours de votre carrière, avez-vous été confrontée à un cas d'accident ou de blessures graves chez un enfant en très bas âge qui a eu à décider s'il acceptait ou non une intervention médicale? Avez-vous dû étudier ou évaluer son consentement libre et éclairé? Quel âge avait-il?
[Traduction]
Nous avons été saisis du cas d'un jeune qui a été victime d'un accident catastrophique. Ce jeune était âgé de 17 ans, et donc, au début de sa maladie, il était considéré comme un enfant. Je ne veux pas en dire trop pour des raisons de confidentialité, mais on a dû prendre la décision de traiter cet enfant immédiatement après l'accident, même s'il s'y opposait.
Ma question s'adresse au Dr Rajji.
Docteur Rajji, d'après votre expérience, est-ce que tous les médecins généralistes ont la formation nécessaire pour diagnostiquer des troubles psychiatriques?
Compte tenu de leur formation, oui. C'est un aspect qui est intégré à la formation de tous les médecins généralistes; ils peuvent diagnostiquer un trouble psychiatrique. Parfois, lorsqu'il ne s'agit pas d'un trouble psychiatrique évident, ils peuvent orienter la personne vers un autre spécialiste de la santé.
Comment savez-vous s'il s'agit d'un trouble évident ou non? Pouvez-vous nous donner des explications à ce sujet?
Lorsque je parle d'un trouble « évident », je pense aux étapes que nous suivons pour poser un diagnostic. Du point de vue clinique, il existe un manuel énonçant des critères fort clairs, qui permettent de poser un diagnostic de dépression majeure ou de schizophrénie. Lorsque les symptômes observés ne correspondent pas à l'un des critères ou à l'ensemble des critères énoncés, il faut poser ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, qui est complexe. Lorsqu'il n'est pas évident que la personne connaît un épisode dépressif accompagné d'une psychose ou de schizophrénie, elle est généralement orientée vers un autre spécialiste pour qu'il pose un diagnostic plus précis. C'est ainsi que l'on procède quand les symptômes observés ne correspondent pas à une seule catégorie, à une catégorie simple.
Récemment, le Collège des médecins et des chirurgiens de la Nouvelle-Écosse a publié des normes de pratique. Selon ces normes, lorsque la personne est atteinte d'une maladie mentale grave et irrémédiable, le premier ou le deuxième médecin doit être un psychiatre.
Ma question est donc la suivante. Lorsque, par exemple, vous vous trouvez en présence d'une personne qui a un trouble grave et irrémédiable qui n'est pas un trouble de santé mentale, mais que cette personne a un trouble psychiatrique quelconque, qu'en est-il de la capacité de cette personne? Dans ces situations, est-il nécessaire d'obtenir l'opinion d'un psychiatre? Par ailleurs, est-ce qu'un médecin généraliste, par exemple, pourrait départager un trouble grave et irrémédiable d'un trouble psychiatrique, car celui-ci est peut-être à l'origine de la demande?
C'est une excellente question. Les spécialistes du Centre de toxicomanie et de santé mentale, dont je fais partie, ont aussi discuté de cet aspect.
Je pense qu'il est essentiel d'évaluer de façon approfondie la capacité d'une personne qui est atteinte d'une maladie mentale et qui souffre aussi d'une maladie physique qui pourrait être grave et irrémédiable. Comme vous l'avez mentionné, je pense qu'il sera essentiel de déterminer si la demande d'aide médicale à mourir, par exemple, est motivée par la maladie mentale elle-même ou par la façon dont la personne perçoit sa maladie physique compte tenu de sa maladie mentale.
C'est une tâche que nous, les psychiatres, sommes appelés à accomplir encore aujourd'hui, pour différents types de décisions. Par exemple, lorsque l'un de mes patients a une maladie mentale chronique et qu'il développe un cancer, par exemple, l'oncologue me consultera pour déterminer si les décisions prises en ce qui concerne les traitements contre le cancer sont influencées par une affection comorbide, comme la schizophrénie, et en quoi l'acceptation ou le refus des traitements est influencé par des distorsions cognitives ou des croyances motivées par la maladie mentale.
[Français]
Monsieur le président, je vais partager mon temps avec M. Rankin.
Je remercie les témoins de leur présentation. Ma question s'adresse aux représentants du Centre de toxicomanie et de santé mentale.
Monsieur Lemmens nous a dit que, selon lui, la demande devrait être présentée devant un comité formé de quatre membres. D'autres témoins nous ont dit...
[Traduction]
Puis-je vous demander de faire une pause pendant quelques instants, s'il vous plaît? Il semblerait que la traduction ne fonctionne pas. J'ai arrêté le chronomètre.
[Français]
Merci, monsieur le président.
Ma question s'adresse aux représentants du Centre de toxicomanie et de santé mentale.
M. Lemmens nous a dit que, selon lui, la demande du patient devrait être présentée devant un comité formé de quatre personnes. D'autres témoins nous ont dit qu'il faudrait qu'il y ait un médecin, d'autres deux médecins, d'autres un médecin et un psychiatre, d'autres qu'il faudrait qu'il y ait un juge.
Vous nous avez dit que cela devrait être présenté devant un conseil. J'aimerais que vous puissiez définir qui, selon vous, ferait partie de ce conseil, mais également si, selon vous, cet aspect devrait plutôt faire partie des lois provinciales ou territoriales à venir à la suite de notre décision au palier fédéral.
[Traduction]
Je vous remercie de votre question. Je vais parler de la participation d'un psychiatre à ces comités, et peut-être que Kristin, elle, nous dira qui pourrait aussi faire partie de tels comités. C'est un autre aspect qui a été abordé par les spécialistes du Centre de toxicomanie et de santé mentale, dont je fais partie.
Pour les personnes qui n'avaient pas de trouble de santé mentale avant d'avoir une maladie physique grave et irrémédiable, je ne pense pas qu'il est toujours nécessaire qu'un psychiatre fasse partie du comité. Cela dit, beaucoup de personnes qui sont atteintes d'une maladie en phase terminale développeront une maladie mentale, comme une dépression majeure, ou parfois même une psychose. Si l'équipe de traitement primaire soupçonne que la personne est atteinte d'un trouble psychiatrique, que celui-ci soit apparu avant ou après la maladie physique, je pense qu'il serait alors important à ce moment qu'un psychiatre fasse partie du comité. Encore une fois, cette réponse est liée à ma réponse précédente, dans laquelle je disais qu'il faut évaluer en profondeur la capacité d'une personne.
Je pense que mon ami a fourni une réponse en ce qui concerne l'équipe qui s'occupera de prendre la décision de concert avec le patient et de déterminer si les critères sont respectés ou non.
La création d'un comité ou d'une commission, comme la Commission du consentement et de la capacité de l'Ontario, pourrait être envisagée lorsque la décision prise fait l'objet d'un appel ou lorsque l'équipe clinique, l'équipe consultative qui a été créée, refuse la demande du patient. C'est ce comité ou cette commission qui examinerait les enjeux ou les points de discorde et les traiterait de façon adéquate. Pour ce qui est de la composition des comités, ici, en Ontario, ils sont constitués d'un psychiatre ou d'un médecin, d'un membre du public et d'un avocat. Ce tribunal compétent pourrait sans aucun doute aborder les enjeux de ce type, même s'ils sont extrêmement complexes et certainement nouveaux pour ceux qui en font partie.
En ce qui concerne les autres aspects... peut-être, s'il ne s'agit pas d'un appel, mais il y a certes des questions qui sont soulevées dans le contexte du processus lui-même, et dans ce cas, nous nous tournerions aussi vers ce comité ou ce tribunal.
Merci.
J'aimerais revenir sur la question que ma collègue a posée à propos du Centre de toxicomanie et de santé mentale. C'est probablement la même question, mais elle est formulée différemment.
Comme vous l'avez mentionné, en Ontario, il y a la Commission du consentement et de la capacité, qui est un mécanisme de révision. Ailleurs au Canada, il n'y a que le Yukon qui a mis en place un mécanisme similaire. Je me demandais tout simplement si vous pourriez nous dire quel autre mécanisme pourrait offrir des mesures de protection similaires ailleurs au Canada.
Par ailleurs, pensez-vous que nous devrions créer une commission fédérale pour garantir l'uniformité à l'échelle du pays, ou estimez-vous que cette responsabilité devrait incomber aux provinces et aux territoires?
Pour répondre à la première partie de votre question, je pense que l'ensemble des provinces et des territoires ont une commission d'appel pour le secteur de la santé. Qu'il s'agisse ou non de commissions responsables du consentement et de la capacité, ce sont elles qui examinent les décisions ou les enjeux liés au milieu clinique ou au milieu des soins de santé. Je n'ai pas en main mon tableau des domaines de compétence, mais c'est à l'une de ces organisations que je m'adresserais s'il n'existait pas de tribunal ou de commission responsable des questions relatives au consentement et à la capacité dans les cas de troubles de santé mentale.
Ma question s'adresse au Dr Rajji, du Centre de toxicomanie et de santé mentale. Docteur Rajji, je crois savoir, d'après la documentation que j'ai en main, que vous êtes le chef de la géronto-psychiatrie.
Dans ce cas, vous serez sans doute bien placé pour répondre à ma question, ou à tout le moins pour donner votre opinion sur une question que nous avons entendue à maintes reprises.
En ce qui concerne les directives préalables dans les pays qui autorisent l'aide médicale à mourir, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, y compris celles qui souffrent de démence, sont traitées différemment pour ce qui est des directives préalables. Aux Pays-Bas, les patients ont le droit d'établir des directives préalables, dans lesquelles ils énoncent leurs volontés pendant qu'ils sont encore aptes à le faire. Aux États-Unis, les patients n'ont pas ce droit. Au départ, le Québec avait inclus les directives préalables dans son projet de loi, mais elles ne figurent plus dans la version définitive.
Le Comité devrait-il envisager la possibilité d'inclure les directives préalables pour veiller à ce que la volonté des personnes qui ne sont plus aptes soit respectée et qu'elles puissent avoir accès à l'aide médicale à mourir?
C'est une question dont notre groupe commence également à discuter au Centre de toxicomanie et de santé mentale. Nous n'avons pas encore de recommandation claire et précise à ce sujet. Ce qui rend la question complexe, c'est que des changements surviennent sur le plan des capacités, et c'est pourquoi les directives anticipées sont importantes. Au moment où une personne veut une aide médicale à mourir, elle n'a peut-être pas la capacité d'accomplir ses volontés. Toutefois, ses volontés peuvent aussi changer.
D'un point de vue clinique, encore une fois, même si la nature dégénérative de la démence est probablement plus prévisible sur le plan de l'histoire naturelle que ce que j'ai présenté, il est également difficile de prévoir l'état mental futur de la personne touchée. On ne peut savoir précisément quand elle sera incapable de prendre ces décisions.
Je vois des personnes à un stade avancé de démence qui sont heureuses d'être simplement assises dans un fauteuil et qui sourient. La neurodégénérescence n'a pas entraîné d'anxiété ni de douleur profonde; elles ne sont pas autonomes sur le plan fonctionnel, mais elles semblent être heureuses comparativement à d'autres personnes dont la maladie a évolué différemment et qui éprouvent une grande souffrance au dernier stade de la maladie.
Je vous fais part des complexités de la question plutôt que d'une recommandation précise. Les volontés et l'état mental d'une personne peuvent changer, même si elle n'a pas ses capacités; ce qui pourrait arriver 10 ans après le diagnostic peut être bien différent de ce qu'une personne ayant ses capacités imagine lorsqu'elle pense aux souffrances qu'elle éprouvera au stade avancé de la maladie en se fiant sur ce qu'elle voit chez d'autres personnes.
Nous avons entendu un exposé très difficile, l'autre jour, concernant la dernière année de vie d'une personne atteinte de démence. Nous l'avons probablement encore tous à l'esprit.
On nous a demandé comment nous nous sentirions si un membre de notre famille souffrait de démence ou si nous en souffrions nous-mêmes. On nous a aussi demandé si nous voudrions faire en sorte de ne pas avoir à endurer cette épreuve terrible en ayant la possibilité de dire à l'avance, pendant que nous en sommes encore capables, que nous ne le voulons pas, et qu'en fait, une personne pourrait mettre fin à ses jours bien avant, lorsqu'elle jouit encore de ses capacités, si elle n'a pas la certitude d'être en mesure de donner une directive anticipée.
Je comprends la complexité de la question et je crois que des discussions plus approfondies sont nécessaires en ce qui concerne les directives anticipées pour ces personnes. Ce n'est pas une question évidente.
Monsieur le président, je voudrais adresser ma question à la représentante de la Société canadienne de pédiatrie, Mme Mary Shariff. Ma question porte sur l'état du droit canadien en ce qui concerne les mineurs et les services de santé. Ce sera peut-être plus facile pour vous d'y répondre.
Je voudrais vous renvoyer à une décision rendue en 2009 par la Cour suprême. Il s'agit d'une décision majoritaire que vous connaissez sans doute, A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille), dans laquelle le procureur général du Manitoba et ceux de la Colombie-Britannique et de l'Alberta sont intervenus. Je vais lire un extrait du paragraphe 46 de la décision, dans lequel la Cour a déclaré ce qui suit:
[...] la common law a plus récemment délaissé le postulat que tous les mineurs sont dépourvus de capacité décisionnelle pour leur reconnaître une autonomie décisionnelle correspondant au développement de leur intelligence et de leur compréhension.
Autrement dit, ils ont le droit de prendre ces décisions. La Cour ajoute:
[...] ce droit varie en fonction de leur degré de maturité, l'examen de la maturité devenant de plus en plus rigoureux selon la gravité des conséquences possibles du traitement ou de son refus.
Autrement dit, il ne s'agit pas d'une exclusion générale. On dit que plus la décision est importante pour le jeune qui la prend, plus l'examen des divers critères énoncés par la Cour au paragraphe 96 est rigoureux. Il y a sept critères.
Il me semble que nous ne pouvons pas les exclure et, comme vous l'avez suggéré, décider de façon générale que tous les jeunes de moins de 18 ans n'auraient pas la capacité de décider. Je pense qu'ils en auraient la capacité, mais que l'examen de cette capacité serait plus rigoureux, parce que la décision aura des conséquences sur leur vie, et que c'est l'un des sept critères énoncés dans la décision de la Cour.
Il me semble que si nous voulons légiférer relativement à l'âge — ou devrais-je dire de façon générale au critère d'accessibilité — je pense que nous devons tenir compte de cette décision de la Cour suprême, qui est très récente. Elle a été rendue en 2009.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'une des choses que j'essaie de souligner, c'est qu'il existe une distinction entre la procédure d'évaluation de la capacité et les critères de fond. Nous avons bien une procédure en place pour évaluer la capacité décisionnelle des enfants, mais cela ne permet pas d'établir si les enfants et les adolescents devraient pouvoir obtenir l'accès, au départ, à l'aide médicale à mourir.
Cela soulève de grandes questions éthiques; il n'y avait pas de données éthiques disponibles à la Cour suprême concernant les enfants, mais il y en avait concernant les adultes. La décision de la Cour suprême ne reposait pas uniquement sur la capacité d'un adulte à choisir l'aide médicale à mourir. Elle reposait aussi sur un certain nombre d'éléments de preuve afin de trancher, lorsque les arguments ont été présentés en vertu de l'article 7 — qui porte sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité —, les questions relatives à la dignité, au fardeau imposé aux autres personnes, et ainsi de suite. Nous n'avons rien entendu au sujet des sentiments qu'éprouvent les enfants lorsqu'ils sont atteints d'une maladie donnée.
Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous avons des processus pour évaluer la capacité décisionnelle des enfants, mais nous n'avons pas examiné, du point de vue des données éthiques, la question de fond qui consiste à savoir s'ils devraient obtenir cet accès en premier lieu. Cela nécessiterait des consultations auprès des pédiatres, des familles et des enfants; l'étape suivante consisterait à se pencher sur le processus et à déterminer s'ils ont ou non la capacité de prendre cette décision.
Est-ce que cela a du sens?
Eh bien, j'ai une opinion différente de la vôtre, mais je ne crois pas avoir le temps de l'exprimer.
Ma question s'adresse au Dr Rajji, du Centre de toxicomanie et de santé mentale.
Ce soir, nous avons parlé de différents scénarios concernant la santé mentale; j'aimerais que vous nous expliquiez la différence entre ces situations, selon vous, et surtout, comment cela s'applique en ce qui concerne l'admissibilité.
Nous avons une situation dans laquelle une personne a un problème de santé mentale — je crois qu'on a donné comme exemple la schizophrénie. La personne considère sa situation comme étant grave et irrémédiable, sa souffrance est intolérable, et elle demande l'aide médicale à mourir.
Une autre situation concerne une personne ayant une maladie en phase terminale ainsi qu'un problème de santé mentale comme la schizophrénie. Pourriez-vous nous dire s'il y aurait une différence, selon vous, sur le plan de l'admissibilité, et quelles conséquences pourraient en découler?
Pour vous donner un exemple tout à fait hypothétique, lorsqu'une personne a une maladie comme la schizophrénie, qu'elle vit un épisode aigu de psychose et qu'elle pense à la mort, qu'elle veut se suicider ou qu'elle demande l'aide médicale à mourir, c'est en raison d'une croyance hypothétique selon laquelle si elle ne meurt pas, ce sera la fin du monde. Il y a une croyance délirante qui dicte l'idée suicidaire ou, dans ce cas-ci, la demande d'aide médicale à mourir. C'est là où l'évaluation de la capacité est importante, afin de déterminer si cette demande est motivée par une idée délirante ou par une déformation de la réalité attribuable à la maladie mentale.
Un scénario semblable pourrait se produire lorsqu'une personne — et je vais modifier l'exemple pour des raisons de vie privée — est atteinte de schizophrénie et qu'elle développe ensuite un cancer traitable, mais qu'elle refuse le traitement parce qu'elle croit que si elle l'accepte, son frère ou sa soeur aura le cancer. Dans ce cas-ci, la décision de recevoir un traitement ou de demander l'aide médicale à mourir en raison du cancer est motivée par l'illusion que si elle ne meurt pas, son frère ou sa soeur aura le cancer. Je pense qu'il est alors important de faire appel à un psychiatre pour évaluer la capacité décisionnelle de la personne et pour déterminer dans quelle mesure la demande d'aide médicale à mourir est motivée par ses pensées délirantes. J'espère que cela répond à votre question.
Merci.
Si la personne répond aux critères de l'évaluation de la capacité, c'est-à-dire qu'elle a la capacité décisionnelle nécessaire, en ce qui concerne ces deux scénarios, quelles seraient les conséquences sur l'admissibilité?
Dans le cas d'une personne qui demande une aide médicale à mourir en raison de la schizophrénie, la nature irrémédiable de la maladie n'est pas claire. Nous ne pouvons la définir clairement. Pour revenir à l'exemple que j'ai donné, certaines personnes ne présentent pas de psychose aiguë, mais elles n'ont aucun espoir de guérir de la maladie dont elles souffrent. Cette croyance à leur sujet, leur vision d'elles-mêmes, n'est pas psychotique, selon la terminologie médicale, mais elle est alimentée par des facteurs sociaux qui y contribuent, peut-être parce que ces personnes sont victimes de violence depuis leur enfance. Elles ont peut-être subi de l'intimidation, puis ont perdu leur emploi parce que leur patron ne savait pas comment agir avec une personne atteinte d'une maladie mentale. Au fil du temps, les personnes atteintes de troubles mentaux accumulent toutes ces croyances d'inutilité, d'impuissance ou de désespoir; or, ces croyances sont malléables. C'est l'approche axée sur le rétablissement dont j'ai parlé, qui peut être utilisée comme moyen d'intervention.
Permettez-moi de vous interrompre, car il y a deux volets. Vous parlez de la vulnérabilité, et nous devons absolument déterminer comment protéger les personnes vulnérables, mais je vous ai d'abord posé une question au sujet de l'admissibilité, soit si, selon vous, une personne qui a la capacité décisionnelle nécessaire, mais qui se trouve dans ces deux situations pourrait être admissible en vertu du test de Carter.
Pour le premier exemple, il est difficile de justifier l'admissibilité simplement en raison de la maladie mentale, car la croyance sera probablement encore nourrie par la maladie mentale, ou les conséquences de la maladie mentale. Dans le deuxième exemple, la personne pourrait être admissible s'il est évident que la maladie ne contribue pas à la capacité décisionnelle et si elle souffre d'une maladie physique en phase terminale qui est considérée généralement par un comité ou par les médecins comme étant irrémédiable. La différence, c'est qu'il nous est difficile de déterminer si une condition pourrait être irrémédiable uniquement en raison d'une maladie mentale.
Merci, monsieur le président. Je tiens également à remercier tous nos témoins.
Ma première question s'adresse à M. Hashmi. Je vous remercie, monsieur Hashmi, d'avoir attiré notre attention sur ce que je considère comme le concept fondamental dont tous les membres du Comité doivent tenir compte, soit la dignité intrinsèque de tous les êtres humains, quelle que soit la difformité ou l'incapacité.
Nous avons la chance d'avoir au Canada de nombreux médecins de diverses confessions religieuses, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans votre communauté. Pourriez-vous nous dire quel degré de protection de liberté de conscience vous aimeriez voir dans la mesure législative, compte tenu de l'arrêt Carter? Nous préférerions qu'il n'existe pas, mais il existe.
Quelles mesures de protection de la liberté de conscience aimeriez-vous que le Comité inclue dans ses recommandations à l'intention du gouvernement?
Nous dirions qu'elles devraient certainement inclure la protection des médecins qui veulent éviter toute participation à ce type de procédure, ainsi que la protection des établissements confessionnels de soins de santé pour veiller à ce que... Encore une fois, c'est une question d'équilibre des droits. Ceux qui estiment qu'il est important pour eux, pour leur foi et pour leur conscience d'éviter d'y participer devraient pouvoir le faire.
Merci beaucoup.
Ma prochaine question s'adresse à la Société canadienne de pédiatrie. Je veux m'assurer d'avoir bien entendu. J'ai cru comprendre que le groupe consultatif d'experts provinciaux-territoriaux n'a pas consulté la Société canadienne de pédiatrie avant de présenter ses recommandations. Est-ce que j'ai bien entendu?
Savez-vous si d'autres groupes d'intervenants, et j'estime que la Société canadienne de pédiatrie est certainement un groupe d'intervenants important, ont été exclus des consultations au sujet de la formulation des recommandations par le groupe consultatif d'experts provinciaux-territoriaux?
En ce qui concerne les enfants, je ne suis au courant d'aucune consultation auprès d'un groupe de défense de l'enfance, d'un service de protection de l'enfance ou de la Société canadienne de pédiatrie.
Mary, avez-vous quelque chose à ajouter?
Je vous remercie.
Je suppose que c'est préoccupant pour moi en tant que membre du Comité de constater que, tout particulièrement en raison des nombreuses fois où il a été mentionné que l'affaire Carter est un seuil et non un plafond, la Société canadienne de pédiatrie recommande de ne pas aller plus loin que l'affaire Carter. J'estime que c'est fort instructif.
Ma dernière question s'adresse au Centre de toxicomanie et de santé mentale.
Vous avez signalé que vous fournissez des soins pour un nombre maximal de 30 000 patients, des patients qui doivent composer avec divers problèmes de santé mentale. Vous avez aussi précisé qu'il est difficile d'affirmer si ces problèmes sont irrémédiables ou non. Vous avez fait des observations sur certaines caractéristiques chroniques et épisodiques de la santé mentale, et vous avez même parlé du fait que la schizophrénie peut dans certains cas être surmontée, c'est-à-dire que la maladie n'est pas guérie, mais qu'il existe d'importants mécanismes d'adaptation.
J'ai été très encouragé de vous entendre dire que vous mettez l'accent sur l'espoir, parce que je crois qu'il s'agit de l'une des choses dont le Comité est chargé, c'est-à-dire d'offrir de l'espoir. À mon avis, pour arriver à donner de l'espoir, il faut veiller à ce que nous n'ouvrions pas la porte aux personnes vulnérables, notamment celles atteintes de problèmes de santé mentale.
Compte tenu, notamment, de la nature épisodique des problèmes et du fait que les personnes peuvent changer d'avis, pouvez-vous nous assurer que vous êtes en mesure de mettre en place des mesures de protection suffisantes qui feront en sorte que même 1 % des 30 000 personnes ne puisse pas mettre fin à sa vie de façon involontaire, en raison d'une crise de dépression?
Nous avons été informés plus tôt par certains témoins que les mesures de sécurité ne pourraient être qu'une illusion. J'aimerais que vous nous disiez si nous, en tant que membres du Comité, sommes réellement en mesure de mettre en place des mesures de sécurité suffisantes.
C'est une grande demande.
C'est l'un des aspects qui a été abordé par le groupe de travail, soit la notion de vulnérabilité de notre population de patients, et, comme nous en avons parlé plus tôt, les déterminants sociaux contribuent également au désespoir que ressentent les personnes atteintes d'une maladie mentale, notamment la dépression.
Les mesures de sécurité que l'on vous demande d'établir, je crois, doivent tenir compte du fait qu'il y aura certaines personnes qui demanderont, en raison de leur maladie, ce genre d'aide pour mettre fin à leur vie de façon prématurée. L'une des mesures que nous envisageons, c'est que les cliniciens ici puissent refuser l'aide par objection de conscience, en se fondant uniquement sur l'espoir et la guérison. Il ressort de nos discussions que les cliniciens ont des difficultés lorsque les patients dont ils sont responsables font demi-tour et commencent à parler de façons dont ils pourraient mettre fin à leur vie...
Bien sûr. Je suis désolée.
Pour résumer, vous avez une importante tâche qui vous attend, et s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour aider, nous serons heureux de le faire.
Je vous remercie.
Je crois que c'était la Société canadienne de pédiatrie, alors c'était peut-être Mary Shariff qui a parlé de la première mouture de la mesure législative sur l'aide médicale à mourir.
Compte tenu de notre discussion sur les données, la supervision, la surveillance et la rétroaction concernant un processus législatif, j'ai trouvé intéressant que vous mentionniez la notion de première version, puisque j'avais l'impression que vous pensiez à une deuxième ou une troisième version.
Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez utilisé ce terme et ce qu'il suppose?
J'ai utilisé ce terme parce que l'affaire Carter peut être interprétée de façon très étroite. Il me semble qu'il faut une discussion préventive afin d'inclure d'autres personnes, notamment les enfants et les mineurs, ainsi que des personnes atteintes d'autres types de maladies. Par exemple, il faut une directive anticipée, de nature préventive, dans l'éventualité où il y aurait une contestation fondée sur la Charte.
Nous savons qu'il pourrait y avoir une contestation fondée sur la Charte simplement en raison de la nature des arguments invoqués dans l'affaire Carter. De nombreux arguments pourraient être fondés sur la notion de droit à la vie prévue à l'article 7. Sans mesure de prévention à l'avenir, certaines personnes pourraient mettre fin à leur vie plus tôt. Nombre de cas figurent dans cette catégorie.
Comme il n'y avait pas de données dans l'affaire Carter concernant des enfants, par exemple, et qu'il n'y a pas eu de discussion sur une directive anticipée... je sais qu'il y a cette idée qui se propage. Je n'aime pas vraiment cette analogie, cette métaphore, ou peu importe comment vous souhaitiez la désigner. Je crois qu'il faut des données. Nous devons être en mesure de comprendre.
La question est controversée même en Belgique, mais nous examinons une solution semblable à celle adoptée en Belgique. Je crois que, dès la décision de première instance, nous envisagions une solution belge-néerlandaise au Canada. Ce n'était pas du tout un secret.
En Belgique, après avoir examiné la situation des enfants, par exemple, ils ont adopté leur loi en 2002 et ils n'ont commencé à réfléchir aux mineurs, sauf les mineurs émancipés, que 12 années plus tard. Ils ont donc eu du temps pour recueillir des données et examiner la preuve. La Cour suprême ne dispose tout simplement pas de données au sujet des mineurs.
Les décisions et les arguments relatifs aux articles 7 et 15 sont fondés sur l'expérience d'adultes qui demandent un service particulier, un service d'aide à mourir, et nous ne savons pas dans quelle mesure l'essence même de ces arguments peut s'appliquer aux enfants mineurs. C'est aussi simple que cela.
Lorsque je parle de première version, je ne suis pas certaine. Si l'argument est que nous pouvons tous aller de l'avant avec ceci puisqu'il n'y a que quelques personnes visées, faisons preuve de prudence et ne nous précipitons pas pour tout inclure. Recueillons de l'information. Ici, c'est le Canada, et non les Pays-Bas ou la Belgique.
Donc, on pourrait commencer avec l'interprétation la plus stricte de l'affaire Carter... Pour la première version de la mesure législative, on se concentrerait sur les données, la surveillance et possiblement une rétroaction quant à la mise à jour de la mesure. Est-ce cela que vous me proposez?
J'adresse moi aussi mes questions à la Société canadienne de pédiatrie.
Dans votre allocution, vous avez parlé de la première version et de la nécessité d'être très prudent si nous devons aller au-delà des adultes et inclure les jeunes. J'ai lu le document en 20 points du comité de la bioéthique, qui a d'abord été publié en avril 2011 et qui a été confirmé le 1er février cette année. Il y est question de refuser et de cesser l'alimentation et l'hydratation artificielles. Au point 7, il est indiqué ce qui suit: « On peut supprimer les liquides et les aliments médicalement assistés à un enfant lorsque cette mesure ne fait que prolonger sa vie et ajoute de la morbidité à son agonie. »
[Note de la rédaction: difficultés techniques]
D'accord.
Comment peut-on expliquer cela? Comment peut-on concilier votre intervention ici ce soir et le document qui a été publié à l'origine en 2011 et qui a été confirmé l'autre jour, alors que vous nous exhortez à être prudents et à ne pas aller au-delà... au-delà du seuil, si vous préférez?
C'est une réponse simple. L'affaire Carter ne se limite pas à une maladie en phase terminale. Il est question de cas concernant le refus de l'alimentation et de l'hydratation chez un enfant en phase terminale. C'est simple. L'affaire Carter ne porte pas que sur des maladies en phase terminale.
Donc, voilà sur quoi vous vous fondez pour établir une distinction, sur le fait qu'il s'agit ou non d'une maladie en phase terminale?
Je crois qu'il faudrait une conférence d'une heure sur cette question seulement. L'euthanasie et l'aide médicale à mourir n'ont rien à voir avec le fait de cesser des traitements, des traitements médicaux qui n'offrent aucun avantage à un enfant.
Tout ce que je peux dire c'est que, sur le plan de l'éthique et de la loi, c'est très clair. Je ne crois pas que nous ayons le temps d'entrer dans les détails, mais je m'y connais bien quant aux deux questions, au cas où vous souhaiteriez obtenir de plus amples renseignements à cet égard.
Imam Hashmi, je vous remercie d'avoir expliqué ce que vous considérez comme un processus au sens de la décision Carter. L'une des questions qui ont été soulevées est la question de l'aiguillage plus efficace. Si vous consultez un médecin qui pourrait refuser par objection de conscience en raison de sa religion, ou toute autre personne, l'une des options suggérées par l'Association canadienne des libertés civiles de la Colombie-Britannique serait que le médecin n'aiguille pas le patient vers un autre médecin, mais de signaler à quelqu'un en milieu hospitalier qu'il s'est opposé à un traitement. Le médecin n'aurait qu'à procéder ainsi, puis quelqu'un d'autre se chargerait du cas.
Un tel système vous conviendrait-il?
Je le crois. Il faut tenir compte des droits des médecins et des fournisseurs de soins de santé, ainsi que de leurs croyances et de leur liberté de conscience, mais il faut également respecter la décision Carter et les droits individuels des patients.
Dans un tel cas, oui, si un médecin reçoit une demande et s'adresse à son superviseur ou quiconque dans l'organisation et lui demande de s'occuper de la demande, cela devrait aller.
En ce qui concerne l'équipe proposée d'aide médicale à mourir dont vous parlez, si une demande était présentée, l'équipe pourrait aller sur place et présenter les options. Je crois que pour de nombreux médecins, du moins ceux qui sont de confession musulmane, cela ne présenterait pas de problème, puisque l'équipe parlerait des diverses options offertes et pas seulement l'une d'entre elles, soit l'aide médicale à mourir.
Je ne prévois aucune autre difficulté à cet égard.
Vous pouvez poser la question et la faire consigner au compte rendu. Nous pourrions alors obtenir une réponse écrite de leur part.
Le coprésident (L'hon. Kelvin Kenneth Ogilvie): Exactement.
Je vous en suis reconnaissante. Merci.
Ma question est donc pour le Dr Rajji.
D'après les scénarios et l'évaluation servant à déterminer si une maladie est irrémédiable, je ne crois pas que l'on ait tenu compte du fait que, selon la décision Carter, il n'est pas nécessaire que le patient accepte le traitement. J'aimerais obtenir son avis quant à la question de l'admissibilité en ce qui concerne les problèmes de santé mentale, c'est-à-dire quelqu'un qui a uniquement un problème de santé mentale ou une maladie mentale sous-jacente et une maladie en phase terminale, dans le cadre du scénario où un patient, conformément à la décision Carter, a le droit de dire qu'il ne veut pas poursuivre le traitement pour son problème de santé mentale.
Les greffiers se chargeront des communications. Nous tenterons d'obtenir une réponse à votre question.
Merci beaucoup.
Le coprésident suppléant participera au prochain tour des libéraux. Il se chargera des questions.
J'aimerais aussi poser quelques questions aux représentants du Centre de toxicomanie et de santé mentale, et tout particulièrement au Dr Rajji.
Comment font-ils participer les patients au groupe de travail qu'ils ont créé sur l'aide médicale à mourir? Combien de patients siègent à leur comité? Quelle a été la réponse des patients à l'égard des questions posées?
J'aimerais également savoir comment la Société canadienne de pédiatrie fait participer les enfants à la discussion sur leurs problèmes de santé. Vous avez mentionné des données sur l'éthique. Bien que j'aie étudié l'éthique dans divers cours de niveau postsecondaire, je n'ai aucune idée en quoi consistent des données sur l'éthique. Je vous demanderais d'expliquer en quoi consistent les données sur l'éthique, ou les données éthiques — je ne suis pas certain de ce que vous avez dit — et ce que cela signifie. J'ai même fait une recherche sur Google, mais je n'ai pas trouvé de réponse.
En outre, pour ce qui est de la participation des enfants, le Manitoba a mis en place un plan solide pour faire participer des enfants dans certaines recherches en matière de santé. Je me demande comment vous avez procédé pour arriver à la position que vous avez présentée ce soir.
Je vais commencer. Je ne crois pas qu'il en était question dans ma partie du mémoire, et nous ne cherchions pas du tout à semer la confusion. Disons simplement que la Société canadienne de pédiatrie n'a pas discuté de la question en groupe pour le moment, car les conclusions provinciales et territoriales n'ont été publiées qu'à la fin du mois de novembre dernier.
Pour ce qui est de la façon d'inclure les enfants et les familles dans le processus de prise de décision, nombre d'hôpitaux ont...
Il était question d'enfants et de leurs droits, pas de familles. Ce sont eux auxquels on faisait allusion.
D'accord. Je vous donnerai l'exemple de la chimiothérapie. Expliquer à un enfant ce qu'est la chimiothérapie et ce que cela implique, ce qui se produira, dépend de ce qu'il veut entendre, de la mesure où il souhaite s'en remettre à ses parents...
Je m'excuse. Je n'ai pas été suffisamment clair. Vous avez exposé une position ce soir, et je me demande comment vous avez fait participer les enfants à l'élaboration de la position de principe que vous avez tous les deux énoncée. Je comprends la participation des enfants aux décisions sur leurs soins, mais dans votre position de principe... Vous avez longuement énoncé cette position ce soir. Il s'agit peut-être d'opinions personnelles. Je pensais que c'étaient les opinions de votre organisation. Je m'y perds peut-être. S'agit-il de vos opinions personnelles ou de celles de l'organisation?
Ce sont celles de l'organisation. Nous avons eu six jours pour développer cette position de principe. Elle a été présentée à la directrice générale de la Société canadienne de pédiatrie. Nous avons décidé de nous en tenir aux principaux points que nous voulions faire valoir et qui, d'après nous, feraient l'objet d'un consensus. Nous tenons à préciser qu'il n'y a pas eu du tout de discussions avec les professionnels de la santé, les familles et les enfants canadiens à propos de cet enjeu. Pour cette raison, nous croyons qu'il serait vraiment prématuré de l'inclure, car la décision Carter ne nous prescrit pas de le faire.
Docteur Rajji, pouvez-vous nous entendre?
Une voix: Oui, nous le pouvons.
Le coprésident (L'hon. Kelvin Kenneth Ogilvie): Pendant que vous étiez hors ligne, nous avons eu ici deux questions pour vous. Les greffiers vous enverront les questions écrites, et nous vous saurions gré d'y répondre le plus rapidement possible. Est-ce que cela vous convient?
Merci encore, monsieur le président.
J'ai une autre question à poser aux représentantes de la Société canadienne de pédiatrie.
Vous avez affirmé que des soins palliatifs de qualité doivent être accessibles aux enfants et aux jeunes. Vous extrapolez à partir de recherches menées en Colombie-Britannique indiquant que 10 enfants sur 10 000 ont besoin de services en soins palliatifs, mais que, malgré ce tout petit nombre, seulement 5 % à 12 % des enfants qui auraient pu profiter de services de soins palliatifs spécialisés en ont effectivement reçu. Je pense que vous cherchez de nouveau à faire comprendre au Comité que le nombre d'options de soins palliatifs qui sont offertes est minime, surtout en ce qui a trait aux soins palliatifs pour les enfants. Nous savons, grâce au groupe consultatif d'experts, que seulement 55 médecins canadiens sur 77 000 sont des spécialistes des soins palliatifs. Ces deux problèmes des plus inquiétants montrent que nous devons faire mieux.
Ma question serait la suivante. Dans votre présentation, soutenez-vous que, avant de permettre l'aide médicale à mourir, nous devrions au moins être en mesure d'offrir de nombreuses options de soins palliatifs aux enfants qui pourraient, à l'avenir, réclamer cette procédure?
C'est une opinion personnelle, mais je pense pouvoir aussi parler au nom de la Société canadienne de pédiatrie. C'est exactement ce que nous disons. Il est absolument prématuré de s'attendre à ce que les enfants puissent demander de mettre fin à leurs jours, lorsque les services en soins palliatifs qui leur sont offerts à l'échelle nationale sont complètement inadéquats. À titre d'information, moins de 20 médecins à temps plein au Canada se spécialisent en soins palliatifs pour les enfants, et un très grand nombre de travailleurs de la santé de première ligne en milieu communautaire, qu'il s'agisse de médecins de famille ou d'infirmières prodiguant des soins à domicile, ne possèdent aucune formation ou expérience dans la prestation de soins aux enfants souffrant de maladies limitant l'espérance de vie.
Merci.
Vous l'avez peut-être déjà dit dans l'une de vos interventions antérieures ou de vos réponses à une question, mais quelle est votre définition actuelle d'un adulte? Est-ce le fait d'avoir au moins 18 ans, ou est-ce quelque chose d'autre?
Je pense que, aux fins de votre loi, une personne ayant au moins 18 ans est un adulte. J'essaierais d'être aussi « conservatrice » que possible.
Merci.
Je veux remercier l'imam Hashmi d'être avec nous.
Avez-vous un document à distribuer?
Il semble que votre témoignage n'est pas dans les deux langues officielles, mais nous pourrions vous rencontrer après la réunion. Auriez-vous une copie de votre témoignage?
Merci.
Simplement à titre d'éclaircissement, en ce qui concerne la liberté de conscience, vous avez dit que les médecins religieux et les institutions religieuses ne devraient pas avoir à participer. Parlez-vous de participer à la prestation de ces services ou de ne pas diriger le patient vers quelqu'un qui fournira ces services?
Non, ils dirigeraient le patient vers une personne fournissant ces services, mais ils ne les fourniraient pas eux-mêmes.
Monsieur le président, je ne sais pas s'il s'agit d'un rappel au Règlement ou non, mais nous avons réussi à régler les difficultés techniques. Même si je suis en faveur du concept de partage du temps de parole et que c'est ce que nous avons convenu de faire, je me demande, puisque les autres témoins sont de nouveau en ligne, si nous pourrions obtenir très rapidement des réponses aux deux questions qui ont été posées. Je pense que cela nous aiderait tous d'entendre les réponses, au lieu d'attendre des réponses écrites.
Je vais mettre la proposition aux voix.
Êtes-vous d'accord avec la proposition?
Des voix: D'accord.
Le coprésident (L'hon. Kelvin Kenneth Ogilvie): Merci.
Docteur Rajji, vous allez devoir répondre à d'autres questions. La première provient de Mme Dabrusin; et la deuxième, du coprésident.
Madame Dabrusin.
Non, je veux simplement modifier légèrement ce que j'avais prévu de dire.
Quand vous parliez plus tôt d'affection « irrémédiable », docteur Rajji, vous faisiez allusion à la disponibilité des traitements et sur l'impossibilité d'évaluer s'ils seraient efficaces ou non, mais la décision Carter n'exige pas qu'un patient accepte un traitement. Un patient peut décider qu'il ne veut pas recevoir d'autres traitements. Selon vous, comment cela influerait-il sur l'admissibilité des personnes souffrant de problèmes de santé mentale?
Quand je parlais du caractère irrémédiable de l'affection, je pensais à trois concepts. Le premier est l'évolution naturelle de la maladie. Contrairement à d'autres troubles médicaux, les maladies mentales ne sont pas associées à une mort prochaine ou inévitable. En fonction de l'évolution naturelle, par exemple, 25 % ou plus des schizophrènes peuvent guérir s'ils attendent assez longtemps, et une guérison complète est possible.
Le deuxième concept est...
Nous ne le savons pas. Nous n'avons pas assez de renseignements à ce sujet. La majorité des schizophrènes aurait reçu une certaine forme de traitement. Il est difficile de savoir si ce sont les traitements ou l'évolution naturelle qui sont responsables de la guérison. Il faudrait mener des études longitudinales qui prendraient 10 ans, 20 ans, et parfois 40 ans pour obtenir cette information.
Le deuxième enjeu est celui du suicide. Il y a des suicides, mais nous ne savons pas quand ils vont se produire ou s'ils vont se produire. Nous connaissons néanmoins bien les facteurs qui accroissent le risque.
Le troisième enjeu vise à déterminer si les médicaments permettront de guérir les gens qui les prennent et si une personne ne réagissant pas aux médicaments peut quand même guérir naturellement. Nous savons, par exemple, que les gens souffrant de dépression qui ne reçoivent pas de traitement contre cette maladie ou à la suite d'épisodes dépressifs se rétabliront un jour. Nous ne savons juste pas quand.
Le deuxième grand concept relatif au caractère irrémédiable de la maladie est que, même pour les personnes qui y en affichent les symptômes et qui souffrent d'épisodes, nous adoptons une approche visant à les aider à vivre avec cette maladie. Puisque ces maladies ne sont pas associées à une mort inévitable et progressive, nous pouvons, dans certains cas, nous permettre de travailler avec la personne atteinte, même si elle refuse de recevoir un traitement. Il y a des personnes et des patients que j'ai vus la semaine dernière qui refusent de se faire traiter, mais qui viennent quand même me voir parce que je leur ai fait comprendre que je serais là s'ils venaient me voir. Nous continuerons à parler d'enjeux relatifs au traitement ou au rétablissement, et sur la façon de vivre avec leur maladie, afin que la maladie ne devienne pas...
Je pense que nous avons une idée générale d'où vous voulez en venir. Cela pourrait prendre beaucoup de temps. Je vais donc donc céder la parole à M. Oliphant.
Je pense que la réponse à ma question sera plus rapide. Je crois que vous avez dit plus tôt que vous avez créé un groupe de travail sur l'aide médicale à mourir, et qu'il est en cours de constitution.
Comment faites-vous participer vos patients à ce groupe? Combien de patients siègent dans le groupe? Vous traitez 30 000 patients par année. Combien d'entre eux participent à votre processus, et comment y participent-ils?
Le groupe de travail est un sous-comité de notre comité consultatif médical à l'hôpital. Comme nous l'avons indiqué, il s'agit d'un groupe interprofessionnel, qui est formé de juristes et d'experts en matière d'éthique. Nous avons une représentante auprès du Conseil d'autonomie du client, qui est un groupe de défense des droits des patients travaillant au sein du CAMH, mais qui en est indépendant. Son rôle dans notre comité, ainsi que dans de nombreux autres comités de notre organisation et d'ailleurs, est d'être la voix du patient.
Il s'agit d'une représentante des patients, mais elle mène, dans le cadre des travaux du Conseil d'autonomie du client, des consultations externes au comité. Par conséquent, même si une seule personne siège au sein de ce comité de, je crois, sept ou huit membres, la voix des patients se fait entendre par cette représentante.
Est-ce que vous diriez que le processus est axé sur le patient? Le ministre qui vous finance, M. Hoskins, a laissé entendre que tous les processus, dans tous les hôpitaux, devraient être axés sur le patient. Décririez-vous ce processus comme étant axé sur le patient?
Oui, je pense qu'il l'est.
Nous avons des cliniciens à la table, ainsi qu'une représentante des patients. Je peux vous garantir que si la représentante ne croyait pas que nous faisions un bon travail, elle nous le dirait.
Merci beaucoup.
Je tiens à remercier grandement les témoins d'avoir comparu devant nous. Vous avez tous été très éloquents, et nous vous en sommes très reconnaissants.
Je veux aussi remercier les membres du Comité de leur patience.
Je tiens à vous rappeler que la réunion du Comité commencera demain après-midi, à 16 h 30, dans cette pièce. La façon dont nous procéderons dépendra des décisions qui seront prises demain par vos collègues de la Chambre des communes au sujet de leurs votes.
Sur ce, je déclare la séance levée.
Explorateur de la publication
Explorateur de la publication

